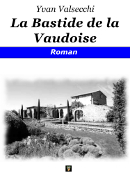La culture d'entreprise et sa représentation sociale
Auteur : Nathalie Diaz
-
I - AVANT-PROPOS
- II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
- III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
- IV - LA VERSION FRANCOPHONE
- V - CONTEXTE D'EMERGENCE
- VI - PRESENCE ET MODALITES
- VII - IMAGE ET STRUCTURE
- VIII - LA PEDAGOGIE
- A - Les bases de l'intervention; les préliminaires de la pédagogie de la représentation sociale de la culture d'entreprise
- 1) Rapports induits entre le consultant et son client : le consultant comme instrument de traitement des phénomènes d'influence.
- 2) Le consultant tel qu'il se voit agir et sa position vis à vis de l'entreprise et de la culture d'entreprise.
- B - Participation à la construction des représentations sociales
- 1) LECTURES
Chapitre VIII - LA PEDAGOGIE
A - Les bases de l'intervention; les préliminaires de la pédagogie de la représentation sociale de la culture d'entreprise
1) Rapports induits entre le consultant et son client : le consultant comme instrument de traitement des phénomènes d'influence.
Une grande majorité des consultants (23 entretiens) lors des entretiens ont principalement souligné l'importance comme condition sine qua non de leur intervention sur la culture d'entreprise, d'une expression de la part des membres de l'entreprise concernée, d'une forme de volonté. Celle-ci émane généralement des responsables de l'entreprise, des managers et des dirigeants et conditionne non seulement le style de rapport entre le consultant et son client mais aussi la démarche globale de l'intervention en interne, à l'intérieur de l'organisation. Son expression est généralement suscitée au départ par les consultants, c'est par elle que semble se fixer la relation de confiance entre deux unités au préalable indépendantes. En effet, le consultant est à l'origine indépendant de toute attache, de même que l'entreprise. Il s'agit donc pour eux de se soumettre mutuellement à une relation de dépendance, dont la qualité va dépendre la suite de l'intervention. Ainsi il apparaît que cette volonté a une double vocation.
En premier lieu, elle suggère une volonté conditionnelle de l'action à venir, du devenir quant à un certain état de choses relatives à l'entreprise, à l'organisation. Elle est individuelle, puisqu'elle provient d'une personne, elle est personnalisée et résume alors une consistance intra-individuelle, un "indice de certitude" (MOSCOVICI, 1979) de la part du demandeur, en l'occurrence du dirigeant ou d'une toute autre personne ayant des responsabilités à l'intérieur de l'entreprise. Cette volonté, telle que les consultants l'attendent (devant être explicitement signifiée), doit effectivement suggérer un investissement psychologique, une implication subjective forts, en cela, elle réside en une implication psychologique au sens où FESTINGER (1957) l'a formulée. Elle leur signale que le dirigeant est totalement engagé dans son acte, qu'il consent à se commettre. Il ne s'agit pas en effet pour le dirigeant de déclarer seulement ses intentions, ni de fournir une information, mais de contracter l'obligation d'accomplir un acte. Par ailleurs, il se peut également qu'au travers de cette formulation il s'agisse de la part du dirigeant de reconnaître implicitement un état de dissonance à l'intérieur de l'entreprise, et de chercher à le remédier, de motiver une activité orienté vers la réduction du malaise présent avec l'aide du consultant. Aussi doit-elle pour cela, être signifiée et expressément formalisée, comme l'indiquent eux-mêmes les consultants et la fréquence des formulations conditionnelles sur ce point, quand ils l'évoquent.
" Je démarre mon intervention que si je reçois du dirigeant non pas un accord, mais quelque chose qui me spécifie qu'il veut que ce qui doit être entrepris soit fait, sa volonté importe avant toute chose." (35 ans, ESC)
"je vais pouvoir travailler que si elle (la volonté) est exprimée par un dirigeant" (40 ans, ESC)
"Le point de départ de ma démarche c'est la volonté. Je demande qu'elle soit clairement annoncée. On ne peut pas conduire un travail sur une culture d'entreprise sans qu'il ait une volonté clairement énoncée et...écrite du management. C'est exclus qu'on puisse faire, et des gens qui se mouillent parce que se sont des mutations difficiles, parce que c'est un véritable bouleversement, aussi, s'il n'y a pas d'engagement formel ça ne marche pas, et ça ne marche pas parce que tout le monde se défile. C'est plus personne sur le coup, ils essaient d'échapper, de contourner les obstacles. Or, si vous voulez faire franchir un pas, vous êtes obligés de le faire franchir. Cela me paraît vital, tout le reste c'est des jolis discours." (40 ans, ESC
"A la question "voulez-vous changer de culture d'entreprise, voulez-vous l'améliorer ?", si l'équipe de direction, le dirigeant dit "oui", "oui, nous le voulons", on peut alors mettre en place une stratégie. Mais il faut que ce soit clair, que cette volonté à changer de la part des dirigeants soit claire, explicite. ça c'est, c'est important. A ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut comme je vous l'ai dit, alors mettre en place une stratégie d'analyse, de diagnostic et de mise en action, de recommandations pour améliorer la culture." (33 ans, ESC)
"C'est ça que j'appelle la volonté, on veut si on a besoin de changement de culture, il faut le dire, il faut dire : "je veux ça". Si on ne le dit pas ce ne sont pas des domaines dans lesquels on peut transiger. On ne peut pas". (40 ans, ESC)
"Si le patron dit "je veux", moi, je joue à ce moment là avec ses équipes dans l'entreprise. Si le patron dit pas "je veux", moi, je ne bouge pas." (50 ans, ESC)
"La volonté du dirigeant est capitale. Dans sa tête il doit y avoir que "ce que je fais et fonction de ce que je veux" (34 ans, ESC)
"Le diagnostic pour nous, les enquêtes préalables qu'on va pouvoir faire, c'est d'essayer de comprendre s'il y a une véritable, euh, déjà volonté de changement à l'intérieur de l'organisation, pour des changements en tout cas durables." (40 ans, Université)
Il ne s'agit pas d'exprimer une volonté de travailler ensemble, cette volonté n'a pas pour corollaire exclusif l'entente entre deux personnes, en l'occurrence entre le consultant et le dirigeant, mais bien l'entente et l'engagement actif de ces deux personnes par rapport à un objet qui est l'organisation et au travers d'elle, en ce qui nous concerne, la culture d'entreprise. Aussi cette volonté telle qu'elle doit émaner des dirigeants doit non seulement être présente mais doit également posséder certaines caractéristiques. Ainsi, elle doit être selon les consultants:
- "explicite ferme et convaincante" (35 ans, ESC
- signifiée et forte (40 ans, ESC)
- "forte", "profonde", elle doit correspondre à "une conviction profonde" (35 ans, ESC et Ec d'ingénieur)
- elle vient vraiment de la personne
- elle n'est pas un slogan
- elle est sincère, authentique (45 ans, Universitaire)
- elle est l'expression volontaire de là où il (le dirigeant) veut aller (40 ans ESC).
- elle est "le port vers lequel on souhaite s'orienter" (50 ans, ESC)
- elle est magique.Face notamment au désarroi que peut parfois éprouver la direction ou les managers en présence d'un problème en apparence insoluble, ou d'un obstacle insurmontable, ou tout simplement au désarroi ressenti devant la difficulté que présente le fait de ne pas savoir exactement comment faire avec un groupe humain, sa formulation peut selon les consultants (3 entretiens) revêtir un caractère magique et produire de grands effets.
"Il y a cette volonté un petit peu magique, quelque fois, d'un seul coup d'être compris et d'avoir compris, d'être capable de motiver aussi les gens, stimuler la motivation. Il y a une volonté comme ça un petit peu magique." (40 ans, Université)
"Le dirigeant doit déclarer son projet et les modalités de façon claire, ça le confronte ainsi d'emblée avec son entreprise. Aussi, il ne doit pas avoir peur, donc d'être convaincu de ce qu'il souhaite faire, au départ ça conforte sa position." (BBRRRRRRR, Université)
Quoi qu'il en soit, elle n'échappe pas aux consultants, dans les exemples qu'ils donnent pour illustrer leur propos, sur cette question, ils ne manquent pas de noter l'attitude du dirigeant par rapport à l'intervention au projet. Ainsi on observe la présence dans les entretiens de nombreuses phrases révélatrices de ce souci constant vis à vis de cette volonté et de sa consistance en particulier :
"je sentais son engagement fort" (40 ans, ESC)
"Tout au long du processus de changement culturel, il n'a pas manqué de réaffirmer auprès de ses collaborateurs et de nous-mêmes sa conviction et sa confiance" (50 ans, ESC)
Aussi quand cette volonté vient à faire défaut, ou quand elle n'a pas la force requise, ou qu'elle est imprécise, la procédure utilisée consiste à travailler directement auprès du dirigeant, de "discuter longuement" avec lui (7 entretiens). Ainsi, à propos d'une modification d'attitudes vis à vis des réunions formelles et de la nécessité pour tous les membres de l'entreprise de prendre conscience de l'importance des réunions en général, un consultant explique en ces termes son travail d'approche avec un dirigeant :
"J'ai discuté avec lui de ce qui lui semblait en cohérence avec la culture, les règles minimales d'une réunion dans cette organisation et j'ai travaillé 2 ou 3 demi-journées avec lui, là-dessus. Cela peut paraître incroyable. J'ai travaillé 2 ou 3 demi-journées où on s'est finalement mis d'accord sur les règles minimales d'une réunion, sur ce qui est incontournable pour lui et puis, on se disait toujours : qu'est-ce qui est possible pour l'organisation ?" (40 ans, ESC)
Si cette volonté est défaillante, ou si la réticence à s'impliquer est trop importante, si l'attitude à adopter est coûteuse, contre-attitudinel, comme par exemple celle qui concerne, dans ce cas, un éventuel partage du travail, une constitution d'équipes de travail dans une entreprise à caractère très individualiste dans ses méthodes de travail. Dans ce cas, le consultant, amène le dirigeant, à "prendre conscience", à "se rendre compte". Ainsi, la procédure adoptée par le consultant, porte sur l'univers cognitif des dirigeants, c'est-à-dire sur la connaissance qu'ils ont de ce qu'ils savent, croient ou ressentent concernant les objets pertinents de leur monde, de ce qu'ils savent, croient ou ressentent concernant les autres et eux-mêmes, les autres et les divers objets.
"Il faut au moins que la direction se rende compte que c'est important. Et, à partir du moment où dans une société de distribution, il y a la question de qualité vers le client, dans une société de production, il y a le souci d'une chaîne de production en juste-à-temps mettons, ou dans une entreprise de service encore une fois, la société de distribution, il y a le souci que la personne qui est en face du client, puisse avoir un maximum de liberté pour répondre (...). A partir du moment où on se rend compte que c'est important, c'est logique de dire :"donc, il faut que des gens travaillent ensemble, des personnes de départements différents. Il faut qu'ils travaillent ensemble." (40 ans, ESC et université)
Il arrive également qu'en dépit de ce qu'un désir de changement soit vivement exprimé, les comportements qui suivent démontrent qu'il n'en n'est effectivement rien. Dans ce cas, comme pour l'exemple précédent, le rôle du consultant consistera à effectuer auprès du dirigeant un long travail cognitif, en le mettant en présence d'un choix à faire, dans un état de désirabilité qui l'engage d'une certaine manière :
"Il (le dirigeant) va dire, "oui, oui, il faut changer" et il va continuer à se comporter avec l'ancien modèle, et ça, c'est bien sûr très fréquent dans nos interventions. Qu'est qu'on fait dans ces cas ? Ben, peut-être, lui faire prendre conscience qu'il est en train de me dire "ils changent pas les autres! donc formez-les au changement"; je vais lui dire : "quel pas décidez-vous de faire vous-même ?" Je vis très souvent ce genre de cas." (40 ans, ESC)
De le mettre en présence d'un événement décisif :
" J'ai eu un cas, où j'ai du imposer une évaluation à chaud, imposer entre guillemets, et en présence de la hiérarchie, à faire en sorte qu' à ce moment-là, la hiérarchie soit présente dans tous les groupes, qu'un temps spécial soit aménagé pour ces évaluations et il y avait énormément de groupes. Et à ce moment-là c'est ce qui m'a permis de voir, de faire évoluer les choses, de les faire évoluer, de faire que le processus de changement ne soit plus un processus de changement basé sur la contrainte mais sur autre chose, qui va faire bouger les choses enfin." (50 ans, universitaire)
Et généralement, la constatation est faite, qu'en situation d'urgence, de crise, même si la volonté est précaire, voire absente, les changements sont non seulement immédiats, mais profondément ancrées chez les individus concernés, comme le précise un consultant.
"Dans la crise, le dirigeant est beaucoup moins rebelle au changement parce qu'il.., sa vie, son existence, une partie de son existence est en péril. Et je m'en suis bien rendu compte dans les changements tout simple dans les déménagements, on arrivait à faire faire quand un service changeait de bureaux, on arrivait à faire faire des pas qu'ils auraient pas fait en dix ans en période normale." (45 ans, ESC)
"Dans ce cas présent, c'était assez facile parce qu'il y avait un problème sanction, qui était la pérennité de l'entreprise. Donc, là, c'est un schéma qui est facile à faire comprendre (la nécessite de changer)." (33 ans, Université, 2 ans d'exercice)
D'autre part, la seconde fonction de cette volonté, en plus de servir de contrat de base de l'interrelation du consultant et de son client, consiste à exprimer une volonté à caractère et conséquence permissives à l'égard du consultant, par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Soit, plus exactement, une permission d'agir, comme en témoignent les fréquents termes relatifs à la possibilité de faire ou de ne pas faire, employés par les consultants : "on peut", "on ne peut pas". Elle semble en cela prolonger l'engagement subjectif premier et traduire une consistance cette fois-ci interindividuelle au niveau de l'ensemble de l'organisation. Une des premières résultantes de cette volonté est qu'elle génère en général le consensus :
" La manière de travailler des consultants avec le dirigeant, c'est vraiment la recherche d'un consensus, de quelque chose ensemble, sinon ça ne se fait pas. On peut leur proposer une flopée de choses, si eux ne sont pas convaincu de la chose, ils ne font même pas le tiers de ce qu'il y a, donc, ce n'est pas la peine." (ESC, effectif : 20, )
"Si à partir du moment où il a pris conscience, le directeur du département va dire à ses collaborateurs : maintenant je veux que dans tous les plans vous me présentez une étude d'impact, etc. En général, on fait ce que le directeur demande et à partir de là, la culture change. On n'a pas besoin de faire des choses compliquées !" (45 ans, Universitaire, petite structure)
Elle est ainsi impliquante et génératrice d'actes, voire de modifications cognitives, de comportements nouveaux. La volonté est un gage d'activité. Elle rend effectif le changement, elle le prescrit et semble signifier aux consultants :
"que les gens sont prêts à jouer le jeu" (35 ans, ESC et Ec ingénieur), et suggère simultanément l'action et son succès :
"à partir du moment où eux (les dirigeants) l'ont fait, ça va en cascade".(40 ans, ESC)
L'implication induite des membres de l'organisation est importante :
"on fait un effort pour aller à" (35 ans, ESC et Ec. Ing)
"A partir du moment où j'ai la volonté, où j'ai fais valider cette procédure, si quelqu'un sur la route empêche la procédure, les procédures, à ce moment là, ce n'est pas moi qui vais arbitrer, c'est la volonté. Cette volonté est comme une loi. Il n'y a que l'état de droit qui fait la démocratie. Si on veut changer la culture d'entreprise, il faut que la volonté de transformer cette culture soit énoncée." (40 ans, ESC)
"Le dirigeant est une pièce maîtresse car il légitime la démarche, il joue le rôle de médiateur." (BBBBBrusset, Université)
"Il y a l'entonnoir qui est le demandeur principal et après franchi ce cap, ça passe" (33 ans, Universitaire, petit effectif, 2 ans d'exercice)
Ces diverses déclarations laissent apparaître plusieurs choses. Il semble tout d'abord qu'il existe un rapport entre l'émission de cette volonté et le pouvoir d'intervention des consultants. Comme nous l'avons précédemment observé, au cours de certains entretiens en effet, l'accent est souvent mis sur la notion de volonté, de pouvoir, notamment le jeu de pouvoir entre le dirigeant et le consultant; "on peut / on ne peut pas". A partir d'elle, les consultants peuvent travailler, "décliner les actions" (7 entretiens). En cela un lien est également supposé entre la volonté et le comportement. Or, telle que la volonté est décrite, il semble qu'elle représente dans ce cadre particulier qui est l'intervention et dans cet état tout aussi particulier qu'est une entreprise soumise à un audit, ou à un processus de changement, une norme reconnue, à la fois par le dirigeant, son personnel et son consultant, un consensus admis, une réponse momentanément dominante à l'intérieur de l'entreprise. Cette singularité paraît présumer une autorisation, or du fait de l'aspect normatif qu'elle paraît également suggérer, on peut penser que lorsque le dirigeant dit au consultant sa volonté de changer la culture d'entreprise où quelques uns de ses éléments, c'est une manière de lui signifier qu'il lui concède et délègue la capacité de traiter les phénomènes d'influence. Ainsi, cette volonté aurait pour fonction de céder au consultant les instruments de traitement des processus d'influence à l'intérieur de l'organisation auprès du personnel. C'est une des raisons pour laquelle le dirigeant, dans ces conditions est souvent décrit comme "le garant des changements". Il demeure l'instrument de traitement des phénomènes de pouvoir.
Deux raisons font que ce transfert d'une partie du pouvoir du dirigeant s'effectue. La première tient à la position du dirigeant par rapport à la culture d'entreprise. Tel que les consultants le décrivent en effet, il est considéré comme le "maître de la culture", "un levier", "un cas d'exemplarité", "un canevas". Ainsi, comme le précise un consultant:
"Notre premier client étant l'équipe de direction générale, il faut d'abord qu'on comprenne bien leur position, je crois qu'on a beau dire, il y a beaucoup de choses qui se font à l'image de l'équipe de direction. C'est peut-être ça qui remplace la culture d'entreprise. C'est dans la mesure où on a une équipe de direction cohérente, qui est bien liée sur la même vision des choses, on a normalement une entreprise équilibrée. Mais, si on a des guerres de pouvoir c'est sûr et certain que ça ne fonctionne pas très bien entre eux non plus. Donc première chose, c'est de bien cerner la situation en ce qui concerne l'équipe de direction et travailler là-dessus et de toute manière, ça aura des répercussions." (40 ans, ESC et Université, 10 ans d'exercice)
Une position de pouvoir à travers laquelle il est impossible de passer sans cet accord que formalise justement la volonté. Aussi, lorsque des oppositions apparaissent elles peuvent clôre définitivement le contrat entre le consultant et son client:
"L'enjeu c'est quoi ? Nos clients c'est l'entreprise, c'est pas le dirigeant. Donc si c'est peut-être un aspect de la culture de X (nom du cabinet de conseil), la clef de ce qui est à faire, elle est chez le dirigeant. Je dois aller chez le dirigeant et tourner la clef, mon éthique et on parle bien de culture là : c'est de ne pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'a pas à le porter. Donc, il faut que j'aille travailler au niveau qui est le niveau adéquat et s'il est sur le chemin de l'éthique, j'attendrai que le travail soit fait à ce niveau-là. Mais, si le dirigeant ne me reconnaît pas le droit d'aller voir, je veux dire, c'est pas le problème, il ne me paye pas pour ça. Cela nous est arrivé plusieurs fois. Il me semble que pratiquement à chaque fois, on a arrêté de travailler pour cette entreprise." (40 ans, ESC)
Par ailleurs ce pouvoir que figure le dirigeant par rapport à la culture trouve une autre expression auprès des consultants, avec notamment l'analogie souvent faite entre la dirigeant et le statut parental qu'il peut évoquer et représenter au sein de l'organisation. Aussi le changement souhaité auprès du personnel ne peut être prodigué selon les conseillers que si le dirigeant s'engage lui-même car :
"En fait si eux (les dirigeants) ne changent pas de comportement, ben le reste...Le reste des personnes qui travaillent dans l'entreprise ne changent rien non plus! C'est en fait, on se comporte comme on a vu faire. C'est par l'exemple. Si vous donnez un bon exemple, c'est comme dans une famille hein, j'ai des enfants, si effectivement ils voient leur mère débaucher euh, ils vont avoir un petit peu les mêmes tendances peut-être lorsqu'ils seront un peu plus grands. Ben, en entreprise c'est un peu la même chose." (35 ans, ESC et Ec. Ing, effectif 20)
"Je vous explique cela comme une histoire, pour vous dire que aujourd'hui notre métier est de conseiller les dirigeants pour qu'ils soient des dirigeants plus efficaces sur cette partie de leur métier qui consiste à exercer une influence sur les autres, prenant en considération peut-être deux choses: que diriger est un métier. Il n'est pas tout le métier du dirigeant; il peut avoir des responsabilités techniques ou de marketing, mais diriger est un métier et alors c'est plutôt vécu comme un statut ou une fonction. Et ce métier, il fait principalement appel à ce que nous faisons, à nos comportements, le modèle que je suis comme dirigeant, je vais l'être par ce que je fais, plus que je dis d'ailleurs, plus que mes grandes idées, c'est comme un père envers sa fammille si on veut. Et la deuxième dimension, c'est le management, c'est une dimension stratégique de l'entreprise" (40 ans, ESC, 12 ans d'exercice)
Cependant cette position privilégiée et dominante vis à vis de la culture est quelquefois contestée :
"Nous travaillons essentiellement avec la direction générale. C'est une grande nouveauté parce qu'avant la notion de culture était à peine perçue par le D.R.H, maintenant c'est un problème vraiment de direction générale. Même, on travaille avec le directeur général, mais en fait, on doit travailler avec le responsable d'équipes de terrain, parce que celui qui est entre guillemets le "maître" de la culture, c'est celui qui a une équipe, une équipe de terrain, une équipe de base. C'est lui qui peut modifier la culture." (35 ans, ESC, effectif, 25, cabinet :24 ans d'exercices)
La question se pose désormais quant à la raison qui fait que ce travail de fond s'effectue essentiellement pour tous les consultants auprès et au niveau des dirigeants.SCHmit 4
Les bases de l'accord :
"Il faut que l'école de pensée de l'entreprise et l'école de pensée du cabinet ne soient pas diamétralement opposées. Il ne s'agit pas d'être d'accord pour être d'accord, il s'agit de voir si les gens sont prêts à aborder le thème, le sujet d'une certaine façon, puis de partager ça comme valeur de fond" (50 ans , ESC et Université)
"Il faut que s'effectue une rencontre de culture entre le conseil et l'entreprise, comme un fournisseur, et encore, il n'y a pas de sous-cultures ici." (45 ans, ESC)
pouvoir du consultant :
mécanisme de base de ce pouvoir : la certitude, la volonté et l'engagement.
Le processus de ce pouvoir : l'accompagnement :
" C'est un accompagnement. Pour faire bouger une culture d'entreprise, c'est très très, très long. les intervenants extérieurs jouent à mon avis un rôle mineur. Ils aident à initier des actions, à accompagner certaines actions." (40 ans petit effectif, universitaire)
"C'est un accompagnement plus qu'une aide, c'est une médiation aussi. ça se passe, elle se passe très souvent d'une manière transférentielle et donc, je dois être capable d'assumer a priori cet esprit là des choses et l'accompagnement il existe en cela que à chaque fois, mon travail consistera à faire en sorte que le manager puisse analyser la situation de travail le plus réalistement possible et en même temps comprendre les mécanismes du groupe avec lequel il travaille." (40 ans, universitaire)
"Quand je dis aider ou accompagner, ça va plus se passer pour moi dans la pratique professionnelle par un questionnement, ça va passer par des questions, une reformulation, ça va passer par ce que certains peuvent appeler de la non-directivité, je dirai plus, de la non-directionalité plutôt. Donc, mon travail consistera en tant qu'accompagnateur à faire en sorte que ce soit lui qui chemine, non pas moi, donc le travail c'est d'essayer de lui poser des questions qui vont lui permettre peut-être au fur et à mesure d'élaborer lui-même ses propres réponses" (40 ans, universitaire)
"Il faut réapprendre aux gens à faire simple" (50 ans, ESC et université)
Il sert de catalyseur et se définit en tant que tel : "Le rôle de l'intervenant c'est de servir de catalyseur et de régulateur." (50 ans, ESC et université)
"Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas alors qu'on sait pertinemment qu'on doit les faire. Ce qu'on ne sait pas toujours; c'est pourquoi on ne les fait pas. Notre rôle est d'amener les gens là dessus. Et mettre le doigt sur pourquoi il ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est lui faire faire 90 % du chemin. Je ne suis pas gourou, disant, voilà ce qu'il faut faire. Non, notre boulot consiste à les amener sur les mesures des écarts." (50 ans, ESC et université)
Il aide à formaliser la volonté, il a un rôle réducteur : moins de tensions, moins de conflits (35 ans, ESC et Ec. ing), il "gomme les obstacles" (50 ans, ESC et université)
Rôle de tutorat : il aide à ne pas abandonner, à persévérer.
"On est un peu la tierce partie qui met en commun un peu les besoins des uns et les idées de l'autre" (ESC et université, effectif, 25)
2) Le consultant tel qu'il se voit agir et sa position vis à vis de l'entreprise et de la culture d'entreprise.
Les traits psychologiques induits
" C'est une chose innée pour un consultant, il ne va pas passer un temps infini dans l'entreprise; il n'est pas salarié de l'entreprise, il n'a pas le temps de travailler au corps si je peux m'exprimer comme ça. Il va être obligé de très vite comprendre les tenants et les aboutissants". (...) " Alors le problème est d'arriver très vite à une souplesse je dirai d'esprit, il faut avoir pas mal de psychologie: d'abord savoir écouter, écouter les gens de la direction mais aussi le personnel de base."
Analogie avec "le commissaire de police" , "faculté de caméléon" (31 ans, Universitaire)
"je ne crois pas trop à la démarche sur les causes, on travaille beaucoup sur les finalités et les buts. Comme on fait en science. C'est comme un chercheur, en avançant vers la finalité on fait apparaître les causes, si on s'attaque aux causes directement....Nous, on est comme le chercheur, une fois qu'on a trouvé le remède, on trouve la cause. En fait, dans l'événement, je retiens ce qui m'arrange, je mets de coté ce qui me gène, et j'ajoute ce qui me manque." (50 ans, ESC et université)
"Je me considère, je peux me considérer comme un psychanalyste d'entreprise. Cela dit , le propos que je vous tiens, il est complètement opaque au client; c'est-à-dire, ...ce n'est pas une analyse que je fais devant lui, je ..reste plutôt sur une lecture très objective de, entre guillemets, de l'entreprise et des motivations. J'ai donc appris à être caméléon, à cacher une partie de ce qui sous-tend en partie ma démarche. C'est une condition nécessaire pour justement pouvoir travailler correctement" (40 ans, universitaire).
"On n'a pas de titre, ni même de chercheurs et on n'est pas en position d' observateurs. Et donc automatiquement, à partir du moment où on agit, on est un petit peu pervertis par l'action. " (40 ans, universitaire)
"Nous, on est le regard neutre, c'est un regard qui n'a pas d'enjeux personnels particuliers." (ESC et université, effectif : 25)
Les images négatives qu'il faut reconvertir
" Les premiers responsables de la mauvaise communication en entreprise, c'est souvent les consultants qui ont tellement sophistiqué le système. C'est simple ! Plus c'est compliqué, plus ça fait riche, plus c'est cher, mieux ça se vend, c'est complètement fou !" (50 ans , ESC et université)
"Le problème qu'on rencontre, nous en tant que conseil, c'est qu'on nous met d'une certaine manière une auréole autour de la tête; on nous déballe quasiment le tapis rouge devant l'entrée de l'entreprise, ce qui est absolument détestable !". (31 ans, université)
"je ne suis pas gourou" ou "Moi, je ne suis pas payé pour sauver des gens.
Je ne suis pas dieu comme métier" (50 ans, ESC et université)
"Consultant, ça fait riche et plus cher, je préfère le mot intervenant" (50 ans, ESC et université)
B - Participation à la construction des représentations sociales
Jeu mise en situation, discussion et échange, on prend des cas d'école parce que tout le monde comprend et puis on passe à l'entreprise. On détecte ensemble par exemple les interdits, les tabous, les non-dit." (50 ESC et université)
L'intervention se concrétise au moyen de formations de séminaires (35 ans, Ec ingénieur et ESC)
Le processus de déclinaison aux échelons inférieurs : Il s'effectue par l'intermédiaire du dirigeant, qui une fois familiarisé et sensibilisé (prise de conscience) à un certain nombre de problèmes, aide à son tour à la familiarisation et à la sensibilisation aux échelons inférieurs en donnant l'exemple. Cet aspect est ensuite renforcé à l'aide de séminaires de sensibilisation.
Processus en cascade : A partir d'animation de séminaires, de séminaires résidentiels par exemple.
"On travaille à faire descendre leurs manières d'être" (35 ans, ESC, effectif : 20)
Tissage des media, le travail préalable ayant été de déterminer une ligne de parti à partir de laquelle le consultant adapte le discours, c'est-à-dire qu'il tisse dans les média de l'entreprise les stratégies et les politiques qui ont été énoncées, cela en tenant compte de la population ciblée (cf.; problème du vocabulaire).
La culture d'entreprise comme une contrainte :
Un pouvoir est souvent concédé à la culture d'entreprise. Elle apparaît tour à tour comme un frein, une donnée dont il faut tenir nécéssairement compte tout au long de l'intervention.
L'aspect contraignant de la culture d'entreprise est en effet souvent évoqué et se pose à la direction qui l'exprime au consultant, ainsi comme le signale un consultant, au "je veux", s'oppose "ce que je vais pouvoir faire" (40 ans , ESC) .Le "je" en question concerne le dirigeant, qui quelque soit sa force se heurte à la culture du passé, à la réalité. Ici, un certain pouvoir est assigné à la culture qu'il ne s'agit pas de contourner. Une des fonctions du consultant étant sur ce point de concilier ce qui est "incontournable" pour le dirigeant et "ce qui est possible pour l'organisation", donc d'ajuster ces deux contraintes
la crédibilité: "c'est l'autorité au sens de l'auteur" (50 ans, ESC et université), "un individu crédible, et la crédibilité, c'est le fait de respecter quelqu'un même si on n'est pas d'accord avec lui, et à ce moment là, ça peut marcher" (50 ans, ESC et université)
crédibilité : liée à la cohérence entre
ce que l'on va dire
ce qui va se passer dans l'entreprise
Soit entre le "discours", ce qui est dit et les "signes"
Il s'agit de réduire l'écart et de le rendre acceptable e tel est le rôle du consultant.
" Seulement moi, j'ai une perception de l'entreprise qui est une perception conflictuelle et non consuelle. Je pense que les gens ont des intérêts convergents et divergents. Divergents parce qu'ils ont une place différente dans ce système. Et en fonction de cette place, ils ont peut-être des défauts d'optique, donc de représentations, d'attitudes et des projets différents. Et donc mon but c'est négocier la différence au nom d'un intérêt commun." (Brusset, Université....................)
"Créons le plus de cohérence possible" (40 ans, ESC)
"C'est un problème aussi de prendre conscience que chacun, si on veut qu'il soit un acteur, a besoin d'une marge de liberté, sinon, il ne fais que réagir, et non pas agir" (45, Université)
Les recettes : de démarches surfaites de transformation culturelle
" Je me bagarre sur les notions de recettes. Il existe un tas de bouquins sur les recettes, moi je n'y crois pas. S'il y en avait une ça se saurait. Je vous dis ça, parce que c'est une valeur du cabinet de ne pas croire aux recettes." (50 ans, ESC et université, effectif, 6 personnes)
"Il faut avoir une grande souplesse stratégique dans la stratégie d'intervention et non appliquer des recettes à brûle-pourpoint, comme ça arrive. Car malgré tout on ne cherche pas à imposer quoi que ce soit." (38 ans, université, 12 ans d'exercices)
1) LECTURES
| J-J Rousseau: |
Discours sur l'origine de l'inégalité |
| L. Malson: |
Les enfants sauvages |
| C. Lévi-Strauss: |
Les structures élémentaires de la parenté |
| B. Malinowski: |
la sexualité et sa répression dans les sociétés primitives |
| J. Ruffié |
Payot 1932 Dans Le Monde du 21 Décembre 1977 article de J. Ruffié professeur au Collège de France. |