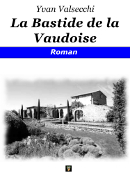La culture d'entreprise et sa représentation sociale
Auteur : Nathalie Diaz
-
I - AVANT-PROPOS
- II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
- III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
- IV - LA VERSION FRANCOPHONE
- A - Les approches et interprétations convergentes au modèle américain
- B - Les résistances : les remises en question et les processus de réappropriation mis en oeuvre
- C - Les modèles implicites de l'organisation
-
V - CONTEXTE D'EMERGENCE
- VI - PRESENCE ET MODALITES
- VII - IMAGE ET STRUCTURE
- VIII - LA PEDAGOGIE
Chapitre IV - LA VERSION FRANCOPHONE
A - Les approches et interprétations convergentes au modèle américain
En définitive, en ce qui concerne le concept de culture d'entreprise, nous nous trouvons en présence de deux courants de pensée, deux perceptions et interprétations qui assignent à la culture d'entreprise des propriétés significatives. Il y a celui qui reprend le modèle américain et qui lui fait favorablement écho et celui qui lui oppose une résistance ou totale ou partielle.
Le modèle culturaliste américain est en effet favorablement reçu et repris par quelques auteurs dont ARCHIER et SERIEYX (1984) qui jugeant le livre de PETERS et WATERMAN "excellent", se font aussitôt, leur porte-parole français et confèrent alors à la culture, conformément au courant américain, un caractère particulièrement pragmatique.
Il s'agit selon eux, d'envisager la culture d'entreprise comme un "outil" de gestion, afin d'accéder à une entreprise du "3e type", adhérente à la fois aux hommes et aux objectifs de l'entreprise résolument tournés vers l'avenir. Pour cela, reprenant les grandes lignes des travaux américains et les adaptant au modèle français, ils prônent le projet d'entreprise (ainsi que les cercles de qualités et les cercles de pilotage) qui doit être partagé, afin de "faire ensemble" en fonction de "valeurs partagées, de règles du jeu, de la culture, des invariants, de la morale et de la règle".
Cette perspective, qui dynamise la culture d'entreprise, dans laquelle et en fonction de laquelle, (comme l'indique l'usage du terme "maillage"), est incorporé un élément supplémentaire et complémentaire qui est le projet d'entreprise, reçoit un avis plutôt favorable auprès des professionnels du conseil. Ces derniers seront une catégorie du public assez parfaitement démarqués de celle des chercheurs. Il semble en effet à ce propos, que le projet d'entreprise et l'adoption du modèle anglo-saxon soit l'apanage des consultants ou professeurs de certaines Grandes Ecoles de commerce telles que l'INSEAD et ESSEC, c'est-à-dire un groupe social très lié avec le monde des entreprises, mais qui cependant n'en fait pas essentiellement partie. Cela tiendrait selon T. GAUDIN, au fait que la culture d'entreprise ait constitué, dans les circonstances particulières du début des années 80, un marché résiduel inopiné et opportun pour les consultants. En effet, les formations et les universités ayant repris en partie en charge la tâche des consultants dans divers domaines (comme l'informatique ou la gestion par exemple), ont déclassé plus ou moins leurs prestations. Ainsi, l'aspect pragmatique de la culture d'entreprise a-t-il été récupéré, par les consultants en général.
Ainsi, sur le terrain, l'intérêt est particulièrement probant, car des dirigeants et des cadres ont aussitôt cherché à "mobiliser leurs ressources humaines". Ils ont eu recours pour cela au projet d'entreprise, dont la vocation était au travers de quelques principes d'action, qui avaient la charge de constituer ou de renforcer la "cohérence" de l'entreprise, de susciter l'adhésion de l'ensemble des membres de l'établissement.
Ce projet d'entreprise, on l'a vu, consiste concrètement en une trace écrite et visible, de références, d'impératifs pour l'action. Il émane en principe de l'institution incarnée par la direction générale et il est communément élaboré. A cela près que, à chaque niveau de la hiérarchie, il existe une participation qui sert à motiver, mobiliser, informer et tester les éléments du projet, quand il ne s'agit pas en définitive de le soumettre à l'acceptation, à l'approbation générale. Quoi qu'il en soit, le projet est théoriquement le résultat de réponses multiples.
Il s'agit dans ce cas de prendre appuis sur la culture, sans, dans le meilleur des cas, cependant la toucher en premier lieu, de mettre à jour ses éléments constitutifs, au moyen notamment de l'audit social. Ceci dans le but d'en tenir compte lors de l'édification du projet et aussi pour le promouvoir et le légitimer. C'est une façon d'endiguer les aspects manipulateurs qu'on lui prête et de consacrer les enjeux du futur au travers du projet et non plus seulement au travers de la culture d'entreprise.
Il se crée donc, une démarcation entre la culture telle que le courant américain l'envisage et telle qu'elle est perçue en France. Car comme l'atteste G. Y., KERVEN (1986), alors Président Directeur Général d'Aluminium PECHINEY, "Ce n'est donc qu'apparemment que le projet reste un discours, ou du moins s'assimile à une réflexion purement théorique. Il n'est pas, comme la culture que l'on a vue en l'occurrence chez EDF, une construction objective vouée à passer par une étape cognitive autonome. Sur le plan du contenu, qui engage l'éthique et la règle de l'action, mais surtout de la forme, le projet d'entreprise a une portée pratique au point de reproduire ce qui fonde la pratique même de l'entreprise en tant que telle".
Ainsi la culture d'entreprise paraît désormais s'élaborer à l'insu du corps social et acquérir par ce fait une intériorité propre où la volonté quelle qu'elle soit n'intervient pas. Ce genre d'intervention étant dévolu au projet d'entreprise.
En résumé, la culture d'entreprise conserve quels traits sui generis, mais en gagne d'autres et donc n'échappe pas au phénomène de distorsion et de supplémentation. Désormais, comme le montre la monographie de M. THEVENET (1986), elle intègre et s'identifie par les fondateurs, l'histoire, le métier, les valeurs et les signes, dont selon le terme consacré on fait le "maillage". Par ailleurs, une des caractéristiques nouvellement plus ou moins directement associée à la culture est le projet d'entreprise.
Nonobstant cette vague d'intérêt, qui néanmoins ne reprend pas dans son intégrité le modèle pionnier, des résistances vont se manifester qui vont non seulement également procéder à des discriminations et des ajouts, des associations nouvelles, mais vont aussi mettre en oeuvre des processus de réappropriation.
B - Les résistances : les remises en question et les processus de réappropriation mis en oeuvre
L'exportation de l'idée selon laquelle chaque entreprise possède une culture organisationnelle à la fois portée par le comportement des membres de l'entreprise et des valeurs unanimes et que cette culture peut allègrement servir et être la base de tout changement organisationnel semble se heurter aux idiosyncrasies de la culture d'accueil. Les controverses sont en effet abondantes, aussi bien en France qu'au Canada d'ailleurs et de nombreux sociologues et chercheurs en organisation ne cessent pas de crier haro sur le caractère paradoxal de la culture d'entreprise promue par le courant pionnier.
Déjà on reproche au modèle américain de confondre beaucoup de choses et de laisser "l'impression qu'il s'agit d'un fourre-tout où s'entrecroisent et se télescopent, pêle-mêle, du leadership, des valeurs, des symboles, des mythes, des légendes, des sagas, des anecdotes, des croyances, des structures, des habitudes, des langages, des rites, des cérémonies, des règles sociales, des normes, des credo, des philosophies de gestion, des savoirs partagés, des façons d'être ou de s'habiller, des déterminants inconscients, etc." (AKTOUF, O., 1990) . Ou plus virulent encore à son propos, la culture d'entreprise serait une manière pour les entreprises d'acquérir magiquement la substance qui leur manque, car comme l'observe F. TORRES (1990), "prise à la lettre, la notion de culture d'entreprise véhicule donc le contraire de ce qu'elle énonce : non plus des valeurs allant de soi, mais le déficit provisoire de celles-ci, déficit ressenti comme tel."
Or, si les attaques et les critiques ne manquent pas, l'intérêt pour la culture d'entreprise ne décroît pas, bien au contraire, elle prend de l'ampleur. L'investissement fourni dans l'effort pour l'adopter ou bien la rejeter est colossal. On lui reconnaît par exemple une certaine réalité, un certain fondement. Dès lors il semble que tout va être implicitement mis en oeuvre pour re-formuler cette notion, l'élaguer de quelques caractéristiques qui auraient tendance à en faire un épiphénomène. Comme elle l'avait fait aux U.S.A, elle va générer une floraison de littératures, de discussions, de commentaires et devenir ainsi peu à peu familière aux chercheurs et intervenants.
D'emblée la confusion inévitable entre la culture et l'identité est constatée et exploitée. Comme le note à ce propos F. TORRES (1990) "On aurait pu choisir la notion voisine d'identité, que certains auteurs proposaient d'ailleurs dès la fin des années 70. (...) Pourtant, c'est le terme de "culture" qui s'est imposé des deux cotés de l'Atlantique". Alors que toujours selon cet auteur, l'identité "avait le mérite d'être infiniment plus précise pour saisir ce qui constitue l'essentiel d'une organisation". Et d'ailleurs à ce propos, que ce soit lors de conférences ou dans les écrits, il est souvent mentionné cette ambivalence entre l'identité et la culture, et il n'est pas rare de voir dans certains intitulés, les deux notions apparaître ensembles, ou l'une au détriment de l'autre (STRATEGOR, 1989, qui jette nettement son dévolu sur l'identité plutôt que sur la culture, envisagée dès lors comme étant l'aspect visible de l'identité). les travaux de R. SAINSAULIEU sont à cet égard significatifs. Ils rendent compte d'une part, de l'entreprise comme espace d'apprentissage culturel, et comme système de rapports entre identités collectives, sous-cultures et projets différents, la question étant pour lui de savoir comment articuler un projet commun tandis que de telles différences sont si prononcées. Selon lui, la construction de l'identité collective importe beaucoup et doit se faire dans la confrontation au coeur des rapports de travail et non pas comme le promulgue les théoriciens américains dans le consensus, en faveur d'une culture dominante.
De telles considérations sous-tendent une analogie entre la culture et le pouvoir puisqu'elle implique en même temps la direction et le personnel (CROZIER, 1977).
Les références à l'anthropologie moderne ne manquent pas non plus pour tenter de démystifier cette culture d'entreprise, qui s'applique, comme l'indique son nom à une entité jugée instable, localisée et récente dans le temps. Pareilles réticences, suivies de nombreuses réflexions vont également prendre corps avec les historiens et les ethnologues.
Ainsi, conformément à cette tendance qui force le modèle français à se construire en opposition au modèle américain, aux disciplines récentes (marketing, gestion...) vont s'opposer les disciplines classiques telles que l'histoire, l'ethnologie auxquelles va peu à peu s'adjoindre l'intitulé de "entreprise". Ne parle-t-on pas désormais "d'historiens d'entreprise", de "sociologues d'entreprise", de "terminologues", de "psychanalystes d'entreprise", d'ethnologie d'entreprise ? Aussi, la culture d'entreprise atteint non seulement l'entreprise elle-même, mais affecte également les disciplines et les sciences et établit parfois des relations entre elles. Tentant par exemple de définir l'histoire d'entreprise, un historien déclare que "on peut définir l'histoire d'entreprise comme une psychanalyse de l'entreprise." Par ailleurs, découvrant que les apports de la recherche en générale, peuvent être d'un grand profit pour les entreprises et leur survie, des relations inter-disciplinaires vont se créées, qui vont réunir des économistes, des historiens, des sociologues, etc. Ainsi, non seulement la culture d'entreprise affecte la science, mais aussi la science, par effet de retour, cherche à affecter l'entreprise, dont sa culture d'entreprise. Peut-être est là l'aboutissement du processus qui fait, comme l'affirme S. MOSCOVICI, que l'objet de la représentation sociale, "cesse d'être ce dont on parle, pour devenir ce à travers quoi on parle". Par ailleurs, comme le rappelle S. MOSCOVICI, "une représentation émerge là où il y a danger pour l'identité collective, quand la communication submerge les règles que la société s'est données". Or n'est-ce pas là ce qui se produit dans ce cas précisément ?
La culture d'entreprise telle que le promulguent les consultants américains, remet en cause, d'une certaine manière, la légitimité des actions, du code d'interprétation ainsi que l'histoire du groupe-cible, en l'occurrence les français, et crée donc des tensions, qui peuvent donc se réduire par l'entremise d'une représentation, qui se forme alors pour obvier la menace, restaurer l'identité mise en question et atténuer ainsi le choc de cette nouvelle conception. De plus, en vertu du pouvoir créateur de l'activité représentative, le groupe menacé, raffermit son identité et trouve dans cette représentation une nouvelle façon de vivre ses interrelations et relation au savoir car, "partant d'un stock de savoirs et d'expériences, la représentation est susceptible de les déplacer et de les combiner".
Un phénomène est à noter également du fait de son ampleur et du sens qu'il paraît sous-tendre. Dans les ouvrages consacrés à la culture d'entreprise, les travaux américains sont légèrement voire, pas du tout évoqués. Dans l'historique proposé il est mentionné les travaux antécédents français, dont notamment ceux de CROZIER (1963, 1977) et ceux R. SAINSAULIEU, qui lui même stipule qu'il y a une double histoire d'intérêt pour la culture à propos de l'entreprise : l'histoire de la sociologie et l'histoire des entreprises. Dans certaines publications, il est instamment signifié que même "si l'on attribue l'origine récente de la notion de culture d'entreprise à des auteurs anglo-saxons, il faut rappeler qu'en 1979 déjà, on parlait en France d'identité d'entreprise". (STRATEGOR, p.464). Ces rappels et omissions ont quelques intérêts car ils semblent dénoter ou paraissent avoir quelques rapports avec ce que K. LEWIN dénomme le "dégel cognitif" qui, survient en présence d'une multiplication de solutions qui rivalisant entre elles, oblige la majorité à "interpréter comme une simple option, préférence ou convention" ce qui était considéré auparavant comme "une certitude, un absolu" (MOSCOVICI, 1979).
Quoi qu'il en soit, comme le suggèrent et le démontrent (AMADO, FAUCHEUX et LAURENT, 1989), ces "rejets" sont avant tout culturels, et rendent compte à leur manière de différences dans les principes organisateurs américains et français et dans la façon de se représenter la notion d'organisation, qui serait de caractère fonctionnaliste pour les américains et personnaliste pour les français. Plus précisément, "les managers américains semblent souscrire à un modèle fonctionnaliste et instrumental de l'organisation, perçue avant tout comme un système de tâches à accomplir et d'objectifs à atteindre". Ce qui a pour conséquence du point de vue du management et de l'organisation, d'être conçus comme des outils tenus de s'adapter aux exigences des situations. Tandis qu'en France, l'organisation est plutôt perçue comme une "collectivité de personnes à gérer"
Cela signifie que la culture d'entreprise dans son appréhension intellectuelle est sous l'influence de modèles implicites de l'organisation comme le montre le tableau I. Ainsi, concernant la culture d'entreprise, et précisément son implantation en France, il ne s'agirait pas simplement d'une constitution purement formelle d'une connaissance, mais bien de son insertion organique dans une pensée déjà constituée.
C - Les modèles implicites de l'organisation
| LA VISION FONCTIONNALISTE AMERICAINE | LA VISION PERSONNALISTE FRANCAISE |
| L'organisation est perçue d'abord comme un système de tâches à accomplir, de fonctions à assumer et d'objectifs à atteindre | L'organisation est conçue en priorité comme un système social réunissant une collectivité de personnes autour d'un projet |
| Structures définies en termes d'activités | Structures définies en termes de degré d'autorité et de statut |
| Positionnement fonctionnel des agents dans la structure | Positionnement social des acteurs dans la structure |
| Une hiérarchie de problèmes à résoudre conduisant à un réseau opérationnel de fonctions dont la responsabilité est assignée à des agents en fonction de leur compétence | Une hiérarchie de personnes à gérer conduisant à un réseau social d'acteurs articulé selon un principe de distribution verticale de l'autorité |
| Le management doit coordonner les tâches et définir les responsabilités | Le management doit coordonner les relations entre les acteurs et définir les zones d'autorité |
| Qui est responsable de quoi ? | Qui a l'autorité sur qui ? |
| L'autorité réside dans la fonction. Elle s'exerce de manière circonscrite, spécifique et impersonnelle |
L'autorité est un attribut de la personne. Elle s'exerce de manière diffuse globale et personnalisée |
| Subordination à l'ordre et à la rationalité de l'organisation | Subordination à la personne du supérieur hiérarchique |
| La "Loi de situation" est censée régir les relations | Les enjeux politiques régissent les relations |
| Les besoins de coordination et de contrôle se traduisent par des systèmes de gestion relativement décentralisés | Le besoin d'arbitrage inspire des pratiques centralisées d'exercice du pouvoir |
| La structure est un outil de différenciation des tâches, un instrument pour la réalisation des objectifs | La structure explicite la différenciation des statuts et reflète la stratification sociale |
Les modèles culturels correspondent étroitement à leur époque. Ils sont l'expression ou différente ou saillante des diverses théories antérieures, formulées autrement du fait du moment et de la constitution nouvelle des groupes sociaux auxquels ils s'adressent et pour lequel ils s'ajustent.
Il n'est pas inintéressant alors, de se préoccuper du contexte d'épanouissement du concept de la culture d'entreprise.