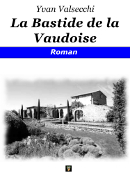La culture d'entreprise et sa représentation sociale
Auteur : Nathalie Diaz
-
I - AVANT-PROPOS
- II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
- III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
- A - Genèse et appropriation : le main stream
- B - Des composantes culturelles définies.
- C - Un modèle critiqué.
-
IV - LA VERSION FRANCOPHONE
- V - CONTEXTE D'EMERGENCE
- VI - PRESENCE ET MODALITES
- VII - IMAGE ET STRUCTURE
- VIII - LA PEDAGOGIE
Chapitre III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
A - Genèse et appropriation : le main stream
1) Un concept activé :genèse et appropriation
Les Etats-Unis sont la référence obligée en matière de culture d'entreprise. C'est là en effet que le concept a été formellement introduit. Il a été d'abord, même si ce point de vue est critiqué, en raison notamment de l'abus d'usage dont est victime le terme de "culture" ( G.L., SYMONS, 1984), évoqué dans les études de sciences administratives, puis en 1980, dans une revue spécialisée dans les affaires intitulée Business Week ( "Corporate Culture; The hard to change values that spell success or failure ).
Cependant le concept de culture d'entreprise doit son intrusion, officielle et unanime, à un groupe de conseillers américains travaillant pour le compte d'un cabinet commun nommé Mc KINSEY. Celui-ci a, effectivement, au travers de ses membres, servi de point de propagation du concept.
- Le main stream : l'instauration d'une culture d'entreprise active
Ce groupe restreint représentant ce que SMIRCICH et CALAS (1987) dans leur étude dénomment le "main stream", s'est attaché à envisager concrètement l'entreprise au travers de ses aspects culturels, aussi bien internes qu'externes, insérant une conception dominante de la culture organisationnelle, selon deux axes.
Leurs travaux se subdivisent en deux champs d'exploration qui intègrent successivement :
- l'approche intra-culturelle d'une entreprise (c'est-à-dire qui considère la culture au sein d'une seule entreprise),
- l'approche interculturelle des entreprises qui fait d'ailleurs notablement écho au management comparé.
l'idée principale est que l'une des clefs de la réussite des entreprises, face aux pressions externes et internes, réside dans l'identification, la mise en place et le développement d'une culture d'entreprise.
Quoi qu'il en soit, les auteurs de ces investigations, appartenant ou étant affiliés au même cabinet de conseil, se rejoignent doublement autour de cette conception unique de la culture. Ils peuvent néanmoins être répartis, de par leurs préoccupations et leurs publications :
- 1985 (1974-1981)La passion de l'excellence Théorie Z: Cercle de contrôle de qualité et introduction d'un type de culture dite Z AUSTIN OUCHI.
- 1982 In Search of Excellence PETERS PASCALE Paradigme de gestion centrée sur les valeurs WATERMAN ATHOS (1978-1981)
- Les 7 clefs de l'organisation, centrée sur les Etude comparative d'entreprises, études intra-muros
- The Art of Japanese managment valeurs partagées et la culture d'entreprise japonaises et américaines études inter-culturelles
Dans ces deux orientations (intra et-inter-culturelles), il est prôné un modèle commun et générique intitulé "Mc Kinsey", connu encore sous le nom de "schéma des sept S", qui résume le système de fonctionnement découvert. Ainsi, il existe d'assez grandes ressemblances entre l'ensemble des ouvrages; The Art of Japanese managment, Théorie Z et In Search of Excellence, parus d'ailleurs presque simultanément. Il semble même que l'un pourvoit à compléter l'autre. Il s'agit en effet de consacrer la culture comme mode de résolution des problèmes inhérents aux entreprises.
La première approche, par exemple, qui traite du management japonais, résulte d'un travail de longue haleine réalisé communément par OUCHI et R. T. PASCALE. Dans leurs travaux, il y est décrit les cercles de contrôle de qualité, et une culture particulière, appelée Z (qui est une sorte de réponse aux théories X et Y de Mc GREGOR) est longuement exposée. Une typologie des cultures d'entreprise est dressée.
Ces diverses investigations, avaient pour objectif de préciser les raisons organisationnelles pour lesquelles, les entreprises japonaises se sont montrées depuis les années cinquante, ère de l'économie managériale, plus performantes que les entreprises américaines. Ne parlait-on pas de "miracle japonais d'organisation" du travail?
Il s'est ainsi avéré que ce succès résultait de la manière d'envisager autrement l'entreprise et était redevable de la considération systématique des différents styles de collaboration.
Les diverses observations réalisées à l'intérieur des entreprises nippones ont permis de dégager le principe selon lequel le bon fonctionnement de l'entreprise dépend de la capacité de la part de l'organisation à appréhender globalement l'ensemble des informations, tout en témoignant d'une flexibilité importante. Cette attention est possible et efficiente que si l'entreprise adopte une culture dite de "clan" (qui se démarque par conséquent des cultures de type "bureaucratiques" jugées statiques et facilement fragilisées devant tout changement ou ambiguïté).
La culture de clan émane de groupes aux caractéristiques bien particulières. Ils doivent être en effet ouverts, consistants et résistants et fonctionner sur la base d'un contrat social. Ils se réunissent autour d'un projet, qui peut être par exemple de nature différente, qui concerne aussi bien la technologie, les services et/ou les biens (etc.). En définitive, ces groupes du fait du style d'attitude adopté, servent de point dancrage à la culture d'entreprise et assurent une diffusion réelle et diversifiée des informations (quelque soit leur degré de complexité), tout en préservant cependant le système général d'une rigidité délétère.
Néanmoins, ce principe repose sur la forme de l'organisation de l'entreprise. Celle-ci selon OUCHI est de deux types, H ou M.
- Le type H (en référence au Holding) est le conglomérat traditionnel ou l'aspect financier est prépondérant. Ce type de configuration se retrouve chez ITT.
- Le type M (multifonctions) intègre une multitude de départements généralement organisés autour d'un pôle technologique de base. On retrouve ce modèle chez les grandes complexes tels que SONY, MATSUSHITA, TOYOTA et IBM.
Or, il existe une importante adéquation entre la culture de clan et le type M de l'organisation. Les entreprises de ce genre, par leur proximité avec les processus de création et d'innovation (du point de vue des produits notamment) savent intégrer les valeurs que ce soit à l'égard de leurs clients ou d'elles-mêmes et ingérer les groupes aux caractéristiques décrites plus haut.
Ainsi, la culture de clan, réside sur une culture commune fondée sur le partage des informations et des intérêts individuels et collectifs, qui oriente les membres de l'entreprise dans le sens de l'organisation.
- l'approche intra-culturelle d'une entreprise (c'est-à-dire qui considère la culture au sein d'une seule entreprise),
- La culture d'entreprise : un concept polarisant
Ces conclusions ne sont pas sans rappeler les travaux effectués précédemment sur le groupe. Ce qui semble valider l'hypothèse selon laquelle le concept de culture d'entreprise est l'expression différente, mais cependant en accord avec l'époque à laquelle elle s'adresse, de certains points théoriques antérieurs. C'est dans cette perspective que se situe la seconde approche, celle qui caractérise la culture d'entreprise elle-même.
En effet, dans l'approche de PETERS et WATERMAN, prenant le contre-pied des modèles rationalistes, et ayant à l'esprit, le management tel qu'il se pratique au Japon, l'observation est faite que les groupes constitutifs des entreprises à succès sont généralement tenus ensemble par les valeurs. Celles-ci sont unanimement partagées et font la puissance d'action de l'entreprise.
"la prédominance et la cohérence de la culture se sont révélé, sans exception, la qualité essentielle des meilleures entreprises. En outre, plus cette culture est solide, et plus elle est dirigée vers le marché, moins les précis de politique, les organigrammes, ou les procédures et les règles détaillées sont nécessaires. Dans ces entreprises, tous les employés savent ce qu'ils ont à faire dans la plupart des cas de figure parce qu'ils disposent de quelques valeurs-guides très claires."Ainsi, la performance passe en priorité par l'action déterminée par tout un ensemble d'éléments culturels qui comprend en premier lieu les valeurs, puis les images. Un lien est directement constaté entre la productivité et le sens attribué aux individus eux-mêmes en qualité d'employés et d'acteurs.
De cette manière, la démonstration de l'efficacité de la culture a pour point de départ ce pour quoi n'importe quelle entreprise se soucie en premier lieu, l'action (soit un comportement qui va dans le sens de l'entreprise). C'est dire que l'ouvrage dans son ensemble, aborde et se consacre ouvertement et concrètement à la question fondamentale que tout manager et sociologue des organisations se pose à savoir l'implication positive des individus dans le travail.
La "solution" proposée accorde à l'action achevée, par le biais d'une culture "gagnante", une attention particulière. Ainsi, il importe qu'elle soit non seulement signifiée, mais en plus sensée et manifeste. Cela est possible si elle est accompagnée dans son environnement de certains signes facilitateurs et solliciteurs. Il s'agit en définitive de partir de l'individu, de ce qu'il a dans sa tête, pour le conduire vers le groupe puis l'entreprise.
Ainsi, la culture induit des attitudes qui encouragent l'action. Il importe donc que sa base soit essentiellement cognitive. Elle l'est, car, la croyance qu'elle fixe dans l'esprit des individus sert de prédisposition au comportement, qui à son tour les pousse à croire à ce qu'ils font. Par conséquent la culture a pour mission de pourvoir aux processus d'identification, de gratification et d'encouragement du personnel. De nombreux exemples concrets et de nombreuses anecdotes étayent ce principe. Il s'agit en particulier de veiller à singulariser l'individu, à le confondre avec un tout qui consacre l'entreprise, d'où l'importance des rituels, des symboles et des valeurs et la nécessité de leur cohérence. Celle-ci est le fait des dirigeants qui doivent exercer un leadership transformationnel qui intervient,
"quand une ou plusieurs personnes s'engagent avec d'autres d'une façon telle que chefs et suiveurs atteignent en se stimulant mutuellement des niveaux de motivation et de moralité plus élevés. leurs desseins qui ont pu naître séparément mais être cependant apparentés, fusionnent par le biais de ce mode de leadership (...) qui élève, mobilise, inspire, exalte, exhorte et évangélise".Ainsi le lien entre culture et pouvoir est manifeste.
Cette modélisation de la culture d'entreprise, telle qu'elle est présentée dans cet ouvrage (et ceux qui résultent du même courant), est tirée du réel, du quotidien, dans les entreprises dites "à succès", et apparaît comme une notion a posteriori. Néanmoins, les auteurs l'ont entérinée en consultant les sociologues des organisations comme BARNARD et MAYO. Ainsi la culture d'entreprise doit son extraction à la fois à l'expérience et aux formulations théoriques antérieures. Ce sont les conseillers en entreprise qui ont pourvu à leur combinaison et ont donné à la culture d'entreprise un sens la rendant vis à vis de ses membres, signifiante.
Signifiante et identifiable, c'est là un facteur important, tant il est précisé que la performance d'une entreprise dépend d'une culture reconnue, reconnaissable et également modulable.
B - Des composantes culturelles définies.
Les composantes culturelles sont expressément définies. Selon le modèle proposé par PETERS et WATERMAN la culture d'entreprise intègre en effet, "les concepts directeurs et les valeurs partagées" c'est-à-dire des Shared Values,pour W. OUCHI, elle combine, la tradition, le climat et les valeurs. Ces dernières constituent le caractère dominant, le noyau de la culture.
C'est en effet autour de ces valeurs partagées que gravite et s'imbrique le système tout entier, comme le figure à ce propos le schéma évoqué plus haut et pour lequel s'est engagé l'ensemble de ces recherches: le modèle Mc KINSEY avec ces "sept clefs de l'organisation", pivots et leviers indispensables pour assurer le succès général de l'entreprise.
Pour bien comprendre en quoi consiste ces composantes culturelles il est important de s'imprégner de ce qui constitue à la fois son essence et sa fin. C'est-à-dire d'expliquer le modèle en lui-même, ainsi que sa dynamique, sans lesquels il est difficile d'embrasser les raisons qui ont fait le succès de cette approche et donc indirectement le processus par lequel les lecteurs d'alors ont intégré cette nouvelle notion.
1) L'émergence d'éléments culturels prépondérants : le modèle Mc KINSEY
Ces sept clefs (dites de l'organisation) résument les éléments prépondérants de la culture d'entreprise qui trouve une forme de récapitulation sous le vocable générique et central de "Shared Values". Les six autres variables satellisées autour d'elles et elles-mêmes interdépendantes, sont,
- la structure,
- le style,
- le staff (la nature des personnels),
- les skills (la compétence),
- la philosophie d'entreprise, ou objectifs supérieurs (superordinate goals)
- la stratégie.
L'ensemble est tenu de s'organiser avec harmonie et cohérence (c'est le "wa" Japonais). Cela présuppose l'harmonie de la culture d'entreprise et projette l'image d'une culture idéale et bienveillante.
Les auteurs visualisent et schématisent cette relation d'ensemble sous la forme d'un hexagone, qui comprend deux zones dichotomiques parfaitement délimitées :
- un espace chaud
- un espace froid.
Plus exactement le "triangle froid" et le "carré chaud".
Les structures, stratégies et systèmes appartiennent au triangle froid, tandis que ce qui compose la base de l'hexagone est constitutif du carré chaud. Chacun de ces espaces ont des typologies, des valeurs culturelles qui les caractérisent. Ainsi, le triangle froid a des déterminants spécifiquement liés à tout ce qui a trait à l'analyse, la quantité, le contrôle, tandis que le carré chaud comporte des caractéristiques plus mobiles, plus en rapport avec les ressources humaines, telles que l'interprétation, la verbalisation, l'évaluation et la coopération.
Entre ces deux espaces réside une tension qui déséquilibre le système, il importe de les considérer comme des espaces complémentaires l'un à l'autre, et donc de cesser de les opposer systématiquement. Cette attitude selon ATHOS ne peut être effective qu'avec la collaboration des instances de direction "inhérentes dans leurs valeurs". Elles sont à même de combiner, de concilier et donc d'harmoniser les zones en apparence antagonistes. Ce procédé est déterminant, et a beaucoup séduit.
2) Une culture harmonisante
L'harmonie préconisée doit son existence à une culture soutenue par tout un ensemble de valeurs, de mythes, de rites et par les hommes eux-mêmes qui se sont, par exemple, singularisés (comme souvent les fondateurs) et qui atteignent un statut exemplaire, désignés alors comme des héros, régulièrement célébrés.
Les valeurs, servent de tuteur à l'entreprise, elles sont censées exprimer les idées, les croyances, la philosophie et le credo du groupe. Elles sont énoncées explicitement et implicitement, le comportement adopté contribuant énormément à éclairer concrètement quelques uns de ses aspects. De telles caractéristiques prouvent la force du lien entre les valeurs telles qu'elles apparaissent et l'action, plus précisément l'action participative et normative. Les normes, les règles et les procédures existent, pour satisfaire le besoin de références et induire des comportements lors de situations ambiguës. Il s'agit en conséquence, de procédures d'influence vis à vis des individus.
Seulement, il apparaît que le facteur relatif à ambiguïté de l'environnement qu'il soit interne ou externe n'ait pas la prépondérance qu'on veut lui prêter, tant est évident le caractère consistant (au sens où l'entend S. MOSCOVICI, 1979) des valeurs promulguées.
L'établissement factuel, d'un rapport entre les valeurs et le comportement est bien réel, (et non pas entre le pouvoir et ces mêmes valeurs), comme l'indiquent ces formules tirées de quelques entreprises, telles que SONY, IBM, CARNAUD, McDONALD'S, KODAK-PATHE et OLIDA contenues dans les plaquettes de présentation généralement remises aux nouveaux recrutés, quand elles ne figurent pas, bien en évidence, sur les murs des établissements, dans les couloirs ou les bureaux.
Ce qui est conçu et défini comme étant du ressort de la culture d'entreprise ressemble à une série de descriptions subjectives et inclusives de l'entreprise, de l'organisation. Par ailleurs, telle qu'elle se manifeste, et telles que le laissent présager les affirmations à son propos, la culture d'entreprise s'avère comporter des caractéristiques et des propriétés qui ne sont pas éloignées de ce que l'on entend pas représentation sociale.
La culture d'entreprise, telle qu'elle s'énonce et telle qu'elle transparaît en effet, est supposée résumer une forme de connaissance, une représentation, qui sont comme le précise S. MOSCOVICI, "une des voies de saisie du monde concret, circonscrite dans ses fondements et circonscrite dans ses conséquences".
De plus, elle est entendue comme étant socialement élaborée et partagée, constituée à partir d'expériences, de savoirs, de modèles de pensée. Ses visées pratiques ne font pas de doute, puisqu'elle dirige et oriente les attitudes (elle "prépare" en cela à "l'action") et cherche à maîtriser l'environnement aussi bien interne, qu'externe (la définition de SCHEIN en témoigne). Finalement, comme elle le laisse entendre, la culture d'entreprise conspire à établir une vision de la réalité commune à ses destinataires, qu'ils soient à l'intérieur de ses murs ou à l'extérieur. En outre, et c'est un point pour et contre lequel s'anime l'ensemble des débats qui l'entoure, la culture d'entreprise, n'a pas pour dessein de reproduire des attitudes et n'est pas en cela fixe et statique. Au contraire, elle est par essence dynamique, de par les messages qu'elle divulgue et sa constitution intrinsèque. Elle atteint l'individu au travers des items d'information, c'est-à-dire des informations que l'individu reçoit de ses sens, qu'il recueille au cours de son histoire et qui demeurent dans sa mémoire : des informations qui proviennent des interrelations. La culture d'entreprise propose ainsi un modèle implicite de l'action collective et de l'homme face à son action, vis à vis notamment des incertitudes et des imperfections qu'il peut rencontrer. Elle vise ainsi à solliciter et susciter les comportements et à recréer également, d'une certaine manière, l'environnement.
Cette conception est discutable, tant la frontière est floue. Cependant il est vraisemblable que la culture d'entreprise n'a pas pour seule mission d'attribuer des images fortes, figées de l'organisation, et de constituer un réservoir d'opinions positives à son égard et à l'égard de l'entreprise à laquelle elle se consacre, elle cherche également à donner une sorte de "théorie" globale de l'entreprise concernée. C'est une des raisons pour laquelle il est conseillé aux dirigeants d'aider à la reconstruction commune (au moyen de concertations et de participation active des membres de l'entreprise), de la culture et de la remodeler.
Une des faiblesses dénoncée et conséquente à cette mainmise volontaire des dirigeants est sa finalité. Elle sous-tend comme le montrent les plaquettes, les slogans et les "bibles " les objectifs quantitatifs et qualitatifs manifestes de l'entreprise. De plus elle paraît résider en premier lieu dans la tête des managers et des dirigeants. Cet aspect et constituant de base de la culture d'entreprise, dans sa version américaine, auquel selon les détracteurs, est sous-tendu un caractère manipulateur néanmoins patent, est contesté. A tel point que la culture d'entreprise est parfois désignée sous le terme de "arsenal managérial", de "idéologie managériale", ou de "mode managériale".
Son aspect gestionnaire dérange beaucoup et sert de point de dissociation et de divergence entre les différents courants culturalistes américains et français.
Néanmoins la variable "pouvoir" a été explicitement introduite dans le modèle proposé par MUMBY (1988) pour lequel la culture d'entreprise est dépendante du pouvoir en place, et contribue à normaliser les idéologies organisationnelles issues du pouvoir. Elle sert également, de courroie de transmission de ces mêmes idéologies aux structures organisationnelles qui s'interprètent selon les schémas implicites qu'elles instaurent.
Bien qu'il existe une grande diversité dans la description des composantes de la culture, et qu'elle ne se réduise pas à un système de valeurs et d'attitudes figées, il serait délicat de dresser un répertoire des autres éléments culturels. Cependant ces éléments, tel que le courant dominant les envisage et les privilégie importent d'être pris en compte.
Ainsi, ce que les américains entendent par culture d'entreprise comprend essentiellement :
- Les valeurs : c'est-à-dire des idées, des croyances partagées, qu'elles soient déclarées ou non-dites, le credo d'entreprise. Elles sont en général intégrées au sein du discours, promulguées au moyen de supports de communication classiques tels que les livrets, les manuels remis généralement aux employés, avant d'être approfondies à l'aide de séminaires. Elles sont à décrypter au travers de mille signaux.
THEVENET (1985) distingue à ce propos trois niveaux. Selon lui, il existe- des valeurs déclarées, dont les traces sont visibles sur les documents officiels, les discours de l'aval et la communication institutionnelle externe.
- des valeurs apparentes, notamment dans le choix des "héros", des dirigeants, dans le choix de "ce que l'on estime être une réussite"
- des valeurs dites opérationnelles qui se retrouvent dans certaines procédures de gestion, d'évaluation budgétaire, comme par exemple chez SCHLUMBERGER, avec le Yellow book, la bible, c'est-à-dire le livre de comptes mensuel remis par chaque responsable à son supérieur avant le 4 du mois suivant, et estimant les résultats du mois. Ce même tableau de bord complet est nommé "green book" aux échelons inférieurs et devient de proche en proche, le "yellow book".
- des valeurs déclarées, dont les traces sont visibles sur les documents officiels, les discours de l'aval et la communication institutionnelle externe.
- Les rites et les rituels de l'entreprise : c'est-à-dire "des activités de tous les jours, systématiques et programmées, dans la compagnie". Ils ont pour fonction de "développer le sentiment d'appartenance, de donner de l'importance aux événements qui véhiculent les valeurs pivots et de fixer la culture pour éviter qu'elle ne fluctue au gré des modes".
Traditionnellement, comme le note S. MOSCOVICI (1988),
Concrètement, ils se manifestent dans les attitudes, tant verbales que gestuelles et s'expriment au travers de repas, de célébrations à l'occasion de départs à la retraite, de promotions et d'anniversaires (comme Mc DONALD'S qui organise chaque année, le premier vendredi d'octobre, la Journée du fondateur) et sont surtout visibles lors d'intégration de nouveaux membres, qui entrent ainsi en religion. Car comme le note la charte des ressources humaines de BOUYGUES,
Ainsi des parcours d'intégration, auxquels personne n'échappe, sont scrupuleusement organisés. Ils peuvent surprendre mais révèlent au personnel par le biais du vécu et de l'expérience, l'état d'esprit de l'entreprise.
Par ces rites initiatiques et intégrateurs (et d'exclusion), d'après le responsable du département des ressources humaines de ERNST X YOUNG CONSEIL,
De tels procédés qui ressemblent à un apprentissage, ou bien à un processus d'acculturation, peuvent fournir prétexte à trier plus en profondeur les salariés, jugés non plus alors sur leur qualités professionnelles, mais en fonction d'une allégeance à un ensemble de signaux d'identification.
- Les symboles : Ils concernent aussi bien la tenue vestimentaire, la dimension des bureaux, le mobilier, les récompenses, les insignes qui démarquent les personnalités, les statuts, que les logos. Ils signifient explicitement de part les signes et codes qu'ils contiennent de quoi il retourne exactement dans l'organisation et sont, si possible, en cohérence avec la culture qu'ils reflètent et médiatisent. Ainsi, un auditeur de Arthur ANDERSEN, se rappelant que le Logo de la société représente deux portes fermées, conclue que "ce n'est pas un hasard, il faut se débrouiller seul, personne ne se connaît, ne se salue !".
- Les mythes : selon D. PEMARTIN (1990), "le mythe correspond à une représentation mentale schématique, à une évidence trompeuse. C'est une simplification de la réalité ayant un caractère non objectif. (...) De ce fait, ils éloignent de la compréhension véritable en fournissant des explications tautologiques".
Il s'agit d'histoires, d'anecdotes qui relatent des faits significatifs. Selon PETERS et WATERMAN (qui reprennent les conclusions de P. SELZNICK) ils jouent un rôle important dans la transmission des valeurs, car
Ainsi, les mythes racontent la naissance de l'organisation et mettent l'accent sur le rôle du fondateur, qui parti de rien aboutit à l'excellence et la suprématie. Ils rendent compte également d'événements importants sans lesquels l'entreprise n'aurait pas vu le jour. Ainsi, par exemple, dans le groupe Elf-Aquitaine, il est fait cas de la découverte du gisement gazier de Lacq qui a occasionné la création de la Société nationale des Pétroles d'Aquitaine, (ancêtre d'Elf-Aquitaine), et en ce qui concerne SAINT-GOBAIN, le rapport avec les manufactures royales et Louis XIV, avec tout ce que cela implique, est vivement cité.
Il arrive aussi parfois que les mythes mettent en scène des hauts faits, dans lesquels sont impliqués quelques hauts personnages de l'entreprise, dans le but d'entériner la cohérence pratique des valeurs prônées et d'affirmer le pouvoir de référence des leaders, comme la célèbre anecdote d'IBM, avec son Président Thomas WATSON, figure importante de la culture d'entreprise, qui se voit catégoriquement refuser l'entrée de sa propre firme par le portier de l'immeuble sous prétexte qu'il ne porte pas le badge obligatoire, cela, en dépit de ce qu'il ait été au préalable reconnu.
En définitive, selon BOJE,D., FEDOR,D. et ROWLAND,K., (1983), les mythes au sein de l'entreprise ont pour fonction de rationaliser, de valoriser, d'identifier ou de distancer et d'établir un lien entre l'aspect subjectif de l'entreprise et son aspect objectif.
- Les héros : ou "Champions", ils sont le pilier de la culture, son expression vivante. Au travers d'eux, il est implicitement espéré que leurs attitudes retentissent sur l'efficacité de l'équipe et qu'ils assistent le réseau culturel en pourvoyant à la cohérence et à l'interdépendance des autres éléments culturels. Ainsi, il existe deux catégories de héros, les héros acquis et innés.
Il y a en effet, ceux qui sont les héros de la situation, qui pourvoient, de par leurs actes, à l'excellence, c'est-à-dire ceux qui "fabriquent, vendent et assurent le service des produits" (DEAL et KENNEDY, 1982) et qui dans une situation donnée ont fait preuve de vaillance et de performance et ceux qui, du fait de leur rôle antérieur, le sont naturellement et légitimement. Cette catégorie concerne en général, les fondateurs de l'entreprise ou ceux qui ont réussi, au moment de l'acquisition de l'entreprise, par exemple, a faire face à un défi en l'apparence impossible à relever. Ces deux catégories concourent à servir de catalyseur de la culture d'entreprise.
Les différents composantes culturelles telles qu'elles sont décrites ici, concernent celles que les auteurs américains privilégient et sur lesquelles ils mettent particulièrement l'accent. Leur description est difficile tellement le réseau culturel est serré. Quoi qu'il en soit, il ressort cette impression selon laquelle, chacun d'eux a pour mission d'assurer la flexibilité et la performance en toutes circonstances.
Toutes les composantes culturelles sont effectivement liées les unes aux autres, comme l'explique le schéma directeur des sept S. Chacune d'elle est traversée et dynamiquement maintenue par ces Shared Values qui "sans" prescrire (parce que traduisent une communauté de valeurs) et "tout" en (de part, leurs énonciations concrètes, qui semblent consister en une série d'injonctions) prescrivant le comportement à adopter, fondent le système tout entier.
En définitive, même s'il est très décrié, il est important de prendre en considération ce modèle pionnier et annonciateur du concept de la culture d'entreprise car c'est à partir de lui qu'a débute le processus de récupération de l'aspect culturel des organisations par les professionnels du conseil et que s'est organisé au fil des ans, un corpus de connaissances sur ce thème. De plus, et ce résultat n'est pas négligeable, il a largement contribué à faire de l'entreprise un concept plus global, au point de parler désormais "d'entreprise sociétale", "d'entité sociale", capable de sécréter ses propres références, ses propres coutumes, etc. Une telle formulation a contribué à déplacer, dans les débats publics, le centre d'inertie de l'entreprise. Celui-ci ne semble plus seulement avoir trait à la traditionnelle scission personnel, encadrement ,il concerne désormais la qualité de l'entreprise, (comme on évoque la qualité de la civilisation). Ce qui tend à marquer un certain changement dans la façon de considérer l'entreprise qui se métamorphose ainsi en institution.
En outre, une des caractéristiques marquantes de ce "main stream", en la matière, est qu'il sert fréquemment d'arguments positifs et négatifs dans tout débat organisé autour de la notion de culture d'entreprise.
C - Un modèle critiqué.
On peut d'ores et déjà noter la pertinence du processus employé pour assurer d'une part l'intelligibilité de cette notion singulière et pour divulguer les théories culturelles. Il s'annonce au travers de constats concrets longuement étayés et commentés, et se renforce par la théorie classique. Ainsi, il n'existe pas de démonstration scrupuleusement rigoureuse. L'ensemble de ce qui compose cette nouvelle théorie consigne en effet des termes qui plus que font appel au raisonnement, cherchent à atteindre, pour qui le lit, le domaine de la croyance. Comme en témoignent le ton général, les références philosophiques incessantes (E. BECKER, en ce qui concerne l'ouvrage de PETERS et WATERMAN). De sorte que les modèles exposés donnent l'impression qu'il faut y croire pour que qu'ils marchent, et d'ailleurs cela pourrait expliquer l'opposition européenne à ce propos.Un modèle critiqué.Un modèle critiqué.
Par ailleurs, l'accent est mis sur le primat de l'expérience. Il ne s'agit plus de prendre l'organisation comme un laboratoire afin d'effectuer des expériences in-vitro, mais de se mettre à l'écoute de l'entreprise, dont celles qui réussissent, de l'examiner fonctionner au quotidien et lui donner la parole. Ces mesures ont énormément contribué à séduire le lectorat professionnel, dont précisément les chefs d'entreprise et les cadres. De plus le modèle proposé comporte une perspective éminemment béhavioriste, il s'agit de faire, d'agir en conséquence, qui plus est.
C'est en cela que réside le mode d'appropriation de la culture d'entreprise par les consultants. Leurs démonstrations comportent en effet peu de spéculations théoriques. Elles s'appuient et rendent compte en premier lieu de la réalité que le concept préconisé éclaircit et concretise. Par ailleurs, la culture d'entreprise est énoncée, selon les auteurs, en réaction aux multiples théories antérieures, qui écartent donc d'emblée délibérément toute perspective spécifiquement scientifique.
De plus, un élément a grandement facilité la pénétration et l'intérêt du concept auprès du public, c'est l'existence d'une vision commune et homogène des spécialistes américains. Ainsi, sitôt paru le livre promoteur, il a reçu un accueil favorable auprès des théoriciens de l'organisation, qui l'ont exploité plus en profondeur (cf. WEICK, FROST et MORGAN). C'est sans compter sur le rôle de la presse spécialisée qui a repris à profusion le concept donnant lieu à de nombreuses concertations.
Quoi qu'il en soit, les réserves et les critiques (vastes et nombreuses), dans l'ensemble s'accordent à relever principalement dans cette perspective culturaliste américaine deux grands défauts.
Il lui est ainsi reproché d'une part, de faire de la culture d'entreprise une variable manipulable, et d'autre part, de sous-tendre l'existence d'une culture unique identifiable dans l'organisation, partagée à l'unanimité, aussi bien par les gestionnaires, que par les salariés de base et qui peut être ou bonne ou moins bonne (PETERS et WATERMAN) ou forte ou faible (DEAL et KENNEDY).
Par ailleurs, son caractère superficiel et auto référentiel dans l'identification, l'énonciation et la dynamique des éléments culturels est également très contesté, comme le notent ALVESSON (1986), et P. N. DENIEULL (1990), pour qui, "le gestionnaire donne au projet d'entreprise la valeur de mythe bien qu'il n'ait pas sa force de conviction mais certains de ses attributs". Ces quelques controverses résument en partie l'aspect polémique de la question, tel qu'elle apparaît de l'autre coté de l'Atlantique.
Dans la perspective française, (il serait plus juste de dire francophone, tant les travaux canadiens abondent dans ce sens également, avec, autant, sinon, plus de ferveur), les choses vont autrement.
La pensée et la perception de la culture d'entreprise semblent en effet s'organiser autour de positions "contre" ou en "faveur" de ce que le courant intitulé alors "américain" ou "venant d'Amérique" propose. Et à ce titre, on peut observer combien la critique du concept de la culture d'entreprise sous-entend également, en même temps, une critique de la société américaine en général. C'est-à-dire, qu'il semble que ce sont les traits culturels spécifiquement américains de la culture d'entreprise qui recueillent les objections dont, sans doute, par exemple, les fameux "here and now" et "self" américains qui annulent d'une part toute imbrication historique et aident au déploiement d'une morale contractuelle. Cependant, il ne s'agit pas pour les chercheurs et gestionnaires français de donner une opinion favorable ou non sur la culture d'entreprise, il s'agit plutôt à partir de cet élément de départ que constitue l'approche culturaliste anglo-saxonne de la culture, d'établir un rapprochement direct avec cette notion dans l'environnement qui est le leur, de le confronter et de le modeler en conséquence. Cela se ressent notamment dans les colloques et les communications écrites sur le thème de la culture d'entreprise, qui montrent que "les idées ne sont plus perçues comme les produits de l'activité intellectuelle de certains esprits, mais comme les reflets de quelque chose d'existant à l'extérieur" (MOSCOVICI, 1976). Et d'ailleurs cette mise à l'écart, voire ce rejet de l'approche pionnière de la part de ses épigones français, justifie ce détachement envers l'attitude d'expert qu'incarne le courant américain. A son propos, n'a-t-on pas en effet parlé de "nouveaux gourous" de l'entreprise, de "gestionnaires", "d'ingénieurs culturels" (CHANLAT, J.F., 1989) de "cultural designer" ?
Ainsi, dans ce qui constitue la version française et plus généralement encore francophone de la culture d'entreprise, par rapport à l'énoncé original, du fait justement de ce rapport direct avec la culture d'entreprise, certains éléments sont retenus, d'autres catégoriquement exclus. C'est de cela dont il est question dans ce chapitre.