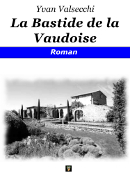La culture d'entreprise et sa représentation sociale
Auteur : Nathalie Diaz
-
I - AVANT-PROPOS
- II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
- A - Avant propos
- B - Une formalisation première par le Tavistock Institut of Human Relations.
- C - Un concept initialement diffus.
- D - Une extension rapide du concept de culture d'entreprise.
-
III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
- IV - LA VERSION FRANCOPHONE
- V - CONTEXTE D'EMERGENCE
- VI - PRESENCE ET MODALITES
- VII - IMAGE ET STRUCTURE
- VIII - LA PEDAGOGIE
Chapitre II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
A - Avant propos
1) Un essor récent
Dans les années soixante et soixante-dix, les entreprises sont devenues conscientes de l'utilité d'un nouveau type de rapport avec ses éléments composites, qui mette en valeur non seulement un produit particulier pour accroître les ventes, mais l'entreprise elle-même. C'est la culture d'entreprise (appelée parfois "corporate culture" par les spécialistes). Elle utilise un ensemble d'outils très divers. Quoique difficilement quantifiables, les bénéfices attendus de la culture d'entreprise sont nombreux.
L'image de l'entreprise peut avoir des retombées sur l'ensemble des produits qu'elle vend. La culture d'entreprise est donc complémentaire de la communication et de la publicité. Elle facilite aussi le contact avec ses différents partenaires politiques et commerciaux. Elle permet de répondre aux critiques de l'entreprise lancées par les défenseurs de l'environnement et par les syndicats. Elle rejaillit enfin sur l'ensemble des personnels, qu'elle valorise. La culture d'entreprise, après s'être surtout orientée vers l'extérieur, se préoccupe aussi de communication interne. Cette étape de l'envahissement des pratiques de communication date des années quatre-vingt. Au-delà de l'entreprise commerciale, c'est l'ensemble des institutions publiques et privées qui est aujourd'hui gagné par le processus. Aux côtés des entreprises privées, les grands services publics se penchent aussi sur la qualité de leur culture.
2) Les fondements théoriques de son essor
Les productions théoriques concernant la culture d'entreprise sont nombreuses et échelonnées dans le temps (elles ne se réduisent pas à une décennie). Et chacune d'elles rend compte, successivement :
- d'une saisie du concept,
- d'une organisation de ses éléments constitutifs,
- d'une tentative de définition.
Toutes ces théories, témoignent de la part des spécialistes des sciences de l'organisation de plusieurs préoccupations interdépendantes les unes aux autres.
Elles attestent de la mise en place progressive d'une forme de connaissance qui lie le concept d'organisation à celui de culture, afin de préparer un terrain propice à l'émergence d'un concept englobant, d'un paradigme, voire d'une "science" nouvelle intitulé "culture d'entreprise" qui apparaît formellement au tout début des années 80, soit à peu près un peu plus d'une trentaine d'années après tout ce travail d'approche et de familiarisation tacite préalable.
Toutes ces théories apparemment disjointes et dissemblables se rejoignent du fait de la nature du problème pratique auquel elles se consacrent toutes, sans exception. En effet, elles semblent se resserrer unanimement autour d'une même question, d'une même préoccupation, qui consiste à déterminer ce qui hors des aspects purement économiques et technologiques, pousse avantageusement au travail. En effet, comment impliquer davantage les salariés dans un cadre donné au mouvement d'action limité ?
Cette question principielle qui anime toute la sociologie des organisations induit dans les réponses apportées des modifications dans la manière de penser, de concevoir et de conceptualiser l'organisation et ses attributs, qu'ils soient structuraux ou humains. Ainsi, en ce qui concerne la culture d'entreprise, il faut l'envisager certes comme une résultante, une saillance finale de toutes ces investigations théoriques, mais il faut également la placer dans un cadre plus pratique qui tient compte de son contexte d'épanouissement. A cela près, la culture d'entreprise figure un type de "réponse", en apparence distinct des productions théoriques et empiriques antérieures, tout en demeurant néanmoins dans une même lignée de perspective. De cette manière, la culture d'entreprise semble être une formulation différente, du fait de l'époque à laquelle elle s'applique et se réfère, d'une seule et même "idée" qui parcourt toute la sociologie des organisations, parce que la question de base reste fondamentalement la même et imparfaitement résolue. Ainsi, la culture d'entreprise s'offre comme la présentation d'une idée identique dans une forme sensible qui est variable et propre à chaque période. Ceci s'observe sensiblement, si on découpe et parcourt la manière dont l'organisation est tour à tour appréhendée et abordée au fil des décennies. L'organisation est évoquée, au travers et par l'étude successive de ses structures, avec la vision Taylorienne et le modèle weberien, de ses éléments constitutifs dynamiques tels que les groupes et la vie sociale, c'est-à-dire l'étude des besoins individuels, des motivations, des systèmes de régulation, d'interaction (avec l'école des "relations humaines"), pour être ensuite examinée sous un angle beaucoup plus politique, systémique, psychologique et psychanalytique ( avec les travaux de W. BION et de E. JAQUES) avant d'être finalement approchée au travers de la culture.
Ce processus justifie cette particularité troublante et paradoxale qui caractérise cette notion aussi vivement débattue à laquelle s'ajoute cette impression qu'elle donne d'avoir soudain été propulsée dans le monde du travail lui-même, à la fois empiriquement et théoriquement.
3) Une apparition brutale et diffuse.
Cette brusque apparition caractérisée par une propagation et diffusion intensives auprès du public -le livre intitulé In Search of Excellence de T. PETERS et R. WATERMAN qui a pourvu à son émission dans le sens commun a connu un vif succès en librairie et le concept est désormais l'un des plus commenté du management actuel- a semblé non seulement introduire une nouveauté quant à la façon de voir l'entreprise mais a aussi donné à la voir selon une signification, par ce fait établie. Ainsi, l'entreprise est envisagée comme ayant et étant une culture. Ce qui en quelque sorte témoigne déjà de l'interchangeabilité du concept et de la perception.
Cette exploration de l'évolution théorique (qui sous-tend les préoccupations concrètes) qui a permis l'essor du concept n'a pas la prétention d'être exhaustive. Elle pourrait inclure toutes les tendances et attaches théoriques mais, dans un souci de clarté et de précision, cette tentative de synthèse ne retiendra que celles qui sont les plus courantes et les plus significatives par rapport au problème qui nous intéresse.
L'accent sera mis simultanément, sur ce long processus de rapports, d'appropriation et d'investissement de la culture (bien avant son expression formelle) par la sociologie des organisations d'après les différentes perpectives d'approche et sur les différents processus d'assimilation, d'accentuation et de catégorisation qui s'élaborent à son sujet dès son apparition. Ainsi, l'examen portera sur les approches précurseurs théoriques et pratiques sans lesquelles l'émergence de ce nouveau concept n'aurait pas eu lieu, pour ensuite s'attacher à consulter les tendances de ce qui constitue le courant américain, qui en est la source et l'émetteur pour le confronter au "courant" français afin d'identifier les éléments retenus et/ou exclus. Et donc d'observer si cette exclusion ou rétention est significative ou traduit une intention et de découvrir par ce fait, ce qui par rapport à l'expression originelle du concept est ancré ou non en France.
B - Une formalisation première par le Tavistock Institut of Human Relations.
Si l'usage du concept de culture à l'égard de l'entreprise se signale par sa nouveauté et son originalité, il n'en reste pas moins que de nombreux travaux et expériences sur le terrain ont auguré plus ou moins directement ce type de rapprochement dès les années cinquante, avec notamment les recherches dans le domaine de l'intervention du Tavistock Institute of Human Relations à Londres.
1) Un rapprochement original de la culture et de l'entreprise.
C'est, en effet dans l'ouvrage d'Eliott JAQUES à l'occasion de ses recherches de psychologie et de psychanalyse consacrées à l'examen du comportement humain dans un cadre organisationnel, à la Glacier Metal Company intitulé The Cultural Change of the factory (1951) que figure pour la première fois le terme de culture d'entreprise . Celle-ci, juste effleurée est littéralement définie comme un "mode de pensée et d'action habituel plus ou moins partagé" devant être "appris et accepté". Plus précisément, elle apparaît comme une sorte d'inconscient collectif, qui sert de réserve, de fonds où l'entreprise puise ses solutions lorsqu'elle est confrontée à des problèmes. Ainsi, la prise de conscience à son égard résulte d'un constat selon lequel il existe un lien très puissant entre le changement technique et le changement social. Plus exactement, l'évidence est faite que tout changement au sein d'une organisation entraîne des changements sociaux et qu'il existe également des systèmes sociaux techniques.
Ainsi distinguée, la dimension culturelle pour la première fois officiellement et formellement appliquée à l'entreprise, suppose tout un processus de socialisation consistant en une série d'ajustements mutuels à l'intérieur et entre les différents groupes hiérarchiques de l'entreprise, en fonction d'impératifs administratifs et techniques précis.
2) L'entreprise comme lieu véritable d'acculturation.
Pareille contribution a joué un rôle moteur dans la reconnaissance de l'entreprise comme lieu d'acculturation. Non seulement elle "tonifie" les travailleurs mais les sort de cette vision mécaniste des organisations issue du Taylorisme et de ses dérivés. Cette perspective inédite ouvre un champ neuf à explorer pour une meilleure compréhension du fonctionnement intrinsèque des organisations en général.
En définitive, une telle introduction, même légère, de facteurs culturels et de la culture elle-même dans le mode de considération des organisations de la part des chercheurs, résulte en fait de tout un cheminement antérieur qui dénote un changement progressif dans la façon, d'une part de traiter les problèmes liés à l'effort de productivité et d'autre part d'envisager l'entreprise .
C - Un concept initialement diffus.
Sur le plan historique des travaux portant sur l'évolution des préoccupations du patronat français et des chercheurs en matière de ressources humaines depuis la dernière guerre(8) montre la succession de trois périodes.
L'une, amorcée avant la guerre, dès 1938, par le C.J.P (devenue C.J.D.)(9) et poursuivie après celle-ci montre une très grande présence des questions humaines et sociales dans les préoccupations et les débats. Les finalités humaines de l'entreprise sont affirmés par de nombreux acteurs et le ton de certains discours, par exemple celui de Paul Huvelin, en 1957(10 )paraîtrait aujourd'hui très avancé et même osé. Si l'on taxe de paternalistes bien des propos, ils étaient néanmoins débattus par les forces sociales, syndicales en particulier.
Si on examine, les mouvements théoriques et comme cela a été vu précédemment, on note des modifications sensibles dans le regard porté sur l'entreprise et ses éléments constitutifs. Comme l'affirme G. MORGAN (1986), il est possible de considérer les théories sur les organisations sous l'angle de métaphores, qui en ce qui concerne l'entreprise sont au nombre de trois: l'organisation a été envisagée tour à tour comme une machine, un organisme et une culture. Or, il apparaît qu'au travers de ces trois perceptions circule de façon souvent sous-entendue, le concept de culture.
Ainsi en est-il du courant mécaniste qui a formalisé un style de gestion à caractère certes austère vis-à-vis notamment de la vie sociale dans l'organisation du fait d'un bannissement explicite de l'humain des usines, mais qui a néanmoins introduit à sa manière une certaine façon d'envisager l'univers organisationnel qu'on peut vraisemblablement, en raison des règles et des mécanismes attribués, comparer à une forme d'esprit d'entreprise.
1) L'approche mécaniste: expression d'un certain esprit d'entreprise.
La première métaphore qui tend à considérer l'entreprise comme une machine, se réfère à l'approche mécaniste du début de ce siècle avec pour instigateur principal, F.W TAYLOR (1856-1915), théoricien américain des organisations dont les principales réflexions sont centrées sur l'augmentation de la productivité, les postes de travail et l'élucidation du gaspillage et de la déviance (plus exactement la "flânerie" de la main-d'oeuvre ouvrière). Ainsi, la préoccupation relative à la manière d'inciter au travail, sur laquelle se fonde ses travaux, est-elle clairement posée au départ.
- Une méthode de mobilisation de la structure organisationnelle contre la flanerie systématique.
Brièvement, la position de TAYLOR a pour objet de lier la structure de l'organisation à l'efficacité, d'optimiser le travail en lui-même et de régler par conséquent l'organisation comme un être physique praxique. Telle est donc sur ce point, la "solution" qu'il propose. Dès lors, il s'agit concrètement, pour l'essentiel, de rationaliser les potentialités productives du travail au travers de l'effort physique. Ainsi, c'est l'énergie corporelle qui se consume selon des normes de productivité déterminées par la technologie qui la code, la contrôle, la régule et la mesure. De sorte que l'organisation ne se réduise plus qu'à un "contrôle de l'effort dans l'utilisation des ressources par la mesure d'un travail assimilable à une énergie physique, mesurable par des unités mécaniques simples (quantités, pièces produites, heures), pour s'assurer que les ressources confiées par un propriétaire sont normalement mises en valeur" (LORINO, 1989).
La mission se donne pour objectif de créer un environnement, un climat qui privilégie le travail, expression d'une valeur à signification économique partagée par tous les individus quelque soit leur grade, puisque selon TAYLOR, "seul l'argent compte" étant donné que "la prospérité devrait être le but du travail de tous les hommes" (1967, (20)). Ainsi la valeur "travail", à laquelle est sous-tendue celle du gain, (des salaires élevés pour l'ouvrier et un bas prix de revient de main-d'oeuvre pour l'employeur), lui-même sous-tendu par la performance, conditionne l'organisation et sert de base à une certaine psychologie du comportement d'une part et à une idée de l'action collective d'autre part.
Une évolution historique, le temps d'une mutation.
Depuis plus de 20 ans, le monde vit en état de crise. L'une succède à l'autre. Il est devenu commun de reconnaître qu'il s'agit d'une crise économique mais aussi d'une crise de civilisation, crise des valeurs, crise d'identité, crise politique, crise aussi liée aux bouleversements technologiques, crise de la pensée, des idéologies, etc.
Tout cela n'a fait que se renforcer avec l'évolution de la situation de l'ancienne URSS, l'émergence d'intégrismes, de nationalismes, l'échec du développement en Afrique, la "mondialisation de l'économie" et, plus près de nous, les nouvelles étapes de la construction européenne, les tensions et conflits violents à nos portes. S'y mêlent espérances inattendues et menaces que l'on croyait surmontées.
Les entreprises, leurs dirigeants, leur personnel et tous ceux qui y concourent: actionnaires, fournisseurs, clients, aménageurs, élus locaux, etc... vivent concrètement les retentissements de tout cela. Une intense activité industrieuse pourrait cependant faire oublier un temps les profonds bouleversements engagés et les mouvements qui emportent les hommes et leur destin.
L'émergence des questions de Sens, de façon explicite et implicite, est une indication à la fois d'une perte des repères et à la fois le signe d'un souci, d'une prise en charge de l'avenir, d'un pas en avant dans une plus grande autonomie, plus libre et plus responsable.
C'est une attitude que l'on retrouve chez beaucoup de personnes à des degrés divers il est vrai, et c'est une sollicitation encore plus grande pour le management des entreprises. Les hommes sont plus exigeants de la prise en-compte de leurs valeurs, du bien commun et de leurs singularités et différences (7) . Il y a là, à la fois un problème de clarification des enjeux de la crise, généralisée, et de repérage du Sens de l'évolution possible qui passe par une mutation.
L'entreprise n'échappe pas à ces questions tant parce qu'elle intervient dans son environnement que parce qu'elle est traversée par les hommes et les situations concrètes à vivre et à piloter.
S'il y a de nombreuses interprétations, souvent légitimes, à tout cela, de nouveaux éclairages sont possibles. Proposons en deux, l'un plutôt historique, l'autre plutôt théorique pour rendre compte de l'évolution du management.
Or à partir des années 60-70, il semble qu'avec le thème du management scientifique et de l'organisation scientifique du travail prédomine un souci de rationalité, de systématisation qui touche même la gestion des comportements humains.
L'engouement accentué pour les méthodes de rationalisation développée après la guerre aux Etats-Unis(recherche opérationnelle, rationalisation des choix budgétaires) est accompagné par l'arrivée en force de l'informatique de gestion et par un début d'intérêt pour l'approche systémique (11) . Parallèlement le discours économique prend une place de plus en plus important dans les médias et la réflexion publique, pendant que le cadre d'entreprise devient le modèle de l'homme moderne et la cible de toutes les convoitises du marketing et de la publicité.
Les années 80 qui ont suivi, ont été à la fois, celles de l'image, du "look" et de la domination des apparences en même temps que celles de troubles où pointent de mille façons des questions de Sens encore peu avouées.
Il semble bien, avec toutes les réserves qui doivent être mises sur une telle lecture que l'on soit passé par trois moments :- Une présence des questions humaines sous un mode tout à fait classique exprimant différents humanismes.
- Leur remplacement par la recherche de "modélisations", légitimées par leur rationalité technique ou scientifique, devenue critère de compétences majeur pour les entreprises.
- Une hypertrophie des images et des apparences idéalisées dont on voit la remise en question sous-jacente qui se lit plus fortement dans les années 90. La scène médiatique de la guerre du Golfe semble avoir joué symboliquement aussi un rôle charnière.
Avec cette dernière période, paroxytique sur le plan de la "gestion des vanités", les questions de Sens ramènent au premier plan les questions de l'homme sur le plan personnel et collectif.
Seulement elles les ramènent sous de nouvelles formes pour lesquelles les tentatives de réponse classiques ne suffisent plus. Beaucoup en ont l'intuition(12).
Sur un autre plan, l'éclairage de la théorie des Cohérences Humaines propose une lecture tout à fait complémentaire. Nous vivons l'apogée d'une crise des représentations. Une crise des représentations est une crise des idées, des modèles, des identifications classiques, des références, des schémas établis et de la fiabilité de tout ce qui "représente" la réalité, notre place dans le monde et même nos aspirations. Cela touche tant à l'autorité de nos représentants qu'à celle de nos modèles et certitudes. Le manager est à la croisée de ces interrogations(13).
Avec l'ère des lumières, la raison était le moyen de maîtriser les représentations. Rationalité des modèles, rationalité des systèmes, des méthodes, des techniques, des organisations, des comportements... rationalité aussi des fonctions, de la société, du progrès. Or, il semble que cette rationalité ne suffise plus à éclairer l'avenir, ni même le présent et qu'en plus elle conduise à des "exclusions", à des incertitudes, à des débordements immaîtrisables. Le phare de la modernité n'éclaire plus suffisamment et n'est plus le garant de l'efficacité humaine de l'action.
La crise des représentations que nous vivons provoque des tentations de régression, retour "aux bonnes vieilles méthodes" mais aussi au rejet de la raison qui fait resurgir tous les archaïsmes et leurs dangers. Elle suscite aussi des réactions conservatrices avec la tentation de conserver les modèles classiques en leur donnant une valeur d'absolu. Elle amène encore une fuite en avant moderniste avec une prolifération des images et des modes qui disqualifie encore plus les représentations et leurs "médiateurs".
Elle ouvre enfin sur une autre époque. Après l'âge des représentations et de la raison vient l'âge du Sens et de sa maîtrise. Si les représentations ne suffisent plus à maîtriser les choses, c'est qu'il faut faire appel, en plus, à leur Sens, à leur finalité, leur signification et leur efficacité humaine.
C'est ce qui est en jeu et que le management devra prendre en compte. Le Sens humain des choses, des décisions et des actes devient primordial. Il faudra donc de nouveaux moyens pour le management des entreprises humaines. Tel est le Sens que l'on peut donner à la mutation qui est en cours.
Par toutes sortes de symptômes qui traduisent une quête de Sens et expriment des questions de Sens, c'est un âge du Sens qui éclôt, un âge de l'esprit au sens où Malraux semblait vouloir l'annoncer pour le 21 siècle.
Le management des entreprises a lui aussi à entrer dans un "âge du Sens" où les finalités humaines mais aussi les phénomènes humains sont à remettre au centre des activités et des pratiques des entreprises.
- Une présence des questions humaines sous un mode tout à fait classique exprimant différents humanismes.
- Le scientific Management.
Pour cela, et c'est un des points d'orgue de cette approche, le commandement occupe une position importante, se situant au coeur des relations sociales. Aussi, c'est la compétence qui fait l'autorité. Celle-ci est proportionnelle à la connaissance pratique qu'on a de l'entreprise (que chacun doit avoir, selon l'expression consacrée "dans sa tête") et de ses rouages. Par ailleurs, en raison de ce que la rigueur dans le système de production est possible à condition qu'il existe ordre et organisation, le détenteur de cette autorité , lui-même doit adopter un comportement d'éthique consistant et participer à l'introduction de schémas d'actions, de modèles de conduites et de normes de comportements par rapport à des situations précises. Ainsi, il s'agit par exemple, pour les contremaîtres de développer les qualités spécifiques, telles que l'exemplarité du point de vue attitude par rapport au travail, le contact direct avec les ouvriers (l'accent est mis sur le principe de la connaissance des hommes, c'est-à-dire "une coopération étroite, intime, personnelle entre la direction et les ouvriers") et faire preuve aussi d'une certaine maîtrise dans un domaine précis, de posséder en conséquence un savoir d'expert.
Néanmoins, cette théorie, qui cherche à concevoir l'organisation comme une structure rationnelle et rigoureuse gérée scientifiquement est très contestée, même encore récemment ( PERROW, 1986) et d'application quasiment impossible sur le terrain (chaque ouvrier devait dépendre d'une huitaine de chefs aux spécialisations différentes). Défendant cependant fermement son point de vue, TAYLOR affirme que "dans son essence, le système de direction scientifique implique une révolution complète de l'esprit des ouvriers, une révolution radicale en ce qui concerne la façon d'envisager leurs devoirs vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de leurs employeurs. Le système implique également une réforme de la part de ceux qui sont du coté de la direction".
- Mise en évidence d'un rapport entre l'aspect structurel et organisationnel de l'entreprise.
C'est une confirmation d'un certain rapport entre l'aspect formel, caractérisé par la structure et tout ce qui a trait au mode opératoire et informel de l'organisation en faveur d'une harmonie sociale. Ce lien intrinsèque et basique, qui tient les membres de l'entreprise ensemble quelque soit leur grade, se réfère à une perception identique et commune de ce qu'implique le travail à tous les niveaux de la hiérarchie. Ainsi, comme l'a formalisé WEBER, l'organisation se soucie aucunement des différences entre les individus, elle est obligée de faire comme si tous les individus étaient semblables. Aussi, considère-t-elle l'ensemble de ses membres non pas comme un groupe social, mais comme un individu. Tout en ignorant en effet, ce que chacun, individuellement vient chercher dans le travail, un postulat est posé qui impose une attitude condition sine qua non pour que l'organisation préconisée fonctionne et qui doit prévaloir en chacun des individus. Cette attitude consiste en une aliénation commune et unique de la perception du travail. Or non seulement cette perception doit être unanimement partagée, mais doit avoir un caractère impérieux.
Sans doute nous trouvons-nous en présence de l'expression certes implicite d'un type de culture (basée sur une certaine idéologie dont la base est le rendement économique pour tous, et sur une représentation unanime de l'entreprise ) a avoir dans l'entreprise pour que celle-ci prospère. De sorte que cette prospérité, qui est présupposée être le but commun dans l'organisation, résulte non seulement d'une coopération entre les employés et leur employeur, mais aussi essentiellement d'un climat de consensus social, d'une acceptation commune des tâches à réaliser ainsi que de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'elle implique (une machine à produire qui si elle prospère profite à long terme selon TAYLOR, autant à l'employé, qu'à l'employeur ).
Cette approche culturelle, inavouée, de type scientifique (complétée pour l'essentiel par WEBER, H. LE CHATELIER et FAYOL) quoi que très critiquée et rejetée n'est cependant pas à négliger. Car outre l'influence qu'elle exerce dans les théories des organisations et les ouvertures théoriques qu'elle suscite notamment en ce qui concerne le commandement et indirectement les relations humaines, elle formalise clairement un style particulier de contexte culturel intra-muros qui doit son existence à un esprit d'entreprise tout aussi singulier. Par ailleurs, elle cristallise l'idée selon laquelle le plein rendement, et donc le travail, peut être obtenu s'il existe une communauté faite de perception et d'objectif partagés.
Néanmoins, cette propension à se détourner des différences individuelles (vis-à-vis des individus, l'organisation mécaniste dépend en effet dans son mode de fonctionnement de cette obligation de considérer et de faire comme si tous les individus étaient semblables) et d'imposer par ce fait un modèle culturel, va connaître par la suite, une certaine rupture, une certaine réforme.
Le courant qui suit, de caractère humaniste, constate en effet qu'il est avantageux d'envisager l'organisation comme un univers de relations qui prend en compte les individus. Et donc va s'intéresser à quelques facteurs jusque là ignorés et accorder une plus large place aux forces sociales informelles.
2) La culture comme médiateur entre le comportement et la structure organisationnelle : le courant humaniste.
L'intégration tacite de certains facteurs culturels, tels que les valeurs et les perceptions relatives à l'organisation dans les analyses et les publications théoriques des organisations va peu à peu prendre de l'ampleur.
- Une insertion implicite des facteurs culturels.
Les travaux de C. BARNARD (1938) s'y consacrent en effet de façon assez prononcée. Ayant pour objectif principal de présenter une "théorie globale" de l'organisation, il s'est en effet attaché à en étudier les caractères pour l'essentiel abstraits. Une des préoccupations qui ressort de ses études est la reconnaissance explicite de l'existence d'une nuance, sur le papier, mais pas dans la réalité, d'une distinction entre la structure formelle et les normes informelles du comportement au sein de l'organisation. Cela, parce que, selon BARNARD, "un examen attentif des actions observables des êtres humains dans notre société -mouvements, langage, pensées, émotions- montre que la majorité d'entre elles sont déterminées ou orientées par rapport aux organisations informelles".
Effectivement, d'après cette perspective, toute organisation naît "lorsqu'il y a des personnes capables de communiquer entre elles et décidées à participer à des actions destinées à accomplir un même but. Les éléments d'une organisation sont donc : la communication, la volonté de servir, un but commun". Ainsi présentée, l'organisation présuppose une coordination des efforts humains vers un but servant de principe unificateur et coordinateur. Par ailleurs, elle introduit, à sa façon, la notion de groupe qui, désignée comme un ensemble d'individus qui s'associent et organisent leur coopération dans un but commun qui sert leurs intérêts particuliers, atténue par ce fait la contrainte économique à laquelle se soumettait tout travailleur. De cette manière, il y a l'organisation au sein de laquelle se trouvent des individus, c'est-à-dire "des comportements, des actions" et la dynamique de cette organisation est le système coopératif.
Celui-ci engage l'individu tout entier puisque en qualité de membre, il s'insère dans un tissus relationnel qui l'implique et physiquement, biologiquement et personnellement. Par ce fait, l'organisation se structure par son intermédiaire tout en le structurant à son tour. Appartenir à une organisation suggère l'imprégnation de la part des individus de certaines caractéristiques propres à ce que BARNARD nomme l'organisation formelle qui renferme en elle-même également des caractéristiques informelles (la notion d'organisation informelle est rigoureusement introduite) "indispensables pour assurer le dynamisme et la vitalité" du système tout entier. La conséquence d'une telle perspective est l'établissement d'un lien direct entre la stratégie (l'organisation se planifie en fonction de buts et d'objectifs) et la culture entendue dans ce cas comme une manière de penser et d'agir coopérativement selon des objectifs et des buts communs qui participent à la définition de l'organisation en tant que telle. C'est-à-dire que le rapport semble être fait entre le rendement et la notion de groupe avec tout ce que cela comporte.Bien entendu, la notion de culture n'apparaît pas, il n'y a pas à son sujet de constructions conceptuelles, de plus, les aspects qui l'approchent et qui sont abordés ne sont pas identifiés comme étant du ressort de ce que l'on entend ordinairement par culture. Elle demeure un phénomène non-décrit. Mais C. BARNARD contribue néanmoins à mettre en lumière quelques-unes de ses manifestations (elle reste pour cela phénoménologique) et amorce ce faisant une certaine rupture dans la manière de considérer l'entreprise, qui se transforme par ce fait en une entité qui intègre en plus des aspects formels et objectifs, des aspects et données informels et subjectifs.
- Une prise en considération plus grande des caractères physiques.
l'Ecole "des relations humaines" avec Elton MAYO va développer ces observations, qui accordent une place plus grande aux éléments subjectifs, et va contribuer à donner une image organiciste de l'entreprise. Avec l'expérience très connue de la Western Electric, résultat d'une enquête sur le terrain d'une durée d'une douzaine d'années, dite "Effet Hawthorne", ce courant théorique concourt peu à peu à comprendre l'organisation comme un phénomène culturel. Certes on ne va pas parler de culture, mais elle va être indirectement 'intégrée et évoquée dans les discours produits. Les résultats obtenus, minimisent en effet l'importance des caractères physiques contextuels du travail en faveur d'aspects beaucoup plus subjectifs, tels que :
- la vie de groupe,
- la construction de réseaux de communication et d'expression,
- l'ambiance générale
- la qualité de cet environnement social.
Brièvement, cette approche explique que l'augmentation paradoxale et logiquement inexplicable du rendement observé est due à l'attention régulièrement prêtée aux ouvrières de l'usine. Effectivement, une des conclusions qui transparaît dans cette étude est que c'est la perception de la situation, la fréquence et la qualité des relations entre les collègues, entre les agents de maîtrise et les ouvrières, qui déterminent le comportement des gens et retentissent sur leur productivité. Par ailleurs, il est rigoureusement démontré que les attitudes et sentiments éprouvés par le travailleur jouent sur son travail. C'est-à-dire qu'on se trouve à la fois en présence d'une différenciation et d'une complémentarité entre l'organisation elle-même et les sous-groupes (avec tout ce que le phénomène de groupe implique comme par exemple le sentiment d'appartenance, la naissance de petits faits sociaux etc.) qui se forment en son sein.
- la vie de groupe,
- La reconnaissance d'une structure informelle et subjective de l'entreprise.
De cette manière, l'organisation ne se résume plus à ses aspects purement formels, qui perdent alors en prééminence. Il est maintenant officiellement reconnu et démontré qu'elle intègre et dépend aussi d'aspects essentiellement informels et subjectifs, qu'elle repose aussi sur un ensemble de représentations, de valeurs, de règles vécues en commun par ses membres.
De telles conclusions atteignent le mode de considération de l'homme au travail qui se modifie considérablement et tend justement à établir une jonction de plus en plus rapprochée et pertinente entre l'homme et le travail en déterminant ce qui les rapproche favorablement. Désormais on considère l'idée de différence individuelle et les besoins de l'individu, tant rationnels, qu'irrationnels sont minutieusement examinés et théoriquement formulés (MASLOW, 1965). Ainsi, il est démontré que les besoins constituent des moteurs fondamentaux du comportement humain et l'hypothèse est faite que l'absence de développement de la personnalité du salarié dans son travail à travers des représentations professionnelles sont les causes de la baisse de motivation.
Dans l'ensemble il apparaît que ces différentes approches participent à la définition d'une culture à la fois nouvelle et spécifique de l'organisation dans laquelle le travail vis-à-vis de l'homme, acquiert du sens.
Cette inclination se poursuit et va en s'accentuant avec SELZNICK (1957), qui s'interrogeant depuis longtemps sur le respect des principes démocratiques entre l'autorité et l'individu a placé sa réflexion selon une perspective institutionnelle. Il a par exemple exploré la fonction figurative et institutionnelle des dirigeants d'entreprise dans l'organisation et mis l'accent sur l'importance de cette fonction auprès des membres de l'entreprise vis-à-vis des valeurs et des attitudes. Ainsi, la question relative à l'importance de l'organisation en particulier informelle dans la vie de ses membres s'est posée également à lui et a ouvertement été abordée (SELZNICK et JAEGER, 1964). Selon ces auteurs,
" le système des organisations formelles va contre-nature . Il exige un effort conscient pour maintenir un mode de vie, discipline et comportements, ce qui est contraire à quelques-unes des pulsions humaines" " (1964, 659). Ils poursuivent en affirmant que " la culture se crée quand, dans sa lutte contre l'aliénation, l'être humain transforme l'instrumental et l'impersonnel, le matériel et l'organique, en un domaine de significations évocatrices, expressives et centrées sur la personne "Etant donné que l'organisation traverse la vie de l'individu et lui sert de terrain d'expériences humaines significatives, il s'avère capital de porter désormais une attention particulière aux relations impersonnelles, c'est-à-dire à tout ce qui fait la vie sociale. Ainsi l'entreprise doit savoir créer des conditions de travail, telles, qu'elle donne aux individus la vie sociale dont ils ont besoin pour éviter l'aliénation, ce qui a pour avantage de décentrer les tensions (l'individu n'est plus enclin à agir "contre" l'organisation) et les porter à des fins plus utiles.
Pareille reconnaissance de l'environnement impersonnel a pour visée de transformer un milieu jusqu'alors impersonnel en un milieu personnalisé.
Les effets vont être immédiats: dans la même période, les éléments constitutifs de cette vie sociale organisationnelle, vont faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, des phénomènes et des composantes culturels vont être identifiés, décrits, répertoriés et étudiés comme, les rites (qu'ils soient de caractère initiatique ou d'intégration ou d'exclusion), les cérémonies employés comme canal de diffusion des idéologies (ROHLEN, 1973), les histoires, les tabous (qui prendront le nom de "impensables" du fait de leur caractère imprévisible pour les dirigeants), les mythes perçus comme des sous-ensemble de l'histoire, (CLARK, 1973; MITROFF et KILMANN, 1975 et 1976) de même que les aspects symboliques (TURNER, 1971; PONDY et MITROFF, 1979; PETTIGREW, 1979; WEICK, 1979; LOUIS, 1980).
Par ailleurs, certaines notions dans le but de confirmer à la fois une distinction et un rapport entre les structures formelles et informelles de l'organisation et approchant de très prés l'idée de culture sont proposées. On parle dans ce cas "d'organisation informelle", de "système social irrationnel", de "climat organisationnel" ou "d'institution", c'est-à-dire "une communauté naturelle chargée de valeurs et mue autant par sa propre survie que sa propre finalité", soit de "committed polity" (SELZNICK, 1949), mais jamais de culture.
Excepté néanmoins, dans l'oeuvre commune de M. CROZIER et d'E. FRIEDBERG qui, examinant les jeux de pouvoir au sein des organisations, concluent que " le phénomène organisationnel apparaît en dernière analyse comme un construit politique et culturel ". Il s'agit pour les individus pris entre différentes logiques inhérentes aux organisations, dont par exemple les jeux de pouvoir, de tirer partie du système. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils obtiennent à la fois, " le minimun de coopération nécessaire à la poursuite d'objectifs collectifs, tout en maintenant leur autonomie d'agents relativement libres ". Le recours à l'aspect culturel, qu'il soit leur ou du ressort de l'organisation s'impose alors.
Cependant pareil constat requiert une certaine réserve, une certaine prudence. Il ne s'agit pas en effet d'introduire un nouveau déterminisme, qui affirme qu'en réponse aux dilemmes de pouvoirs et de contraintes, il se crée des "construits culturels". Il faut comprendre aussi que ces construits culturels ne constituent pas nécessairement le fondement même de l'organisation: l'organisation ne se réduit pas uniquement à de tels aspects culturels. Ici, la culture est plutôt regardée comme une capacité (à la fois intra-individuelle et collective) sur laquelle les individus s'appuient dans la gestion de leurs interrelations avec autrui.
Ainsi, si on examine les différentes théories, qu'elles émanent du courant mécaniste ou plus encore du courant humaniste, outre l'établissement factuel du lien entre les composantes de la culture et structure organisationnelle, il apparaît que la culture, même si sa dénomination exacte n'apparaît pas explicitement, soit reconnue comme une donnée de l'entreprise. Celle-ci intègre désormais des éléments qui forment une vie sociale indépendamment des structures imposées. La théorie X et Y de Mc. GREGOR illustre bien ce retournement de pensées.
Brièvement, la théorie X consiste en une série d'assomptions sur l'attitude à adopter envers un individu moyen aux caractéristiques négatives à l'égard du travail, tandis que la théorie dite Y comporte des préceptes opposés, donc en faveur de l'individu.
Plus exactement, les hypothèses de la théorie "X" maintiennent que:
- L'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail qu'il fera tout pour éviter.
- A cause de cette aversion caractéristique à l'égard du travail, les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions, si l'on veut qu'ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs de l'organisation.
- L'individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a relativement peu d'ambition, recherche la sécurité avant tout.
Alors que la théorie "Y" stipule que:
- La dépense d'effort physique et mental dans le travail est aussi naturelle que le jeu et le repos.
- le contrôle externe et la menace de sanction ne sont pas les seuls moyens pour obtenir un effort dirigé vers des objectifs. L'homme peut se diriger et se contrôler lui-même lorsqu'il travaille pour des objectifs envers lesquels il se sent responsable
- L'engagement vis-à-vis des objectifs est fonction des récompenses associées à leur réalisation.
- L'individu moyen apprend, dans les conditions voulues, non seulement à accepter mais à rechercher des responsabilités.
- les ressources relativement élevées d'imagination, d'ingéniosité et de créativité pour résoudre des problèmes de l'organisation sont largement et non pas étroitement distribuées dans la population.
- Dans les conditions de la vie industrielle moderne, le potentiel intellectuel de l'individu moyen n'est que partiellement employé.
A l'aide de ces hypothèses que l'on croise avec leur appréciation, il a été dressée une typologie de style de commandement qui peut être alors de caractère participatif, décideur, indécis et autoritaire. Ainsi, dans la mesure où tel salarié, quelque soit son rang hiérarchique a été en relation de travail avec une autorité animée par la théorie X ou par la théorie Y, son comportement, vis à vis de l'entreprise sera, soit la "présence non participante", "l'extraversion", soit au contraire, le souci de rapprocher le plus possible ses intérêts personnels à ceux de la firme. D'après les résultats obtenus, il paraît essentiel que les dirigeants sachent identifier ces deux mentalités. Selon en effet cette théorie, pour éviter l'instauration d'une démotivation profonde des salariés, qui de toutes façons, ne pourrait se résorber avec le palliatif de la sanction et de l'autoritarisme, la direction est tenue de "révolutionner" en quelque sorte sa mentalité, en réfutant la théorie X qui présente le salarié comme un individu par essence passif, hostile aux responsabilités. En revanche, elle adoptera la théorie Y, vision beaucoup plus positive du travailleur, qui d'une certaine manière force à considérer la passivité et l'indifférence de ce dernier comme l'expression de "symptômes" reflétant en fait la frustration de ses "besoins sociaux" ignorés et/ou sous-estimés par l'employeur. Ainsi une certaine image de ce que peut être l'attitude de l'employé face au travail de même que la description des postes de travail et donc les perceptions en général conditionnent chez son supérieur le style de comportement à son égard et inversement.
- L'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail qu'il fera tout pour éviter.
- La formulation explicite d'une organizational culture.
En définitive, ce sont BLAKE et MOUTON qui vont reprendre et incorporer le mot "culture" (plus exactement l'expression " organizational culture") dans leurs écrits et le lier clairement à la gestion, soutenant que le rôle du manager est de susciter le développement et l'entretien d'une culture en faveur du travail. Ainsi, selon eux, la culture organisationnelle est satisfaisante si elle favorise et maintient un rendement convenable aussi bien en quantité qu'en qualité, et encourage la créativité, l'enthousiasme pour l'effort utilisant l'interaction comme moyen de pédagogie dans l'organisation.
Un tableau typologique s'élabore et connaît une diffusion auprès de jeunes cadres : la grille de BLAKE et MOUTON qui réside en un ensemble d'hypothèses qui croisent trois paramètres concernant la production, les orientations et les personnes et cinq positions qui décrivent chacune un style de commandement. A l'origine, cette représentation cherche à définir les caractéristiques de la personnalité du gestionnaire, laquelle réagit à des pressions externes et internes c'est-à-dire des caractéristiques de l'appareil organisationnel constitué de traditions, de pratiques établies et de procédures. Ainsi le questionnaire demande au gestionnaire de se situer par rapport à ce qui fait son organisation, soit ce qui constitue son environnement culturel organisationnel comme le montre la grille ci-après.
A B C D E 1. Buts personnels et objectifs organisationnels Situation de démission psychologique
Fait le strict minimun dans le cadre du travailEtre aimé, plus qu'être efficace; a besoin qu'on l'apprécie et qu'on lui montre esprit de corps Les résultats priment avant tout; succès personnel. Dirige une équipe; rôle d'autorité Faire aller, cherche l'équilibre, accepte les situations Intègre les motivations individuelles à celles de l'organisation 2. Comportement en situation de conflit Fuit les responsabilités Persuade, aplanit; pouvoir de séduction Arbitrage autoritaire, tous les conflits étant paralysants Cherche le compromis Le conflit est abordé de front 3. Attentes vis-à-vis des subordonnés Conformisme apparent Consensus, ne rien demander qui ne soit acceptable L'initiative est une insubordination Prudence, analyse la situation Partisan de la participation, critique l'obéissance passive 4. Comment chacun pense faire progresser son collaborateur Politique de laisser-faire Gestion par le compliment, pas de critiques Les erreurs proviennent toujours des individus Complimente et critique en même temps, suggère beaucoup Aucune critique n'est séparée de son contexte. 5. En résumé... Evite les responsabilités, transmet les ordres Les relations humaines sont une fin en soi, importance du groupe Le chef planifie, les subordonnés exécutent Marchande en respectant les règles organisationnelles Les travailleurs sont des adultes conscients 6. Réaction des subordonnés devant les différents styles A,B,C,D et E Découragement, court-circuite le chef A Satisfaits du climat. Mais les informations ne remontent pas. rivalités. Se font oublier, rivalités fondées sur les résultats, compétition ou révolte Un climat de marchandage s'instaure Innovation ou mécon-
tentement7. Type d'organisation correspondant Organisation très bureaucratique Situation de monopole Cadres compétents et personnel non qualifié Entreprise très syndiquée Compétition très forte, personnel à compétences élevées Ainsi, tout ce qui a trait au phénomène culturel s'introduit progressivement dans les préoccupations théoriques sur les organisations et tend à dessiner une nouvelle conception de l'homme au travail. Une jonction naît entre le vécu des employés et des cadres et la forme structurelle de leur organisation qui ne se réduit plus seulement de ce fait à une machine à produire. On reconnaît en effet à l'entreprise des caractéristiques qui font d'elle un espace social où se crées entre autre, des codes communs, des systèmes de représentations, des normes informelles (T. PARSONS,1937) , des réseaux invisibles qui occupent une place de plus en plus prépondérante dans l'attitude et le choix du style de comportement à adopter dans le quotidien .
Parallèlement à cette exploration théorique et heuristique concernant l'organisation elle-même, s'élabore à partir des années cinquante un mouvement qui répondant aux préoccupations relatives à la mondialisation des échanges et à l'implantation d'industries et d'entreprises hors de leur pays d'origine, cherche à observer les effets des confrontations culturelles dans les organisations. Ce mouvement connu sous le nom de "comparative management", de management comparé, a beaucoup contribué dans la prise de considération et l'étaiement de la culture d'entreprise.
D - Une extension rapide du concept de culture d'entreprise.
1) La culture comme variable indépendante : le management comparé.
Corrélativement à ce souci de lier ou de distinguer l'aspect structurel et culturel d'une organisation, le management comparé a cherché à identifier les variations de pratiques managériales par pays. Il s'agit dans ce cas de s'interroger sur l'effet des cultures nationales sur les organisations et la performance, à grand renfort d'études à caractère essentiellement anthropologiques et psychosociologiques. Ainsi, des études vont être menées, qui vont sonder les gestions aussi bien européennes, chinoises et (ex)-soviétiques pour les comparer à celles qui ont cours aux Etats-Unis, afin de dégager les similitudes, les différences et surtout les logiques locales (GRANICK, 1962; PARK, 1966; RICHARD et WALTON, 1969; WEBER, 1969). Par ailleurs, l'examen du rapport entre la culture et l'organisation va s'affiner (DORE, 1973; ABEGLEN, 1974) et rendre compte de résultats intéressants. Ainsi, il apparaît que la culture locale et nationale, faisant office de toile de fond de l'entreprise, exerce une influence certaine sur le développement et le renforcement de croyances ainsi que sur le style commandement (HARBISON, MYERS, 1959) dans l'organisation et la division hiérarchique. De cette manière, le contexte culturel propre à un pays pousse les entreprises à adopter des formes de structures et des modes de fonctionnement interne adaptés à l'ensemble des formes acquises de comportement propre à ce pays, selon un modèle culturel implicite. Cependant, il apparaît également que cette influence est indirecte, elle n'est pas le fait de l'entreprise, elle est importée dans l'organisation par ses propres membres. Par ailleurs, ces résultats ne rendent pas exactement compte de l'existence de cultures d'entreprise, car l'observation est également faite que les mentalités entre firmes d'un même pays diffèrent , autant qu'entre entreprises de pays différents. Cette pertinence relative donne à penser que la culture, à ce niveau, est une variable indépendante (FAYERWEATHER, 1959; SLOWN, 1971).
Néanmoins, l'intérêt que suscite ces comparaisons ne diminue pas, des études vont se poursuivre et se consacrer vers la fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt, au Japon (ADAMS, 1969, BROWN, 1969) où la symbolisation de l'entreprise a connu et connaît encore une manifestation extrême, avec les chants collectifs, le drapeau de l'entreprise, la charte et la célèbre gymnastique du matin et qui n'est pas étrangère à la culture nationale.
Un tel intérêt a d'une certaine manière contribué à promouvoir l'idée qu'il pouvait exister des cultures qui favorisent les performances micro et macro-économiques.
Ainsi, du fait de ce souci constant relatif à la productivité des hommes au travail et des diverses observations réalisées sur le terrain, quelques aspects culturels de l'entreprise ont été partiellement abordés. Il y a eu en effet une exploration du phénomène culturel dans l'organisation, par certains, voire, l'ensemble des psychosociologues, spécialistes de la théorie des organisations, mais cependant, le concept de la culture d'entreprise en lui-même reste ignoré. Même si les théories sont le plus souvent sous-tendues par des préoccupations ayant de plus ou moins lointains rapports avec l'aspect culturel, il n'y a pas à son propos une isolation parfaite de ce qu'il est, suivi d'une énonciation cadrée et exclusive de ce qu'il signifie exactement. Il faut attendre le début des années 80 pour qu'il devienne une des préoccupations, sinon, la principale, des théoriciens et atteigne une place centrale dans le management.
2) Une définition fonctionnelle de la culture d'entreprise.
Cette promotion est le fait d'un groupe de conseillers américains, dont les plus représentatifs sont T. PETERS et R. WATERMAN, qui, plus que l'introduisent dans le monde du travail, lui donnent en effet force de loi dans le discours et les pratiques des managers. Leur ouvrage In Search of Excellence (qui met en scène une entreprise au sein de laquelle le lien postulé entre les membres est la communauté de valeurs) a non seulement vivement participé à son énonciation première en tant que nouveau mode de management des entreprises mais a aussi contribué à sa très large diffusion auprès non seulement des spécialistes et praticiens des ressources humaines, mais aussi auprès du grand public.
Ainsi, en définitive, il semble que ce sont les professionnels du conseil qui, ayant résolument utilisé pour l'entreprise la métaphore de la culture, et formellement établi un lien étroit entre performance et culture, l'ont, non seulement minutieusement et théoriquement formalisée, mais aussi ont contribué à ouvrir une voie immense et en apparence nouvelle d'investigation dans la science de l'organisation. Peut-être est-ce là une forme d'appropriation du concept culturel de leur part, tant il est vrai que cet aspect a été, on vient de le voir, au préalable abordé, que ce soit chez les théoriciens mécanistes, humanistes, voire systémiques (L. von BERTALANFFY, 1955; BOULDING, 1955; H. von FOERSTER, 1963, avec l'introduction de la notion d'autopoiesis), et tant il apparaît vraisemblable aussi qu'il est d'actualité. Probablement, cet intérêt manifeste pour la culture d'entreprise de la part de ce courant pionnier est-il tout simplement le reflet des intérêts du public quel qu'il soit.