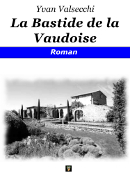La culture d'entreprise et sa représentation sociale
Auteur : Nathalie Diaz
-
I - AVANT-PROPOS
- II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
- III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
- IV - LA VERSION FRANCOPHONE
- V - CONTEXTE D'EMERGENCE
- VI - PRESENCE ET MODALITES
- A - Champ de la représentation sociale de la culture d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise.
- B - Les sources d'information et de circulation impliquées.
-
VII - IMAGE ET STRUCTURE
- VIII - LA PEDAGOGIE
Chapitre VI - PRESENCE ET MODALITES
Ainsi, la question qui nous préoccupe ici en premier lieu concerne tout d'abord l'extension de la culture d'entreprise. Il s'agit de connaître les populations qui ont été atteintes par la culture d'entreprise et donc d'observer si la pénétration de ce concept dans leur vie quotidienne est totale, partielle, fragmentée ou inexistante. Par ailleurs, il s'agit de découvrir quels types de communication sécrètent au travers de ces groupes, dont précisément à l'intérieur de l'entreprise, la culture d'entreprise et donc façonnent de ce fait plus ou moins directement sa représentation sociale.
A - Champ de la représentation sociale de la culture d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise.
Pour cela, nous avons distingué 9 classes hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise : les manoeuvres, les ouvriers qualifiés, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise dirigeant des ouvriers et ceux qui dirigent des techniciens les cadres ou ingénieurs, les cadres supérieurs et enfin les chefs d'entreprise. Une telle disparité avait pour objectif de distinguer à la fois la hiérarchie dans sa verticalité et dans son horizontalité. Ainsi, par exemple, les employés diffèrent des techniciens par la nature des tâches qui leur sont assignées. Par employé nous entendons en effet ceux qui travaillent généralement dans le secteur tertiaire, que ce soit dans les banques, le commerce. En cela, le technicien a directement un lien avec l'activité industrielle. Un tel découpage dans ce qui constitue le personnel de base trouve une autre justification, dans le fait qu'il semble s'agir d'une population relativement hétérogène.
Quoi qu'il en soit, pour une meilleure clarté dans les résultats, nous avons condensé l'ensemble de ces groupes en trois catégories : les employés, la maîtrise et l'encadrement. Ainsi en ce qui concerne directement le questionnaire, qui totalise 75 sujets, nous avons obtenu les taux de réponses suivants (tableau 1) avec le taux de connaissance sur l'ensemble de l'expression culture d'entreprise (tableau 2).
| Tableau 1 | Tableau 2 | |||
| C. S .P | effectif | expression culture d'entreprise |
% | |
| employés | 32 soit 42,66% | très souvent | 16,22 | |
| maîtrise | 24 soit 32 % | quelquefois | 36,49 | |
| encadrement | 19 soit 25,33 % | pas souvent | 22,97 | |
| Total | 74 | jamais | 24,32 | |
Si on demande à chacune des catégories si l'expression culture d'entreprise est utilisée dans leur entreprise, nous obtenons une distribution disparate. Ainsi qu'on peut le constater (tableau 3), la distribution diffère selon la classe d'appartenance.
Tableau 3: Connaissance de la culture d'entreprise par CSP; tableau des pourcentages par colonne
| manoeuvre | ouv qua | employé | techn | agt o | agt t | cadre/in | cadre s | chef E | |
| trè souvt | 0 % | 0 % | 4,5 % | 0 % | 0 % | 11,1 % | 53,8 % | 100 % | 40 % |
| qqfois | 50 % | 0 % | 13,6 % | 100 % | 53,3 % | 66,7 % | 30,8 % | 0 % | 40 % |
| pas svt | 0 % | 50 % | 40,9 % | 0 % | 20 % | 11,1 % | 15,4 % | 0 % | 0 |
| jamais | 50 % | 50 % | 40,9 % | 0 % | 26, 7 % | 11,1 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| effectif | 2 | 4 | 22 | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 5 |
Ainsi, plus on monte dans la hiérarchie, plus la culture d'entreprise est graduellement familière. On ne note pas cependant de ruptures franches entre les catégories. Ainsi, la culture d'entreprise est proportionnellement moins usitée pour les employés, qu'elle est utilisée par les cadres, cadres supérieurs et les chefs d'entreprise. Une certaine asymétrie semble exister entre ce qui constitue le "top" et le "down" de l'entreprise. Et entre et par rapport à ces deux parties extrêmes de l'échelon hiérarchique, la maîtrise constitue une tranche moyenne, comme le montre à ce propos le schéma 1. La proportion relative à la fréquence "quelquefois" est en effet des plus élevée, notamment parmi les agents de maîtrise dirigeant des techniciens.
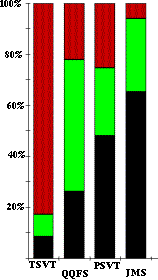
Encadrement
Maîtrise
Employé
Schéma 1: Connaissance de la culture d'entreprise par CSP
La nature de l'activité ainsi que la taille de l'entreprise nous ont paru également important pour comprendre l'ampleur de la portée de la culture d'entreprise. En effet, qui des commerciaux, des industriels et de ceux qui travaillent au sein d'une banque par exemple, sont au fait de la culture d'entreprise?Les résultats obtenus nous montrent qu'une relation existe entre le secteur d'activité et le degré de fréquentation de la culture d'entreprise.
Tableau 4 : Fréquence d'utilisation sur l'ensemble (effectif total = 71 soit 100 %) de l'expression culture d'entreprise par secteur d'activité de l'entreprise
| commerce | industrie | service | |
| très souvent | 8,5 | 5,6 | 1,4 |
| qq. fois | 25,4 | 9,9 | 1,4 |
| pas svt | 15,5 | 2,8 | 5,6 |
| jamais | 8,5 | 2,8 | 12,7 |
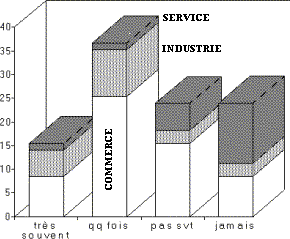
Schéma 2 : représentation graphique utilisation de l'expression culture d'entreprise par secteur d'activité.
Les résultats montrent en effet que le secteur commercial recueille pour une large part (un peu plus du quart de l'ensemble des réponses) un taux de connaissance assez élevé de la culture d'entreprise. Alors que celle-ci est modestement connue dans l'industrie et le service. Il existe de ce fait une très grande corrélation entre la fonction commerciale et l'inscription de la culture d'entreprise dans leur univers cognitif. Comme la représentation sociale participe pour une grande part à la reconstruction des éléments de l'environnement où le comportement se manifeste, ce résultat peut laisser présager la nécessité pour cet acte particulier qu'est la vente, de lui donner du sens et de modeler les relations qu'il implique.
La taille de l'entreprise exerce-t-elle une influence sur la diffusion et le maintien de la culture d'entreprise ? Les grandes entreprises obtiennent un taux de fréquentation, de proximité d'avec la culture d'entreprise, plus élevé qu'il ne l'est pour les petites et moyennes entreprises (tableau 5). Cependant les réponses ont une dispersion relativement restreinte, ce qui n'est pas le cas pour les PME, pour lesquelles, près de 63,6 % de ses membres affirment que l'expression culture d'entreprise est utilisée dans leur entreprise, alors que, en ce qui concerne l'entreprise de grande taille, ils ne sont que 48,1 % comme le montre le tableau comparatif ci-après, et comme le résume le schéma qui le succède (schéma 3):
Tableau 5 : fréquence d'utilisation de la culture d'entreprise par la taille
| modalité | PME | Grande entreprise |
marge |
| très souvent | 13,6 % | 17,3 % | 16,2 % |
| quelquefois | 50,0 % | 30,8 % | 36,5 % |
| pas souvent | 13,6 % | 26,9 % | 23,0 % |
| jamais | 22,7 % | 25,0 % | 24,3 % |
| effectif total | 22 | 52 | 74 |
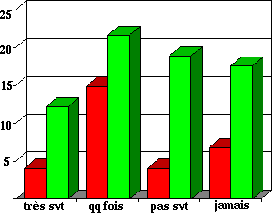
PME
Grande entreprise
Schéma 3 : Connaissance de la culture d'entreprise selon la taille de l'entreprise
Pour compléter ces diverses investigations à propos de l'extension de la notion de la culture d'entreprise au sein de l'entreprise, nous avons également distingué le statut que peut emprunter une entreprise. Une entreprise privatisée a-t-elle un niveau de présence de la culture d'entreprise plus poussé ou bien est-ce que les entreprises nationales, du fait notamment de leur imprégnation au sein de l'histoire en général et de leur ancienneté, sont plus réceptives à ce type de notion?
Les effectifs montrent (tableau 6) que l'expression culture d'entreprise est beaucoup employée dans le secteur privé puisque 83,3 % des individus qui ont répondu "très souvent" appartiennent à des entreprises de ce type.
Tableau 6 : usage de la culture d'entreprise par statut juridique de l'entreprise : pourcentages par colonne (total colonne = 100 %)
| Modalités | Très souvent |
Qq fois | Pas souvent |
Jamais | Marge |
| Privé | 83,3 % | 40,7 % | 29,4 % | 61,1 % | 50 % |
| Public | 16,7 % | 59,3 % | 70,6 % | 38,9 % | 50 % |
| Effectif total | 12 | 27 | 17 | 18 | 74 |
Cependant, ces mêmes résultats révèlent que parmi ceux qui n'entendent jamais parler de culture d'entreprise, 61,1 % d'entre eux, appartiennent au secteur privé. En revanche, en ce qui concerne les entreprises publiques, la tendance semble inversée. Celles-ci paraissent en effet imprégnées de la culture d'entreprise, mais sans excès; sur la totalité des individus qui ont répondu avoir entendu l'expression culture d'entreprise dans leur entreprise, ils ne sont que 16,7 % à provenir du secteur public, ce qui fait que dans ce secteur, ils ne sont que 5,4 % fonctionnaires (Tableau 7) à avouer une totale familiarité avec le concept. C'est plutôt dans les tranches modérées intermédiaires qu'on obtient les plus forts taux (quelquefois et pas souvent). Ainsi, il apparaît premièrement que les entreprises privées constituent un lieu relativement alternatif à l'égard de la culture organisationnelle. Celle-ci est ou très fréquemment employée, ou pas du tout employée. Ce qui signifie alors, que plus on travaille dans une entreprise publique, plus on risque d'entendre et d'évoquer le terme de culture d'entreprise, (tableau 5).
Tableau 7 : connaissance du terme de culture d'entreprise par le type d'entreprise (privé, public), pourcentages par ligne (total colonne = 100 %)
| Modalités | Très souvent |
Qq fois | Pas souvent |
Jamais | Marge |
| privé | 27 % | 9,7 % | 13,5 % | 29,7 % | 37 |
| Public | 5,4 % | 43,2 % | 32,4 % | 18,9 % | 37 |
| effectif total | 12 | 27 | 17 | 18 | 74 |
Ainsi, les groupes selon leurs caractéristiques abordent et intériorisent la culture d'entreprise différemment. C'est-à-dire que dans un cadre précis, à propos d'un même objet, les populations pour certaines catégories d'entre elles, l'objectivation et l'ancrage ont peu voire pas du tout lieu. Pour qu'elles soient effectives, quelques conditions doivent être réunies. Ainsi, un cadre ou ingénieur commercial, travaillant au sein d'une grande société privée est plus familier à la culture d'entreprise et semble s'en référer à elle, plus que peut le faire un fonctionnaire qui travaille en tant qu'employé dans le secteur service.
Pour cependant rendre compte du champ de la représentation sociale intra-muros de la culture d'entreprise et pour, par la suite, en déceler le caractère plus ou moins riche selon les groupes hiérarchiques, nous nous sommes intéressés à ce qui constitue la fonction sociale de l'objectivation au travers de ce qui la rend observable et qui est la communication. En effet, quels sont au sein d'un corps social donné, que forme l'entreprise, le parcours discursif de la culture d'entreprise, quels en sont les principaux émetteurs et quels sont les récepteurs qui leur correspondent ? Et donc, quels sont les phénomènes d'influence intra-groupes sous-jacents, qui affectent les systèmes cognitifs dans ces divers processus et opérations et qui concourent à l'émergence et à l'instauration de la représentation sociale ? C'est à ces interrogations que s'intéresse cette séquence attachée à identifier pour chaque groupe, c'est-à-dire celui des cadres, agents de maîtrise et employés, les diverses sources d'information grâce auxquelles ils ont accès à la culture d'entreprise, et par la même, la déterminent.
B - Les sources d'information et de circulation impliquées.
Pour comprendre davantage la portée de ces résultats, nous avons en effet cherché à savoir d'où les différentes catégories de personnes tiraient leur connaissance de la culture d'entreprise. Pour cela, nous avons établi une liste de sources d'information qui combinait à la fois trois types distincts de communication, une communication directionnelle descendante (discours officiels, publications internes), ascendante (stages, comité d'entreprise), et une communication transitive, horizontale (interrelations entre collègues, réunions syndicales). Par discours officiels, nous entendons les discours tenus principalement par les dirigeants, les directeurs des ressources humaines, c'est-à-dire, les responsables de l'entreprise. En ce qui concerne les publications internes, elles résident principalement en un journal interne, des plaquettes de présentation, des notes de services etc.
Par ailleurs, il nous a semblé pertinent de singulariser également l'entreprise de son environnement extérieur, c'est la raison pour laquelle, la mention "hors de l'entreprise", ainsi que l'évocation des média ont figuré dans la liste.
Ainsi, obtenons-nous les résultats suivants:
Tableau 8 : Sources d'information par catégories sociaux professionnels (en %)
| réunio | disc | resyn | colle | hors E | publ | stage | com E | média | |
| employés | 31,03 | 10,3 | 13,8 | 10,34 | 0 | 27,6 | 0 | 0 | 6,89 |
| maîtrise | 25,58 | 6,97 | 2,32 | 11,62 | 4,65 | 20,9 | 16,3 | 2,32 | 9,3 |
| encadrement | 17,85 | 7,14 | 3,57 | 16,07 | 0 | 23,2 | 10,7 | 3,57 | 17,85 |
| Total % | 24,82 | 8,13 | 6,56 | 12,67 | 1,55 | 23,9 | 9 | 1,96 | 11,34 |
| Légende | réunio = réunion
disc = discours officiels resyn = réunions syndicales colle = entre collègues hors E = hors de l'entreprise publ = publications internes stage = stage de formation com E = comité d'entreprise média = média |
||||||||
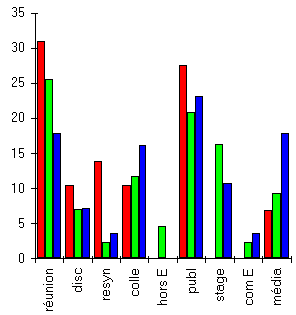
Employés
Maîtrise
Encadrement
Schéma 4 : représentation graphique sources d'information par catégories sociaux professionnels
Ainsi qu'on peut l'observer, en ce qui concerne les catégories hiérarchiques distinguées, les principales sources d'introduction et d'entretien de la culture d'entreprise recueillent un suffrage inégal. Selon la nature des groupes, et donc selon la hiérarchie, des similitudes ainsi que des disparités dans les outils d'information sont en effet visibles. Ainsi, les résultats obtenus montrent qu'il existe deux sources d'information communes aux employés et à la maîtrise, à la maîtrise et à l'encadrement, mais pas entre les hiérarchies extrêmes, telles que les employés et l'encadrement, sauf en ce qui concerne les communications extérieures à l'entreprise qui ne sont pas citées dans les deux cas, l'étant seulement par la maîtrise (4,65 %). Cette tendance semble montrer que en ce qui concerne l'intégration de la notion de culture d'entreprise, la maîtrise constitue une classe intermédiaire entre le sommet et la base.
D'après ces affinités, les interrelations (collègues) et les médias sont les voies par lesquelles les employés et les agents de maîtrise abordent dans les proportions identiques, la culture d'entreprise et par lesquelles ces deux catégories par ce fait réunies, se distinguent de l'encadrement. Celui-ci cependant rejoint la maîtrise par quatre fois. Les outils de communications tels que ceux qui se trouvent lors les réunions syndicales, les stages et les comités d'entreprise, qui constituent les communication de type transitives et linéaires de même que les situations elles-mêmes, sont en effet communs aux cadres et aux agents de maîtrise. Une exception cependant avec les discours officiels, cités pour 7,14 % des cadres et 6,7 % pour les agents de maîtrise.
Il n'existe que deux cas où la différence entre les groupes n'est pas flagrante, et pour lesquels aucun rassemblement ne peut être fait. Il s'agit des réunions et des publications internes qui touchent diversement les membres de l'entreprise.
Dans l'ensemble, les sources de communication qui pourvoient le plus fréquemment à la diffusion de la notion de culture d'entreprise au sein de l'entreprise sont dans l'ordre, les réunions (23,4 %), les publications internes (23,4 %), qui concernent les journaux internes, les documents normatifs, les notices d'information, les circulaires..., les relations interpersonnelles entre collègues notamment (13,28 %) et les médias (12,5 %).
Pris séparément, c'est-à-dire catégorie par catégorie, nous obtenons le classement suivant qui exprime les canaux de communication les plus employés pour la divulgation et le maintien de la notion de culture d'entreprise, sont ainsi les plus cités:
Tableau 9 : classement par ordre décroissant des sources d'information selon la CSP
| employés | maîtrise | encadrement | |
| 1 | réunions | réunions | publications internes |
| 2 | publications internes | publications internes | média-réunions |
| 3 | réunions syndicales | stage de formation | collègues |
| 4 | discours officiels-collègues | collègues | stage de formation |
| 5 | média | média | discours officiels |
| 6 | discours officiels | comité d'entreprise |
Ainsi, il apparaît que l'encadrement soit dans l'ensemble plus réceptif aux communications descendantes, telles que les publications internes. L'emploi premier par les cadres, ingénieurs et cadres supérieurs d'un tel mode de communication n'est pas anodin. Ils appartiennent en effet à la catégorie qui reçoit et qui envoie le plus d'informations dans ce type de support. La référence aux médias et aux relations journalières sont également significatives. La culture d'entreprise fait partie de ce dont on entend parler et de ce dont on parle.
Les employés quant à eux, s'initient à la culture d'entreprise et l'intériorisent au moyen de l'échange, notamment lors de réunions, quelles soient syndicales ou organisées au sein de l'entreprise. Les sources institutionnelles, c'est-à-dire celles qui émanent de la hiérarchie supérieure, voire de la direction sont peu citées. Il semble à cet égard qu'un certain écart avec tout ce qui à trait à la direction, existe au niveau des employés. Leurs sources principales d'information, sont effectivement assez éloignées des communications descendantes, comme les stages de formation ou le comité d'entreprise. En cela elles concernent davantage, les voies de communication horizontales et linéaires. Ainsi il semblerait que l'intégration dans la réalité, et dont, dans celle des employés, de la culture d'entreprise, emprunte des voies de communications communes à eux (les employés), indépendamment semble-t-il des autres hiérarchies. Cela résulte peut-être de la trop grande dispersion de l'information au sujet de la culture d'entreprise, ou plus exactement du "décalage entre l'information effectivement présente et celle qui aurait été nécessaire pour cerner tous les éléments dont dépend la suite des raisonnements" (MOSCOVICI, 1976).
Quoi qu'il en soit, une des conclusions dominantes qui transparaît est que la culture d'entreprise, lorsqu'elle vient à être évoquée, l'est entre personnes issues d'une catégorie sensiblement identique. Cependant, la position de la classe intermédiaire, maîtrise, est intéressante dans la mesure où elle semble s'allier dans le choix des sources de connaissance de la culture d'entreprise avec la catégorie supérieure, tout en formant cependant un groupe à part. Avec des fréquences toutefois moindre, les agents de maîtrise reproduisent dans quelques cas de figure, les réponses des cadres et chefs d'entreprise, notamment pour ce qui concerne les réunions syndicales, les publications internes, les stages de formation et les comités d'entreprise.
Il semble également que la culture d'entreprise soit strictement le fait de l'entreprise puisque les sources de connaissance citées se réfèrent majoritairement à l'entreprise elle-même, même si les médias sont mentionnés. Et à ce titre il est intéressant de noter que les médias occupent auprès des cadres, cadres supérieurs et chefs d'entreprise, une place importante, constituant la troisième référence grâce à laquelle la culture est appréhendée et intériorisée.
Ainsi, le type de communication importe beaucoup pour la connaissance de la culture. On relève à cet égard des signes distinctifs entre les groupes, qui font qu'à un type de groupe particulier correspond un type particulier de communication. De sorte que la diffusion de la culture d'entreprise à travers la hiérarchie et pour chacun de ses membres constitutifs, emploie des canaux de communication bien divers et distincts. On ne trouve pas en ce qui les concerne une homogénéité manifeste.
En ce qui concerne les sources d'information par secteur d'activité (Tableau 10), nous pouvons noter qu' elles composent une gamme assez large et dépendante de la taille de l'entreprise. Ainsi, plus on travaille dans le service (qui intègre le transport), plus on est assuré d'approcher la notion de culture d'entreprise essentiellement dans les publications internes de l'entreprise ; les autres modalités d'approche étant à peine citées, exceptés les médias.
Tableau 10 : sources d'information par secteur d'activité (% par ligne)
| réunio | disc | resyn | colleg | horsE | pub | stag | comE | comE | total | |
| commerce | 57,6 | 21,2 | 18,2 | 24,2 | 3 | 48,5 | 15,2 | 3 | 18,2 | 33 |
| industrie | 76,9 | 23,1 | 0 | 46,2 | 7,7 | 46,2 | 46,2 | 15,4 | 53,8 | 13 |
| service | 0 | 0 | 16,7 | 16,7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33,3 | 6 |
En revanche, dans le secteur commercial, ce sont dans l'ordre d'importance, les réunions, les publications internes et les interrelations avec les collègues qui sont les plus cités. Ainsi, les commerciaux sont autant sujets aux communications descendantes indirectes (les rapports avec les collègues), que directes, telles que les publications internes et les discours officiels qui recueillent dans cette catégorie, par rapport à son effectif total, 21,2 %. Ainsi, la proximité avec les hiérarchies supérieures est relativement étroite, qui peut alors constituer une source d'influence non négligeable dans la construction collective de la représentation sociale de la culture d'entreprise.
Ce résultat est très proche de celui obtenu par le secteur industriel, qui sur certains points détient des réponses sensiblement voisines avec celles des commerciaux, notamment avec les discours officiels, les publications internes et les réunions. Une similitude de ce type est également relevée avec le secteur service avec les réunions syndicales (respectivement, par catégorie, 16,7 % et 18,2 %) qui en revanche, n'apparaissent pas chez les industriels. Néanmoins en ce qui concerne les types de communications empruntés par les entreprises dont la vocation concerne le service, on peut observer l'étroitesse de la gamme, en effet, seuls les relations établies lors de réunions du comités d'entreprise, les réunions syndicales, les interrelations et les publications internes sont citées. Cependant tous les individus ont cité les publications internes, qui montrent une certaine dépendance vis à vis des instances de direction.
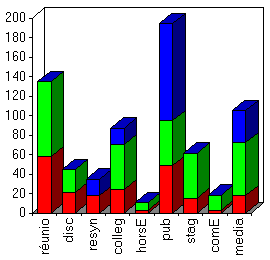
Service
Industrie
Commerce
Schéma 5 : sources d'information par secteur d'activité
Quant à la taille de l'entreprise, qui distingue une petite et moyenne entreprise (c'est-à-dire qui comporte moins de 50 personnes), d'une grande entreprise, quelques divergences apparaissent (tableau 11).
Tableau 11 : sources d'information selon la taille de l'entreprise
| Tableau des pourcentages par ligne
28% de sujets ont fourni au moins une non-réponse 54 individus ont répondu simultanément aux 2 questions |
||||||||||
| réun | disc | resyn | colle | hors E | pub | stage | comE | media | Total | |
| PME | 64,7 | 5,9 | 5,9 | 29,4 | 0 | 52,9 | 29,4 | 11,8 | 47,1 | 17 |
| GRE | 51,4 | 24,3 | 16,2 | 32,4 | 5,4 | 56,8 | 21,6 | 2,7 | 21,6 | 37 |
| marge | 55,6 | 18,5 | 13 | 31,5 | 3,7 | 55,6 | 24,1 | 5,6 | 29,6 | 54 |
Ainsi, respectivement ce sont les réunions, les publications internes et les relations interpersonnelles de même que les médias qui pourvoient à la prise de conscience et au maintien de la culture d'entreprise au sein des organisations. Toutefois quelques disparités surviennent qui différencient les petites et moyennes entreprises des grandes. Ainsi, les discours formels et officiels participent très peu à l'introduction de la culture d'entreprise de même que les réunions syndicales. Cependant, au niveau de la participation active et directionnelle de l'entreprise elle-même, on observe une légère supériorité des PME, qui lors de stages de formation ou des réunions en comité d'entreprise, tendent à employer le terme de culture d'entreprise. Ainsi, la culture d'entreprise n'épargne pas les PME, qui semblent elles aussi, s'appliquer à renforcer cette notion auprès de ses membres.
Outre les médias, qui sont d'ailleurs deux fois plus citées comme étant un facteur de diffusion dans les PME, les diverses sources de communication externes à l'univers de l'entreprise, sont généralement peu citées. En cela, le terme en lui-même de culture d'entreprise dans l'entreprise semble à ce titre lui être exclusivement réservé.
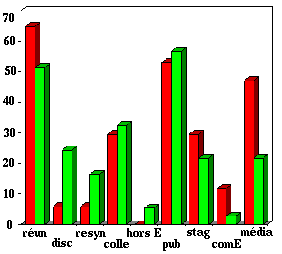
PME
GRE
Schéma 6 : sources d'information selon la taille de l'entreprise
Le statut privé ou public de l'entreprise a-t-il une incidence sur les modes de communication et sur l'appréhension de la culture d'entreprise en général ?
En ce qui concerne les modes de communication par lesquels la culture est mise à la portée des salariés, on observe (tableau 10) que les réunions et les publications internes sont indifférenciées et qu'elles constituent des voies majeures pour l'appréhension à l'intérieur de l'entreprise quelle qu'elle soit de la culture d'entreprise. Les différences accusées apparaissent néanmoins quant aux discours officiels, et aux réunions syndicales qui participent faiblement à sa propagation dans le secteur privé, qui semble privilégier les stages de formation (cités à 16,6%) et dans une proportion plus importante, les relations entre collègues (18,5 %). En cela, dans les entreprises privées, les réunions informelles sont plus propices à l'insertion, la définition et l'interprétation de la culture d'entreprise. Il est à noter l'ampleur des médias auprès des entreprises privées, qui sous-tend l'hypothèse, selon laquelle les sociétés de cette nature sont plus ouvertes sur l'extérieur, toutefois, cette possibilité est cependant quelque peu contredite avec le résultat nul de la catégorie "hors entreprise". Néanmoins, la communication médiatique reste un émetteur de référence pour les salariés d'établissements privés.
Et tel n'est pas le cas pour les entreprises nationales pour lesquelles, les médias obtiennent 9,25 % des réponses.
Tableau 12 : sources d'information par type d'entreprise (privé, public), pourcentages sur l'ensemble
| Modalités | réun | disc | resyn | colle | horsE | publi | stage | comE | média | total |
| privé | 25,9% | 5,55% | 3,7 % | 18,5% | 0 | 27,7% | 16,6% | 3,7 % | 20,37% | 25 |
| public | 29,6% | 12,9% | 9,25% | 12,9% | 3,7 % | 27,7% | 7,4 % | 1,8 % | 9,25 % | 25 |
| total | 30 | 10 | 7 | 17 | 2 | 30 | 13 | 3 | 16 |
C'est en définitive, respectivement par les réunions, les publications internes, les discours officiels et les interrelations que les fonctionnaires sont sensibilisés à la culture d'entreprise.
Ainsi, le mode de communication qui assure l'insertion et l'assimilation en interne de la culture d'entreprise diffère selon les caractéristiques du groupe auquel il s'adresse, qu'ils soient cadres, employés ou agents de maîtrise et selon les caractéristiques inhérentes à l'entreprise elle même, qu'il s'agisse de sa nature de ses activités, de sa taille et de son statut. De sorte qu'à un type particulier de personnes et d'entreprise corresponde une modalité dominante et singulière de communication, plus précisément, de style de communication. La culture d'entreprise, pour atteindre ses cibles au sein d'une seule et unique structure, en l'occurrence ici, une organisation emprunte et préfigure des canaux spécifiques. Ainsi, à une hiérarchie particulière, correspond une source d'information particulière. C'est donc à partir et à travers ces différents canaux distincts qui leur permettent de recueillir diverses informations sur la culture d'entreprise, que les individus en place dans l'entreprise élaborent leur réseau de connaissance et organisent de ce fait en fonction d'elle, leur réalité.
Quels sont alors pour chaque groupe les caractères de cette réalité que et qui transfigure la culture d'entreprise? Comment, la culture d'entreprise se transforme-t-elle à travers les rapports sociaux, les relations interpersonnelles, que nous venons de mesurer ? Suite à ces quelques observations de fait effectuées sur les formes de communications, la question qui se pose désormais, est s'il existe véritablement une pluralité de représentations de la culture d'entreprise associée à la pluralité des groupes sociaux. Pour y répondre nous avons distingué trois groupes sociaux, respectivement, les membres de l'entreprise, subdivisés eux-mêmes en trois sous-groupes, l'encadrement, la maîtrise et les employés, c'est-à-dire tous ceux que l'on trouve tout au long de l'échelle hiérarchique, les consultants et les étudiants. Pour chacun de ces groupes signalés, conformément à la "dimension d'appartenance" (JODELET, 1984), à partir de laquelle, les membres d'un groupe façonnent leur représentation sociale, il a s'agit d'identifier l'image et la structure de cette image, hors et dans l'entreprise. Hors par le biais des consultants et des étudiants, les premiers en raison de ce qu'ils ne fassent pas intégralement partie de l'entreprise, et que néanmoins elle leur soit un domaine d'exploration et d'intervention, les seconds parce qu'ils se situent à ses frontières en tant que futurs éléments et que leur formation, dans cet échantillon commerciale, les sensibilisent à cet univers qui est censé devenir par la suite le leur.
Les résultats obtenus lors d'investigations auprès de ces différents groupes sont développés au cours du chapitre VI.