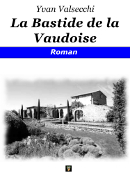La culture d'entreprise et sa représentation sociale
Auteur : Nathalie Diaz
-
I - AVANT-PROPOS
- II - LES PREMICES PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION
- III - APPROPRIATION ET ENONCIATION
- IV - LA VERSION FRANCOPHONE
- V - CONTEXTE D'EMERGENCE
- VI - PRESENCE ET MODALITES
- VII - IMAGE ET STRUCTURE
- A - La culture d'entreprise telle qu'elle apparaît chez les salariés
- B - La culture d'entreprise telle qu'elle apparaît chez les consultants.
- C - La culture d'entreprise telle qu'elle apparaît chez les étudiants
-
VIII - LA PEDAGOGIE
Chapitre VII - IMAGE ET STRUCTURE
A - La culture d'entreprise telle qu'elle apparaît chez les salariés
Les outils prospectifs qui ont tenté pour chacun de ces groupes de rapporter la représentation sociale de la culture d'entreprise, ont consisté en une série de définitions pour la très grande majorité d'entre elles prélevées des entretiens passés auprès des consultants. Les dix définitions possibles de la culture d'entreprise, qu'il était demandé d'apprécier selon une échelle en cinq points, allant d'un accord total (tout-à-fait d'accord) à un désaccord complet (pas du tout d'accord), sous-tendaient en définitive dans leur contenu sensiblement deux tendances qui n'étaient pas sans rappeler les modèles américains et francophone. Cette combinaison avait pour objectif de découvrir laquelle de ces approches prévalait et selon quels critères et quels degrés. L'hypothèse étant posée que plus le salarié a des responsabilités au sein de l'organisation, plus il est sensible au modèle américain qui de par ses caractéristiques, est résolument tourné vers le futur, la vitalité, la mobilité, l'implication et surtout le partage. Tandis que l'employé serait beaucoup plus proche du second modèle, accès et principalement centré sur le passé, l'identité, la stabilité, la convention et la diversité. En résumé, la tâche du questionnaire proposé résidait en deux étapes: recueillir pour chaque catégorie hiérarchique la représentation sociale, et donc présager l'intégration cognitive de la culture d'entreprise et simultanément et conséquemment à cela, en déceler les tendances, c'est-à-dire, indirectement les sources d'influence. Car, comme le précise D. JODELET (1984), à propos des phases de ce qui constitue l'objectivation, "Les informations qui circulent vont faire l'objet d'un tri en fonction de critères culturels (tous les groupes n'ont pas un accès égal aux informations) et surtout de critères normatif (on ne retient que ce qui est en concordance avec le système de valeurs ambiants).
Ainsi et tels étaient les constituants des définitions, en ce qui concerne les sentences qui reprenaient les sensibilités des deux modèles, nous avions:
| propositions d'obédience américaine | propositions d'obédience française |
| La culture d'entreprise regroupe un ensemble de valeurs annoncées dans les discours des dirigeants | la culture permet de prendre connaissance du fonctionnement de l'entreprise |
| la culture d'entreprise c'est ce qui induit certains comportements chez les membres de l'organisation et en décourage d'autres | l'identité collective s'exprime au travers de la culture d'entreprise |
| le style de direction de l'entreprise rend compte de la culture d'entreprise | la culture d'entreprise incarne le passé de l'entreprise, son histoire |
| la culture d'entreprise plante la politique sociale de l'entreprise | la culture d'entreprise est tout ce qui a trait aux règles minimales de collaboration dans le travail |
| la culture d'entreprise est une idée commune de l'entreprise partagée par les dirigeants de même que par les travailleurs | la culture d'entreprise est un système de références que le personnel utilise inconsciemment pour pouvoir agir |
La seconde partie du questionnaire relevait du même ordre. Il s'agissait de réagir toujours selon une échelle en cinq points, à une série d'assomptions sur le rôle de la culture d'entreprise au sein de l'organisation et ses éléments constitutifs. Les sujets devaient donner sur ces différents points leur opinions, selon l'importance qu'ils leur accordaient; l'échelle en question allant de "très important" à "pas du tout important".
Les éléments retenus avaient trait à la communication, aux rites. Et les rôles assignés à la culture concernaient la motivation, sa fonction par rapport aux personnes, la hiérarchie et les besoins stratégiques. Cette partie du questionnaire se donnait pour objectif de prendre connaissance des prises de position et leur incidence sur les attitudes et les stéréotypes.
Comme la variable essentielle dans ce cas concernait la position hiérarchique au sein de l'entreprise, les principaux tris croisés effectués en ont tenu compte. Cependant afin de compléter davantage cet examen d'autres variables, tels que l'âge et la durée d'exercice dans l'entreprise ont été considérés. Ainsi, en ce qui concerne la première catégorie de questions relatives à la définition plausible de la culture d'entreprise, la moyenne des distributions pour chaque élément, rangée par ordre croissant, c'est-à-dire, allant de l'accord au désaccord, est la suivante:
Tableau 13 : Réponses de l'ensemble des individus sur 5 échelles pour la description de la culture d'entreprise en général
| histoire | 2,12 |
| identité collective | 2,34 |
| connaissance | 2,36 |
| références inconscientes | 2,38 |
| comportement | 2,48 |
| style de direction | 2,53 |
| valeurs annoncées | 2,62 |
| idée commune partagée | 2,71 |
| règles minimales de collaboration | 2,82 |
| politique sociale | 2,85 |
On note immédiatement, une légère dispersion entre les items, la variance s'élevant à 0,05, ainsi, la position moyenne se trouve située dans la tranche "plutôt d'accord", "moyennement d'accord" et tend donc en cela vers une tendance générale relativement mitigée, la moyenne de l'ensemble étant égale à 2,52. Dans l'ensemble, ces moyennes révèlent qu'il n'existe pas de traits spécifiquement pertinents de la culture d'entreprise. Les membres à l'intérieur de l'entreprise font preuve d'un unanimisme apparent. Cependant, on observe que les traits qui recueillent le plus d'accord, se réfèrent à ceux qui constituent a priori, le modèle français. C'est-à-dire que le rejet de l'approche américaine sans être flagrant n'en n'est pas moins significatif.
Les traits qui de part leur caractéristiques, font de la culture d'entreprise un élément actif dans l'organisation sont en effet refoulés. En revanche ceux qui lui attribuent une activité passive ou modeste sont dans l'ensemble adoptés.
Si on distingue les groupes hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise, les résultats classés selon le même ordre précédent, signalent quelques variations.
Ainsi, en ce qui concerne les employés, les tendances accusent quelques différences.
Tableau 14 : réponses des employés sur 5 échelles pour la description de la culture d'entreprise en général
| employés | |
| histoire | 2,12 |
| références inconscientes | 2,13 |
| comportement | 2,32 |
| valeurs annoncées | 2,51 |
| identité collective | 2,51 |
| connaissance | 2,61 |
| style de direction | 2,83 |
| politique sociale | 2,9 |
| idée commune partagée | 3 |
| règles | 3,33 |
D'ors et déjà, au sujet des définitions proposées, la position moyenne, égale à 2,63 marque une propension à une attitude neutre, voire une attitude quelque peu défavorable. Cependant que l'histoire recueille sur l'échelle, exactement la même cote que l'ensemble des hiérarchies interrogées (2,12), les divergences apparaissent néanmoins sur deux points. Il semble que les prises de position soient plus polarisées et plus tranchées : le maximum atteint est par exemple de 3,33, (qui concerne les règles minimales), alors que pour l'ensemble il s'élève à 2,85 ( et à trait à la politique sociale). Tout lien entre la politique sociale, la communauté d'une idée partagée à tous les niveaux de la hiérarchie, les règles avec la culture d'entreprise est manifestement écarté. Par ailleurs les valeurs et le comportement intègrent plus que ne le font pour la totalité des membres, le champ de la culture d'entreprise. La signification de ce résultat est intéressant dans la mesure où les autres hiérarchies, qu'elles soient relatives à la maîtrise ou à l'encadrement apportent sur ce point quelques dissemblances.
Tableau 15 : réponses des agents de maîtrise sur 5 échelles pour la description de la culture d'entreprise en général
| maîtrise | |
| connaissance | 2,26 |
| histoire | 2,39 |
| identité collective | 2,45 |
| comportement | 2,56 |
| idée commune partagée | 2,6 |
| style de direction | 2,65 |
| valeurs annoncées | 2,72 |
| références inconscientes | 2,78 |
| règles | 2,91 |
| politique sociale | 3,18 |
Tel qu'on peut le noter, la connaissance occupe la première place dans les prises de position des agents de maîtrise. Et ce résultat est indifférencié, que les agents dirigent les ouvriers ou des techniciens. Cette primauté de la connaissance et de l'histoire, de même que de l'identité collective est sans doute à lier à une des sources principales d'information de la culture d'entreprise pour ce groupe, que caractérise les stages de formation, qui sont l'endroit privilégiés pour l'établissement d'un rapport entre l'aspect pragmatique de l'entreprise et son aspect théorique, entre le savoir divulgué par l'entreprise elle-même et la connaissance de l'entreprise. Ainsi, le lien matériel entre la culture d'entreprise et l'entreprise semble être fait sans que ne se produise à cet endroit une activité intellectuelle quelconque. C'est-à-dire que l'individu est passé du rapport avec autrui au rapport avec l'objet, en l'occurrence la culture d'entreprise, par l'entremise d'une appropriation indirecte de cet objet. Par ce processus, grâce auquel "la société ne se situe plus eu égard à l'objet de la représentation, mais par rapport à une série de phénomènes qu'elle prend la liberté de traiter comme elle l'entend", MOSCOVICI (1976), les agents de maîtrise en fonction de l'environnement qui est le leur, tendraient à ce que la culture d'entreprise reproduise leur réalité. En cela, cette représentation sociale semble leur donner les bases d'un système interprétatif.
Le second aspect notable est la position des propositions relatives aux valeurs et aux références inconscientes que le personnel utiliserait pour agir. Elles recueillent une réponse plutôt tempéré, respectivement, 2,72 et 2,78, qui par rapport aux réponses apportées par les employés sont relativement dissonantes. Les résultats respectifs de ces propositions étaient pour ce groupe de 2,51 et 2,13. Ce qui reviendrait à conclure que plus on descend la hiérarchie plus les valeurs et l'action inconsciente de la culture d'entreprise sont intériorisées et classées. Ceci vaut également pour le comportement qui dénote dans les deux cas, pour leur position aussi bien quant au choix et aux prises de position dont il a été l'objet. En effet, le comportement en ce qui concerne le groupe des employés, occupe la troisième place dans les éléments culturels les plus proches de l'accord, alors qu'il occupe la quatrième pour la maîtrise avec cependant une légère, mais caractéristique, différence dans l'évaluation sur l'échelle en cinq points. Pour les employés le comportement est en effet évalué à 2,32, alors que pour les agents de maîtrise, il l'est à 2,56. Le niveau d'intériorisation est proportionnel à la position hiérarchique dans l'entreprise.
Car, comme le montrent les différentes réponses données par les cadres, cadres supérieurs et chefs d'entreprise, cette tendance se vérifie. En effet, comme l'indique le tableau ci-après, la culture d'entreprise, telle que les décideurs la perçoivent et l'envisagent, a une configuration différente de celle des autres groupes sociaux. Ainsi, la tendance exprimée est globalement plus positive, davantage portée sur l'accord que le désaccord ou la désapprobation. L'ensemble des réponses enregistrent sur l'échelle, une moyenne totale de 2,28, ce qui en regard des autres moyennes ( 2,63 pour les employés et 2,67 pour les membres de la maîtrise), constitue et signifie une certaine singularité, quant à l'attitude envers la culture d'entreprise, (jugée dans l'ensemble plus favorablement ).
Tableau 16 : Réponses de l'encadrement sur 5 échelles pour la description de la culture d'entreprise en général
| encadrement | |
| histoire | 1,84 |
| identité collective | 2,05 |
| style de direction | 2,1 |
| connaissance | 2,21 |
| règles | 2,21 |
| références inconscientes | 2,22 |
| politique sociale | 2,47 |
| idée commune partagée | 2,52 |
| comportement | 2,57 |
| valeurs annoncées | 2,63 |
Il existe en définitive trois groupes de tendances. Un pour lequel l'approbation est satisfaisante et qui concerne l'histoire, l'identité collective et le style de direction. Le second où l'accord bien qu'encore important est réduit par rapport au premier. Il concerne la connaissance, les règles et les références inconscientes, tandis que le troisième groupe est foncièrement plus mitigé notamment l'aspect dirigiste et actif de la culture d'entreprise, comme le signale la position des valeurs annoncées dans le classement final. Ainsi, la perception qui prévaut est que la culture touche à l'identité de l'entreprise à ce qui est immuable avec son histoire et ce qui la fait au quotidien, dont les normes. Ainsi, la reprise du modèle américain n'est pas totale.
Cependant si on compare les préférences et les structures sous-entendues pour chaque groupe, on note une certaine dynamique à l'intérieur de l'entreprise à propos de la culture d'entreprise, notamment une cohérence de sa représentation et des individus qui la portent, soit les groupes hiérarchiques distingués. Comme le montre en effet le tableau ci-dessous, l'ordonnancement des éléments composites de la culture d'entreprise, tels que les membres de l'entreprise les perçoivent révèle l'adaptation dont ils ont été l'objet par les différents acteurs en fonction de leur statut et de leur environnement.
Tableau 17 : Classement par ordre d'approbation décroissant, des réponses par groupe hiérarchique des individus sur 6 échelles pour la description de la culture d'entreprise.
| employés | maîtrise | encadrement | |
| 1 | histoire 2,12 | connaissance 2,26 | histoire 1,84 |
| 2 | références 2,13 | histoire 2,39 | identité collective 2,05 |
| 3 | comportement 2,32 | identité 2,45 | style direction 2,1 |
| 4 | valeurs 2,51 | comportement 2,56 | connaissance 2,21 |
| 5 | identité 2,51 | idée commune 2,6 | règles 2,21 |
| 6 | connaissance 2,61 | style direction 2,65 | références 2,22 |
| 7 | style direction 2,83 | valeurs 2,72 | politique sociale 2,47 |
| 8 | politique sociale 2,9 | références 2,78 | idée commune 2,52 |
| 9 | idée commune 3 | règles 2,91 | comportement 2,57 |
| 10 | règles 3,33 | politique sociale 3,18 | valeurs annoncées 2,63 |
| moy | 2,63 | 2,65 | 2,28 |
Ainsi, sur les dix éléments culturels qu'il s'agissait d'apprécier, la moitié d'entre eux connaissent une configuration semblable. En effet, que ce soit pour l'identité, l'idée commune, les règles, le style de direction ou la connaissance, on observe que la hiérarchie intermédiaire, que constitue la maîtrise, s'interpose dans ses réponses, entre celles des employés et de l'encadrement. Elle semble en cela formuler une réponse médiane, entre les deux pôles hiérarchiques, avec cependant un certain rapprochement avec la catégorie des employés, excepté pour les questions relatives à la connaissance et à la communauté d'idée, pour lesquelles la tendance s'inverse. La description de la culture d'entreprise, son image qu'elle révèle sont donc conditionnées par les conduites et les normes en places dans l'organisation, qui font que les traductions possibles de ces résultats sont de deux ordres. Il se peut en effet, que le personnel de base, étant sous-informé et peu familier à la culture d'entreprise (comme l'ont montré les premières questions), oriente ses réponses dans un sens défavorable, (par rapport à l'ensemble des réponses données par tous les individus, toutes catégories confondues), se rétracte sur toutes les propositions qui concernent le partage comme par exemple, l'identité collective, l'idée commune, la connaissance et les règles minimales de collaboration dans le travail, parce que de fait, la culture d'entreprise a faiblement pénétré cette population et que par conséquent, le partage en ce qui les concerne est relatif. Ainsi, se serviraient-ils de la perception de la culture d'entreprise pour interpréter au sein de l'organisation, leur propre situation.
Ce résultat se vérifie si on consulte les distributions par rapport aux sources de communication. Ainsi, en ce qui concerne "l'idée commune", qui recueille auprès des employés 3, des agents de maîtrise 2,6 et des cadres 2,52, l'ordre des choix sur l'échelle en 5 points est le suivant :
| Sources de communication | ordre de citation des évaluations de l'élément: idée commune, sur l'échelle en 5 points |
moyenne sur l'échelle des évaluations par source d'information |
| réunion | 4-3-2-1 | 2,83 |
| discours officiels | 2-3-4 | 2,3 |
| réunions syndicales | 2-3-4 | 3 |
| collègues | 2-1-3-4 | 2,23 |
| hors de l'entreprise | 1 et 3 | 2 |
| publications internes | 2-4-3-1 | 2,66 |
| stage de formation | 2-3-1-4-5 | 2,46 |
| comité d'entreprise | 3-1-5 | 3 |
| médias | 2-1-4-3 | 2,37 |
Sachant que les non-réponses totalisent sur l'échelle, une moyenne de 3,15, on s'aperçoit que les réponses qui tendent vers une désapprobation concernent des créneaux de communication privilégiés par les employés pour leur initiation à la culture d'entreprise, tels que les réunions (31,03 %), les réunions syndicales (13,8 %), les publications internes (27,6 %). Il existe donc un rapport à ce niveau.
La seconde explication tiendrait à la position intermédiaire des agents de maîtrise qui de part les voies de communication qui les initient à la culture d'entreprise, adopteraient par rapport au groupe émetteur, la direction, notamment dans le cadre de stages et réunions de comité, des stéréotypes consensuels, avec en ce qui concerne l'attitude, un travail attitudinal d'assimilation moindre comme l'indique les quelques similitudes (cf. pour la politique sociale) dans la perception avec le groupe hiérarchique inférieur et les positions asymétriques vis à vis du groupe hiérarchique supérieur (cf. pour l'histoire et les références inconscientes).
Tout ceci montre combien le contexte où est saisi l'objet est important et qu'il conditionne le type de représentation sociale lors de son élaboration.
D'autres facteurs interviennent également tels que l'âge et le nombre d'années d'exercice. Ainsi en ce qui concerne les traits participatifs et actifs de la culture d'entreprise, qui reprennent le modèle américain, les résultats montrent que plus on a entre 50 et 54, de même que entre 25 et 29 ans, plus on est porté à envisager la culture comme étant un regroupement de valeurs annoncées dans les discours des dirigeants. En revanche en ce qui concerne la tranche d'âge 35/39 ans, on note un certain désaccord sur ce point, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau 18 : Pourcentages sur l'ensemble des valeurs annoncées dans les discours des dirigeants comme incarnation de la culture d'entreprise par l'âge des sujets.
khi-deux= 35,93 nombre de degré de liberté = 28, probabilité critique p = 0,144
| -25 ans | 25/29 ans | 30/34 ans | 35/39 | 40/44 | 45/49 | 50/54 | 55/59 | |
| 1 | 0 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5,6 | 0 |
| 2 | 2,8 | 11,1 | 6,9 | 1,4 | 5,6 | 4,2 | 1,4 | 2,8 |
| 3 | 1,4 | 6,9 | 5,6 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | 1,4 | 2,8 | 6,9 | 9,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| moy | 2,75 | 2,41 | 2,75 | 3,4 | 2,62 | 2,42 | 1,85 | 2,66 |
Ainsi, la croyance selon laquelle les valeurs font partie intégrante de la culture d'entreprise, gagne et diminue en intensité selon l'âge.
Le schéma qui suit montre dans leur globalité, ces variations entre les groupes hiérarchiques distingués, à propos de la perception des éléments constitutifs de la culture d'entreprise.
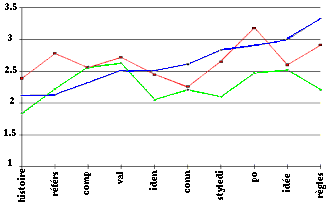
Moyen
Cadre
Employé
Schéma 7 : Représentation graphique des réponses données par chaque groupes sur l'échelle en 5 points.
En ce qui concerne les éléments pour lesquels l'importance par rapport à la culture d'entreprise était l'objet d'une estimation, toujours selon une échelle en 5 points les résultats obtenus révèlent également des variations selon la position hiérarchique.
Dans l'ensemble, sans que ne soient distinguées les catégories hiérarchiques, les moyennes pour chaque proposition sont les suivantes :
Tableau 19 : évaluations moyennes selon l'échelle en 5 points pour chaque élément
| communication interne | 1,9 |
| rôle de la hiérarchie | 2,13 |
| connaître la culture d'ent | 2,14 |
| rôle des personnes dans le maintien de la culture d'entreprise | 2,15 |
| cohérence avec les besoins stratégiques de l'entreprise | 2,16 |
| motivation | 2,23 |
| outils | 2,23 |
| rites | 2,73 |
Avec une moyenne générale de 2,21 et une dispersion infime, les éléments dont il était demandé d'apprécier le rôle vis à vis de la culture d'entreprise, sont perçus comme étant importants par l'ensemble des membres des entreprises. On ne trouve pas d'écarts considérables entre chaques éléments sauf en ce qui concerne les rites, conçus comme étant globalement moyennement importants.
Quoi qu'il en soit, les résultats manifestent une tendance très resserrée et très consensuelle quant à l'action des éléments culturels et de la culture elle-même. Cependant, lorsque les groupes sociaux sont considérés séparément les résultats montrent des variations caractéristiques et des hiérarchies autres.
Ainsi, pour les employés (tableau 20), il est important de connaître la culture d'entreprise. Cette aspiration est ,sans doute, à relier avec la méconnaissance dont est l'objet la culture d'entreprise dans ce groupe. En effet, sur la totalité des individus qui ont déclaré n'avoir pas souvent entendu dans leur entreprise le terme de culture d'entreprise, 11,8 % sont des ouvriers qualifiés, 52,9 % et sont des employés. Ces tendances se retrouvent également pour ceux qui n'en n'ont jamais entendu parler, 11,1 % sont des ouvriers qualifiés et 50 % sont des employés. Or ces mêmes individus indiquent accorder beaucoup d'importance au fait de connaître la culture d'entreprise. Ce qui semble en définitive, signifier, à ce niveau, un désir que leur représentation sociale exprime ouvertement.
Tableau 20 : évaluations moyennes par les employés
| employés | |
| connaître la culture d'entreprise | 1,93 |
| hiérarchie | 1,96 |
| communication | 2,16 |
| personnes | 2,26 |
| outils | 2,29 |
| cohérence | 2,29 |
| motivation | 2,38 |
| rites | 2,93 |
Il est à noter également la place, que les éléments humains tiennent d'une part, dans et par rapport à cette représentation de la culture d'entreprise pour les employés et d'autre part, la mise en avant de facteurs liés à tout ce qui concerne sa diffusion et son maintien. Selon eux en effet, la hiérarchie (1,96), ainsi que les personnes en place dans l'entreprise (2,26) sont jugés importants pour l'éclosion de la culture d'entreprise. Les modes de communication importent également beaucoup, c'est en effet, au travers de cette communication que les hommes accèdent à la culture et la font à leur tour circuler. Cette dimension dans son appréciation, a quelques similitudes avec le désir premier au sujet de l'importance de connaître la culture d'entreprise. A l'égard ce tout ce qui à trait à l'action même de la culture d'entreprise dans l'entreprise, (la culture comme outil, comme facteur de motivation et de cohérence), l'intérêt est moindre. Ce qui traduit bien la cohérence du classement dont est sujet la culture d'entreprise en faveur des hommes et des outils qui les relie entre eux, ainsi que la propre cohérence de ceux qui la portent.
Les agents de maîtrise quant à eux (tableau 21), ont dans leur perception, une dispersion très réduite, cependant, la communication est estimée importante et tranche radicalement avec les autres variables. Et comme les employés, les rites par rapport aux autres variables sont déclassés.
Tableau 21 : évaluations moyennes par la maîtrise
| maîtrise | |
| communication | 1,87 |
| hiérarchie | 2,17 |
| outils | 2,2 |
| motivation | 2,21 |
| connaître la culture d'entreprise | 2,22 |
| cohérence | 2,25 |
| personnes | 2,35 |
| rites | 2,48 |
En ce qui concerne les cadres (tableau 22 ), les trois facteurs importants pour la culture d'entreprise sont la communication, les personnes en place et la nécessité d'une certaine cohérence entre la stratégie de l'entreprise et sa culture. Ceci dénote à la fois l'intérêt pour les cadres d'une culture d'entreprise active et participative. La culture d'entreprise est en effet perçue comme quelque chose que les hommes façonnent, de par l'histoire et l'identité qu'ils lui attribuent, et qui les façonne à son tour ; elle est une forme de connaissance qui motive et dont il est relativement indispensable qu'elle soit alignée avec les buts poursuivis.
Tableau 22 : Classement par ordre d'importance par l'encadrement
| encadrement | |
| communication | 1,68 |
| personnes | 1,74 |
| cohérence | 1,95 |
| motivation | 2,11 |
| outils | 2,21 |
| hiérarchie | 2,26 |
| connaître la culture d'entreprise | 2,26 |
| rites | 2,79 |
Cette image de la culture d'entreprise a quelques oppositions avec les hiérarchies subalternes, dont les employés, qui l'envisagent plutôt comme une structure immatérielle par laquelle le personnel agit. L'unique point sur lequel, les groupes hiérarchiques s'accordent unanimement, concerne les rites, qui sans recueillir une désapprobation manifeste n'en sont pas moins socialement dépréciés.
Ainsi, comme le résume le tableau récapitulatif et sa représentation graphique (schéma 6 ), en ce qui concerne l'importance accordée aux éléments que nous venons d'examiner, en fonction de l'appartenance hiérarchique à l'intérieur de l'entreprise, nous pouvons observer quelques tendances qui rendent compte d'une certaine relation interdépendance entre les groupes, qui semble affecter la manière de percevoir la culture. Ainsi, comme le précise à ce propos D. JODELET (1989), "ces définitions partagées par les membres d'un même groupe construisent une vision consensuelle de la réalité pour ce groupe. Cette vision, qui peut entrer en conflit avec celle d'autres groupes, est un guide pour les actions et échanges quotidiens."
Tableau 23 : évaluations selon les appartenances hiérarchiques
| Employés | maîtrise | encadrement | |||
| 1 connaître la culture |
1,93 | communication | 1,87 | communication | 1,68 |
| 2 hiérarchie | 1,96 | hiérarchie | 2,17 | personnes | 1,74 |
| 3 communication | 2,16 | outils | 2,2 | cohérence | 1,95 |
| 4 personnes | 2,26 | motivation | 2,21 | motivation | 2,11 |
| 5 outils | 2,29 | connaître la culture |
2,22 | outils | 2,21 |
| 6 cohérence | 2,29 | cohérence | 2,25 | hiérarchie | 2,26 |
| 7 motivation | 2,38 | personnes | 2,35 | connaître la culture |
2,26 |
| 8 rites | 2,93 | rites | 2,48 | rites | 2,79 |
| 2,28 | 2,22 | 2,13 |
Ainsi, à l'examen de ce tableau, nous voyons qu'il s'agit en définitive d'une situation semblable à celle évoquée précédemment à propos des définitions. De nouveau, on remarque en effet la position intermédiaire occupée par la maîtrise. Relativement à cinq éléments, respectivement, la nécessité de connaître la culture, la hiérarchie, la communication, la motivation et la cohérence, on note en effet une interprétation transitoire entre les hiérarchies supérieures et inférieures, avec pour la connaissance de l'aspect culturel, le rôle de la hiérarchie dans la manifestation de la culture et le rôle décisif de la communication une attitude qui reproduit celle de l'encadrement. Ainsi, comme le montre le schéma , on observe l'existence d'un point d'inflexion au niveau de la variable "outils", au delà duquel la maîtrise s'allie avec l'encadrement, et en deçà duquel sa perception rejoint celle des employés en général. Ces écarts entre les degrés d'adhésion aux perceptions de ces deux groupes, traduit-il de la part de la maîtrise, un conflit intérieur, sollicitée qu'elle semble l'être, à la fois, par les décideurs et le personnel, comme le témoignent les sources d'information par lesquelles la culture d'entreprise s'immisce dans leur réalité ? Ce "soi généralisé" (MOSCOVICI, 1976), que reflète et médiatise la représentation sociale, ne paraît pas spécifiquement singulariser un groupe donné, en l'occurrence, les agents de maîtrise, mais bien un soi intercalaire entre deux groupes donnés.
La représentation sociale de la culture d'entreprise modèle et est modelée par les groupes qu'elle atteint. La communication à son sujet, à l'intérieur de l'entreprise est déterminante.
A la lumière de ces résultats, on observe que la représentation sociale de la culture d'entreprise est non seulement une vision consensuelle de la réalité à l'intérieur des sous-groupes distingués et donc, dans les différents strates hiérarchiques, mais aussi, une vision relativement consensuelle à l'intérieur de l'entreprise toute entière. Les faibles dispersions obtenues en témoignent en effet. Cependant, il est également vérifié que la représentation est conditionnée par la communication et les voies de communication, qui préfigurent d'une part le contenu et la structure de la représentation et d'autre part en conséquence, les groupes sociaux. Ainsi, il existe une relation entre la façon dont on se représente la culture d'entreprise et le groupe hiérarchique d'appartenance.
B - La culture d'entreprise telle qu'elle apparaît chez les consultants.
Dans cette étude sur la représentation sociale de la culture d'entreprise, il importait de prendre en compte les prestataires de services en matière de management, auprès des entreprises qu'incarnent les professionnels du conseil. Du fait de la position qu'ils occupent vis à vis de l'entreprise, de leur proximité avec tout ce qu'elle comporte et inclue, et du fait que leur fonction consiste pour l'essentiel, à combiner l'aspect perceptif qu'ils reçoivent de l'entreprise et l'aspect conceptuel qu'ils élaborent à son propos, comment s'effectue leur rapport à la culture d'entreprise ? Sur quelles bases se fonde cette activité représentative et en quoi affecte-t-elle leur mission ? Pour étudier les processus engagés et leur conséquences sur les conduites professionnelles des consultants, nous avons procédé à une série d'entretiens à caractère non directif, sur l'évocation et la valeur attribuée à la culture d'entreprise.
Cependant, avant de poursuivre plus loin dans cette investigation, en raison de ce que le conseil en management recouvre une réalité poly-disciplinaire, difficile à cerner, floue et méjugée, qui brouille son image, il nous paraît important d'éclaircir quelques-uns de ses aspects . Les idées reçues au sujet des consultants sont effectivement importantes, on les voit comme "des manipulateurs", "des opportunistes". Les concernant, il est courant d'entendre qu'ils "vendent du vent", qu'ils sont "trop chers", les interrogations sur leur existence et leur activité sont nombreuses et tendent à traduire cette ambiguïté dans ce qu'ils sont et font, ainsi, voit-on des titres apparaître qui traduisent cette impression, tel que, "les consultants : parasites ou dynamiseurs des entreprise ?"
1) Analyse de l'espace du conseil.
Une analyse récente de l'espace du conseil (O. HENRY, 1993), nous apprend que les professionnels du conseil de part leur formation d'origine, l'âge, leur attitude, sont divisibles en deux catégories, aux caractéristiques antinomiques, comme nous le montre le tableau ci-après
| intellectuels pseudo-scientifiques | économistes |
| proches du C.N.R.S et I.E.P | proches des grandes Ecoles de commerce |
| cadres expérimentés , 40 ans au moins |
jeunes |
| sensibilité de gauche | sensibilité de droite |
| inspiration française | inspiration anglo-saxonne |
| familiers au monde du journalisme |
non-familiers au monde du journalisme |
| petites structures | grandes structures |
Cette étude nous apprend également qu'à l'intérieur du discours du conseil, il existe certaines oppositions. Il n'a en effet, pas pour objectif d'élaborer un système d'explications dogmatiques ni d'exposer des règles d'action définitives, il a plutôt pour vocation de proposer un ensemble d'hypothèses, nécessairement concurrentes.
Ce sont ces diverses caractéristiques qui nous ont semblé intéressant de confronter au travers de la représentation sociale de la culture d'entreprise. Il a en effet s'agit, du fait de ces particularités assignées aux consultants, d'inventorier les problèmes inscrits dans cette représentation, de même que les solutions.
Pour ce faire l'enquête s'est réalisée auprès de 31 consultants, originaires de formations différentes pour la plupart. Celles-ci ont été regroupées de la manière suivante :
- Université uniquement : 13 consultants soit 41,19 %
- Ecoles de commerce uniquement : 11 consultants, soit 35,48 %
- Ecoles de commerce et Université : 4 consultants, soit 16,12 %
- Ecoles d'ingénieurs uniquement :2 consultants, soit 6,45 %
- Ecoles d'ingénieur et Ecoles de commerce : 1 consultant, soit 3,22 %
Et c'est au travers de ces entretiens qu'il nous a été permis de dégager le contenu assigné à la culture d'entreprise.
2) Contenu de la culture d'entreprise.
Une trentaine de consultants ont été ainsi amenés à exprimer leur représentation. Les analyses de contenus auxquels ont abouti ces interviews révèlent plusieurs choses, notamment en ce qui concerne les tentatives de définition dont est l'objet la culture d'entreprise. Ainsi, pour une grande majorité des consultants, est-elle objet de multiples réflexions, au terme desquelles s'élabore une sorte de diagnostique qui préfigure l'expression d'une définition souvent formulée en opposition à quelque chose qui existe au préalable, qui peut être des vues ressenties comme étant générale sur ce point, ou à des détails particuliers, ou encore à la théorie. Un antagonisme apparaît et est très nettement formulé entre l'aspect théorique et pragmatique prêtée à la culture d'entreprise. Celle-ci est instantanément inscrite dans un contexte actif, comme le montrent ces extraits d'entretiens.
Ainsi, il se crée un processus par lequel, le lien entre ce qui est connu et perçu est condensé. De sorte que "les idées ne sont plus perçues comme les produits de l'activité intellectuelle de certains esprits, mais comme les reflets de quelque chose d'existant à l'extérieur" (MOSCOVICI, 1976).
Cette opposition presque systématique n'est-elle pas un signe d'une très forte implication des consultants à l'égard de la culture d'entreprise, avec un investissement conséquent qui l'adapte à leurs orientations profondes. Sans doute encore est-ce de leur part une façon de s'approprier ce qui provient de l'extérieur et qui leur appartient du fait de la nature de leur profession. Ceci expliquerait alors cette tendance générale, constatée dans la plupart des entretiens, où chacun précise parler en qualité de consultant. En définitive, il ne s'agirait pas pour eux d'accepter la culture d'entreprise-concept tels que les livres la décrivent. Il s'agirait plutôt de se démettre de la source originelle, des experts (ces derniers sont perçus comme des "gestionnaires", des "adeptes de l'incantatoire") et d'adopter une attitude de généraliste et non d'expert que leur commande leur propre représentation à embrasser auprès de leur clients. Cela se traduit notamment dans le langage au travers de petits signes ou par des mots comme "peut-être", ou des expressions telles:
Cette opposition se rencontre également à l'égard des membres de l'entreprise qui cherchent à reproduire absolument dans leur organisation les différents modèles et typologies développés dans les livres. Ainsi, à propos de la culture d'entreprise, il est souvent mentionné "le discours incantatoire et superfétatoire des dirigeants", (9 entretiens).
Cette double aversion, qu'elle soit dirigée contre les théoriciens ou les dirigeants séduits par ces formules, semble finalement créer une sorte de distinction entre deux types de représentation de la culture d'entreprise et rendre compte par la même de deux représentations sociales distinctes de la culture d'entreprise chez les consultants. Il y aurait en effet, une culture d'entreprise perçue comme une culture d'entreprise-concept, mise à jour, commentée et "commercialisée" par les théoriciens, les universitaires et une culture d'entreprise-pragmatique, résultat d'un tri, d'une sélection et d'une reformulation plus pratique et réaliste des éléments de la première représentation par les consultants. Ainsi, c'est au travers et par la controverse, la reconsidération et la reformulation de la culture d'entreprise que les consultants, affirment leur propre identité, s'écartant délibérément des experts et se situant par rapport à une série de phénomènes à laquelle ils sont confrontés quotidiennement.
Le résultat de ce processus est que la culture d'entreprise telle que la définissent alors les consultants, passe souvent par une définition préalable du concept de l'entreprise. C'est-à-dire que cette approche de l'entreprise semble se faire et s'actualiser par l'entremise de la représentation sociale de la culture d'entreprise. Il semble en effet, que la représentation sociale de la culture d'entreprise affecte la représentation sociale de l'entreprise. Au travers d'une imagerie concrète, le concept de l'entreprise du fait de son lien avec celui de culture d'entreprise, devient moins abstrait et gagne alors en visibilité. Ainsi, l'entreprise dans son essai de définition emprunte par exemple, au vocabulaire anthropologique, étant perçue comme "une tribu" (3 entretiens), une "tribu de dirigeants, d'ouvriers" (1 entretien), au vocabulaire biologique et physiologique, étant conçue comme une "cellule" (2 entretiens), un "organisme", un "organisme vivant (6 entretiens), ou comme "une matière vivante"(2 entretiens),"un être vivant" (5 entretiens), "une personne" (3 entretiens), "un être humain" (3 entretiens), "une famille" (1 entretien), "une communauté" (2 entretiens), un "village" (1 entretien), pourvu d'une "personnalité" (4 entretiens) que lui confère justement la culture d'entreprise. Celle-ci contribue à :
Considérant que :
Et en retour, l'entreprise telle qu'elle est alors perçue affecte la culture d'entreprise, parfois, la confusion entre les deux se fait, on parle alternativement de l'entreprise comme de la culture d'entreprise (4 entretiens). Cette perception intermédiaire, tend à faire de la culture d'entreprise un "canevas", un "levier", une "réalité" (5 entretiens), une "ressource" (3 entretiens), une "image" (7 entretiens), "un miroir" (2 entretien) de l'entreprise.
Passée cette phase, il est généralement procédé à la description des éléments composites de la culture d'entreprise. C'est-à-dire ceux qui servent à "lire" l'entreprise, à la "photographier" (5 entretiens), à pourvoir à son "diagnostic" et à son identification. Les traits culturels sont divers, à la fois matériels et immatériels. Ainsi, leurs caractéristiques sont les suivantes :
- caractère tangible :comportement, comportement des groupes, de l'organisation, les attitudes, les gestes, les façons d'agir, les rites, les signes et les styles de vie, l'activité à l'intérieur de l'entreprise.
- caractère normatif : les règles, les normes, les références, éthiques.
- caractère psychologique : esprit, état d'esprit, idées, croyance, mentalités, valeurs, philosophie, identité, personnalité.
- caractère temporel : histoire, tradition, mémoire, passé.
- caractère psychosocial : adhésion, appartenance, cohésion, groupe, sous-culture, communication;
- caractère imageant et représentatif : image de l'entreprise, image des produits, vision du monde, transfert, miroir de l'entreprise, représentation de l'entreprise et des personnes.
Pour repérer plus en détail la structure, c'est-à-dire, l'interrelation entre les cognèmes et l'organisation de cette représentation sociale, nous avons procédé à deux analyses. La première a consisté à étudier les co-occurrences et leur association, l'objectif étant d'apprécier la significativité des contingences. Tandis que la seconde étude reprenant l'analyse de relation de similitude, (FLAMENT, 1981) avait pour objectif de mettre en évidence les relations privilégiées entre les items.
3) Analyse structurale de la représentation sociale de la culture d'entreprise.
Pour mettre en évidence l'association et la "significativité" de cette association entre les différents éléments qui composent d'après les consultants, la culture d'entreprise, nous avons dressé une matrice brute, dans laquelle sont consignés les éléments cités par sujet. A l'issue de cette manipulation, il s'agit en définitive de savoir, si au terme "histoire" est associé celui d'adhésion par exemple, ou s'il existe une correspondance entre le fait de considérer que la culture d'entreprise a trait aux comportement et aux valeurs. Et donc de chercher à déterminer si pour les consultants, ces éléments sont proches ou différents.
Les facteurs culturels qui composent cette matrice sont ceux les plus couramment cités et ils ont l'intérêt de recouper ceux qui ont servi de données de base pour le questionnaire adressé aux membres des entreprises. Aussi, avons-nous dans cette liste, des items qui sont de caractère :
- Tangible : comportement, rites, attitudes tabous, signes et réalité
- Normatif : règles, procédures, style de management et éthique
- Temporel : histoire, fondateur de l'entreprise
- Psychologique : sentiment, quelque chose en commun, adhésion, identité,sous-culture, communication, langage
- Imageant : mentalité, personnalité, habitudes, état d'esprit, valeurs
Ces premiers résultats montrent que les éléments culturels les plus cités par les consultants sont respectivement :
Tableau 24 : Fréquence des éléments descriptifs de la culture d'entreprise cités par les consultants
| valeurs | .64 | rites | .26 |
| communication | .58 | image | .22 |
| histoire | .52 | procédures | .22 |
| comportement | .48 | mentalité | .22 |
| règles | .45 | représentation | .22 |
| sentiment collectif | .42 | réalité | .16 |
| langage | .42 | fondateur | .16 |
| sous-culture | .39 | éthique | .13 |
| adhésion | .32 | tabous | .13 |
| style de management | .29 | personnalité | .13 |
| identité | .26 | habitudes | .10 |
| quelque chose en commun | .26 | signes | .06 |
| état d'esprit | .26 | chartes | .06 |
Cela signifie que les valeurs, la communication et l'histoire sont des constituants significatifs eu égard à la culture d'entreprise. Une comparaison avec les résultats obtenus auprès des membres de l'entreprise révèlent quelques différences. Alors qu'en effet, les valeurs sont globalement rejetées à l'intérieur de l'entreprise, dont en particulier chez les cadres, elles sont pour 64,5 % des consultants une pièce déterminante dans le prisme culturel. D'autant plus qu'elles sont précisément perçues par les consultants. Des entretiens, il ressort en effet, qu'elles émanent aussi bien de l'encadrement (instituées), que de l'ensemble, qu'elles sont partagées, décisives, déclarées, apparentes, opérationnelles, incontournables et enracinées.
En ce qui concerne la relation qui pourrait exister entre la formation des consultants et le choix des items, dont les cinq premiers, nous parvenons à une distribution suivante :
Tableau 25 : Fréquence des items selon la formation d'origine des consultants
| formation/items | valeurs | communication | histoire | comport. | règles |
| Université/13 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| E.S.C /11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| Ec. Ingénieur /2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ESC+ Univ/4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Ing + ESC/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
Les résultats font apparaître qu'à un certain type de formation semble correspondre un choix d'items, une orientation particulière. Ainsi les consultants sortis d'écoles de commerce plébiscitent les valeurs, alors que la moitié des universitaires interrogés les ignorent. En revanche, l'histoire recueille auprès des universitaires un plus large suffrage que parmi les consultants originaires d'écoles de commerces. On notera également l'égale répartition des orientations des citations relatives aux règles.
Pour un plus large examen, il a été procédé à un tri de cet ordre auprès des items "identité" (qui est un élément culturel très repris par les travaux français), de même que "sous-cultures" ; "adhésion", qui suggère une adéquation entre le style d'entreprise et son personnel et donc une unicité quant à la culture existante ( il s'agit en conséquence d'une reprise du modèle américain) et "style de management". Les résultats exposés au tableau 26 montrent que l'identité est davantage pressentie comme entrant dans la composition de la culture d'entreprise par les consultants ayant une formation universitaire que par les consultants originaires d'écoles de commerce. L'effet inverse est obtenu avec le style de management qui est plus présent chez les universitaires, qu'il ne l'est chez les anciens élèves d'école de commerce. En revanche, en ce qui concerne la sous-culture et l'adhésion, les distributions sont homogènes. Ainsi, l'intériorisation du modèle anglo-saxon parmi les consultants semble devoir une certaine dépendance aux études antérieures entreprises. Cependant elle ne paraît pas être totale.
Tableau 26 : Fréquence des items selon la formation d'origine des consultants
| Formation/items | identité | sous-culture | adhésion | style manage. |
| Université | 5 | 4 | 2 | 5 |
| ESC | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Ec. Ingénieur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESC + Univers. | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Ec. Ing + ESC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 8 | 12 | 10 | 9 |
En fonction de ces relevés, il a été dressé une matrice de contingence dans laquelle les fréquences relatives théoriques et les fréquences effectives des liaisons pour chaque et entre item, ont été calculées. Les fréquences relatives théoriques sont le produit des fréquences des items considérés, tandis que les fréquences effectives des liaisons résultent du produit du nombre des co-occurrences pour un même sujet des items considérés. La signification des contingences se fonde sur la différence entre ces deux types de fréquences. Ainsi, une association entre deux items est justifiée lorsque la fréquence effective est supérieure à la fréquence théorique. A l'inverse, il y a dissociation entre les deux items quand la fréquence effective est inférieure à la fréquence théorique.
Ainsi qu'on peut l'observer, le nombre d'association entre les items est variable. Les résultats définitifs par items sont les suivants :
Tableau 27 : D'association des co-occurences
| valeurs | communication | histoire | comport | règles | collectif |
| histoire
communication comportement rites image personnalité sous-culture adhésion réalité mentalité commun langue procédures |
valeurs
comportement image esprit identité règles réalité quelque ch. com langage |
valeurs
rites identité sous-cultures collectif adhésion réalité style managt. langage |
valeurs
communication rites esprit langage |
communication
rites image collectif éthique adhésion réalité mentalité qq ch commun style managt. langage procédures |
histoire
rites image règles adhésion réalité qq commun style manage procédures représentatio |
A la lecture de ce tableau, on peut d'ors et déjà noter la prégnance des rites, qui est on se le rappelle, un élément significativement et unanimement rejeté par les membres de l'entreprise. L'importance et l'incidence des rites sur la culture d'entreprise en générale, semble apparente pour les consultants. Et spécifiquement pour une certaine catégorie d'entre eux, puisque si on consulte leur origine scolaire, on remarque que sur l'ensemble des consultants qui les ont cités, 62,5 % proviennent des écoles de commerce. Par ailleurs, le lien est établi entre le comportement et les valeurs. Celles-ci induisent et sont induites par la communication, les rites, les images, le langage et les procédures et semblent traduire la personnalité, les sous-cultures, la réalité, la mentalité, l'adhésion et la communauté au sein de l'entreprise. Sur les 22 premiers items figurant au tableau (27), l'item "valeurs" est associé à 13 d'entre eux. Un constat du même ordre peut être fait à l'égard de l'adhésion, qui est associée à 14 autres items.
En ce qui concerne l'histoire citée en majorité par les consultants ayant poursuivi leurs études à l'université, les rapprochements établis avec l'identité, l'aspect collectif, les sous-cultures, les valeurs, les rites, l'adhésion, le style de management et le langage témoignent de son importance vis à vis de la culture d'entreprise, sur des perspectives aussi bien passives (comme l'identité), que actives (comme le style de management). La position de l'image par rapport à l'ensemble des paramètres culturels, appelle également quelques commentaires. On remarque en effet qu'elle traverse aussi bien les valeurs, le comportement, les rites. Or, les images en question telles qu'elles apparaissent dans la description de la culture se réfèrent à celle du dirigeant (2 entretiens), de l'entreprise (3 entretiens), inscrit l'entreprise à l'extérieur ("image de marque", "image donnée à l'extérieur"), ce qui signifie que pour les consultants, l'effet et la fonction de la culture d'entreprise déborde le cadre dans laquelle elle se forme, pour créer un rapport avec l'environnement externe pour l'essentiel, fondé sur l'image. Les entretiens sur la culture d'entreprise sont dans l'ensemble, en effet, très concentrés sur l'organisation, l'entreprise en intra-muros, et quand l'environnement vient à être évoqué, il l'est en tant que cause et effet. Cause, parce qu'il représente le lieu d'implantation de l'entreprise, et quant tant que tel, comme le précisent les consultants, il induit et moule un certain style culturel à l'intérieur de l'entreprise.
Effet, parce qu'il est perçu en qualité de récepteur en direction duquel sont diffusés et communiqués notamment en ce qui concerne la communication institutionnelle, ( P. WEIL, 1990), la souveraineté (la supériorité, la puissance), l'activité (le métier), la vocation (le service) et la relation (l'engagement) de l'entreprise. Ceci tendrait à justifier la présence dans les co-occurrences associées à l'image de traits culturels particulièrement visibles tels que les rites, les procédures...Comme s'il était exprimé la volonté chez les consultants de muter l'aspect abstrait que figure la culture d'entreprise en un aspect plus imageant et métaphorique, auprès de l'extérieur.
Des observations de ce type se retrouvent pour d'autres éléments (tableau 28), auxquels sont souvent associés les valeurs, l'histoire et la communication, les rites tels que le langage (auquel est associé l'image et la représentation) et l'identité.
Tableau 28 : D'association des co-occurrences
| langage | sous-culture | adhésion | style managt | identité | q c commun |
| histoire
valeurs communication comportement rites image identité règles adhésion mentalité qq ch commun style managt représentation |
histoire
valeurs communicat° image adhésion mentalité |
histoire
valeurs image esprit personnalité collectif règles éthique réalité mentalité qq ch commun style managt. langage |
histoire
personnalité collectif règles éthique adhésion réalité langage procédures |
histoire
communicat rites fondateur langage représentat° |
valeurs
communicat° image esprit collectif règles éthique adhésion réalité langage procédures |
Les items dont les fréquences recueillies sont moindres que les éléments précédemment étudiés, témoignent eux aussi de la prégnance des valeurs et de la communication. Une différence est néanmoins à noter concernant l'esprit (8 entretiens), qu'il s'agisse de l'esprit en lui-même, de l'état d'esprit (4 entretiens) ou de la "communauté d'esprit", et la mentalité. L'esprit d'entreprise accuse une indépendance assez marquée par rapport aux autres variables (le nombre d'association est relativement faible), de plus elle est directement liée à la communication et à l'attitude; alors que la mentalité semble dépendre de beaucoup d'éléments et se transmet au travers de règles et de valeurs (qu'elle peut également traduire). Ceci laisse transparaître la conclusion selon laquelle, pour les consultants, la mentalité, est plus canalisée (par les valeurs, l'éthique par exemple) finalisée (cf. les notions d'image et de représentation qui lui sont adjointes) que ne l'est l'esprit d'entreprise.
tableau 29 : D'association des co-occurrences
| Esprit | rites | image | procédures | mentalité |
| communication
comportement adhésion fondateur qq c commun |
histoire
valeurs communication comportement image identité collectif réalité langage |
valeurs
communication rites sous-cultures collectif règles adhésion mentalité qq c commun langage procédures représentation |
valeurs
image collectif règles fondateur qq c commun style managt |
valeurs
image personnalité sous-culture règles éthique adhésion réalité fondateur langage représentation |
Pour connaître davantage la force des associations entre chaque items et leur organisation, afin d'obtenir une conception minimale de la représentation, il a été procédé à une analyse de similitude et à une analyse hiérarchique. Introduite, commentée par FLAMENT (1981), DOISE, CLEMENCE et LORENZI-CIOLDI 1992), il s'agit de repérer et de désigner dans une liste d'items ceux qui sont le plus proche de leur propre conception envers un objet. Pour cela, on établit un indice de proportion que chaque co-occurrence représente par rapport au nombre total de répondants, à partir duquel s'élabore un graphe de similitude qui met en évidence les distances et les similitudes entre les items. L'intérêt de l'analyse de similitude est qu'elle traduit une conception minimale de la représentation dont la base est la relation entre des éléments de cette représentation.
La représentation graphique de la classification hiérarchique des éléments de la culture d'entreprise, consiste à reprendre et à privilégier, dans la matrice des indices de similarités, ceux qui sont les plus hauts. Nous obtenons ainsi le dendogramme suivant (figure 7), qui met en évidence la primauté des valeurs par rapport à l'ensemble et leur incidence sur les autres éléments culturels comme l'histoire, la communication et le comportement. De cette manière, la culture d'entreprise telle que se la représentent les consultants est essentiellement ordonnancée à partir des valeurs.
L'observation des indices de similarités indique également plusieurs choses. D'une part ils confirment l'inter-incidence globale des valeurs auprès des autres éléments, avec toutefois une exception avec l'éthique, le fondateur d'entreprise et la représentation. Sinon, les éléments les plus fortement liés aux valeurs sont respectivement, simultanément la communication, le comportement, puis les rites l'image et les sous-cultures. A leur égard peut-être, si ces valeurs sont partagées, étant "déclarées, instituées, apparentes et opérationnelles", est-ce là une manière pour les consultants de centraliser et de réunir ces sous-cultures autour d'une même chose. D'autre part on note la force des associations d'items tels que collectif, sous-culture et identité, non seulement entre eux, mais aussi avec l'histoire, les valeurs et la communication. Par ailleurs, les constituants normatifs ( c'est-à-dire, tout ce qui a trait aux règles), de la culture d'entreprise assujettissent et sont assujettis par respectivement les valeurs, la communication, le comportement et l'histoire. Les procédures sont inter-reliées avec les valeurs, le comportement et le langage.
A l'issue de ces examens, il ressort une représentation sociale de la culture d'entreprise par l'ensemble des consultants, cohérente. Elle doit cette cohérence au faible nombre d'éléments culturels impliqués entre eux. Il existe en effet quatre éléments spécifiquement centraux de cette représentation qui sont les valeurs, la communication, l'histoire et le comportement autour desquels gravitent d'autres déterminants, plus ou moins autonomes. Ces quatre composantes de la culture d'entreprise, renvoient à la fois à la représentation de la culture d'entreprise en liaison avec leur image, dont celle qui a trait à leur profession. En effet, si on examine les éléments composites de la culture d'entreprise, on note qu'ils se réfèrent à l'action (le comportement, auquel sont sous-tendus les rites ) et à la communication, qu'elle soit écrite ou verbale : les valeurs sont annoncées, déclarées, l'histoire est colportée, et la communication est formelle (il s'agit pour cette dernière de documents écrits (5 entretiens), de journaux d'entreprise (6 entretiens), des discours (6 entretiens), qu'ils soient stratégiques ou qu'ils aient lieu en certaines circonstances, comme les départ en retraite, ou qu'ils traduisent les grands messages (3 entretiens).
Il s'agit en définitive, d'éléments culturels particulièrement manifestes (au sens de visible, qui laissent des traces observables), ce qui compte tenu de leur intervention en ce domaine peut s'expliquer. La nature de leurs missions et de leur position vis à vis de l'entreprise ainsi que le temps qui leur est imparti pour en saisir les rouages font que les consultants dans ce processus qui rend le concept et la perception interchangeables, privilégieraient ce type de déterminants dans la préfiguration et la perception de la culture d'entreprise. De plus, comme les représentations sociales orientent les conduites, dont celles de ceux qui la véhiculent et que ces représentations expriment "d'emblée un rapport à l'objet et qu'elles remplissent un rôle dans la genèse de ce rapport" (MOSCOVICI,1976,p.55), la cohérence et l'harmonie qui s'en dégagent notamment au sujet de la culture d'entreprise, résulteraient du fait que cette représentation trame par avance le contenu des perceptions et leur catégorisation.
Par ailleurs, cette conception structurale de la représentation de la culture d'entreprise, construite à partir d'une double controverse, semble diverger de celle qui émerge des classes hiérarchiques supérieures, tels les dirigeants et les cadres, qui accordent une importance relativement moyenne aux valeurs et au comportement, l'élément essentiel retenu étant l'histoire. Cette dichotomie est d'autant plus surprenante qu'elle s'atténue au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle hiérarchique. Les employés s'avèrent être plus enclins à estimer les valeurs et le comportement comme fondement de la culture d'entreprise que ne le font les cadres. Or c'est en général auprès des classes dirigeantes que prennent contact les conseillers. De plus une enquête réalisée par des consultants avec le concours de l'INSEE, en 1988, auprès de 126 directeurs généraux, directeurs des relations humaines ou directeurs de communication sur, entre autre, les véritables motivations qui sont à l'origine de la mise en oeuvre d'une politique de communication interne, révèle que 77 % des sujets interrogés estiment que la communication interne doit essentiellement s'orienter et se porter sur la composante culturelle. La motivation principale, la plus répandue étant la volonté de créer ou de renforcer une culture d'entreprise, de renforcer l'esprit d'équipe et de développer le sentiment d'appartenance à une communauté. Est-ce à dire que la représentation sociale de la culture d'entreprise par les membres de l'encadrement n'en soit pas une, et qu'elle consiste en une attitude commune ? Le groupe tel qu'il se présente au travers des réponses qu'il donne, notamment dans le cadre de notre enquête, n'autorise pas une franche affirmation ; le groupe apparaît en effet homogène par rapport à la représentation de la culture d'entreprise, (des trois groupes distingués, il est même le plus homogène).
Nous venons de dessiner les contours de ce que figure pour les consultants la culture d'entreprise. Celle-ci, est représentée diversement selon le groupe d'appartenance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Qu'en est-il pour ceux qui se trouvent à ses frontières, qui de part les enseignements reçus élaborent à l'endroit de l'entreprise ce processus cognitif qui transporte "un espace éloigné vers un espace proche". Quelle est chez les étudiants la représentation sociale de la culture d'entreprise, est-ce que les déterminants dominants ont quelques ressemblances avec ceux exprimés par les membres de l'entreprise ou bien le lieu et le cadre que forme l'université induisent un rapport spécifique avec tout ce qui a trait à l'entreprise dont spécialement la culture d'entreprise? C'est de cela dont il sera traité dans ce troisième paragraphe.
C - La culture d'entreprise telle qu'elle apparaît chez les étudiants
Pour l'étude de la représentation sociale de la culture d'entreprise auprès des étudiants, il a été procédé au test d'association de mots. Les mots inducteurs ont été respectivement, entreprise, culture et culture d'entreprise. Leur choix s'explique par la volonté de connaître pour chacun d'eux les mots induits et d'en étudier leur rapprochement. Le nombre d'étudiants consultés s'élève à 155, tous sont originaires d'un Institut Universitaire de Technologie, en techniques de commercialisation. Leur familiarité avec le monde de l'entreprise est relativement élevé, puisque tous ces étudiants ont effectué au moins un stage en entreprise, et ont participé à des interventions de professionnels.
Les résultats obtenus montrent que en ce qui concerne l'entreprise, 12,6 % des stéréotypes se réfèrent prioritairement aux membres de l'entreprise, c'est-à-dire aux personnes, au personnel. Tous les niveaux hiérarchiques sont abordés avec cependant une référence sensiblement orientée vers les deux pôles extrêmes, c'est-à-dire les employés, les salariés (cités 18 fois), et le patron, PDG, directeur (19 fois). En revanche, les cadres, les responsables, les managers ainsi que les échelons intermédiaires sont très peu cités (5 fois). L'entreprise est également perçue comme un rassemblement, un groupe (cité 16 fois), une équipe, une société (citée 29 fois), une collectivité. Moins concrètement, l'entreprise se définit comme une organisation (36), un organisme, une cellule, un système, une structure. Elle se réduit ensuite à son activité avec notamment les produits, les biens et les services qui sont fréquemment cités (39 fois), ainsi que la production (37 fois), la vente et la commercialisation (24 fois). Enfin les regroupements sémantiques révèlent que l'entreprise englobe des traits essentiellement économiques portés sur l'argent, le profit, le capitalisme et tout ce qui concerne la macro-économie, avec un total des fréquences égale à 57 fois. De même, on note à son égard un sentiment mitigé, étant autant pressentie comme une richesse, une force, qu'un lieu de conflit, de confrontation et de crise. Par ailleurs, l'entreprise renvoie à l'emploi et au travail.
En définitive les stéréotypes relevés à propos de l'entreprise peuvent se classer ainsi :
| Stéréotypes | fréquences |
| personnes en place | 68 |
| institution | 68 |
| activité de l'entreprise | 61 |
| profit, argent | 57 |
| organisation, système | 55 |
| travail, emploi | 32 |
| relations, communication | 18 |
| force, richesse | 8 |
| lieu de conflits | 7 |
| hiérarchie, grades | 7 |
| management | 5 |
| salaires | 5 |
| avenir | 5 |
| environnement | 5 |
Les items qui sont spontanément induits pour définir l'entreprise sont respectivement :
Tableau 33 : Fréquences par ordre décroissant des stéréotypes couramment associés à l'entreprise
| stéréotypes | fréquences |
| organisation | 34 |
| société | 29 |
| travail | 28 |
| production | 27 |
| groupe | 16 |
| biens | 14 |
| produits | 13 |
| service | 12 |
| argent | 10 |
| salaire | 9 |
| C.A | 9 |
| profit | 8 |
En ce qui concerne la culture elle-même, l'examen des réponses apportées par les étudiants indique que les stéréotypes ont trait en priorité à tout ce qui touche plus ou moins directement à l'activité artistique comme le cinéma, la musique, la littérature (18 items avec une fréquence totale de 23,8 %), au savoir, c'est-à-dire, la connaissance (18,15 %), à la culture et à l'élevage agricoles, (12,5%, sur un total de 42 items co-occurrents), à l'enseignement, l'éducation et l'apprentissage (11,3 %). la culture est identifiée également à l'être social comme la société, à la nation, le groupe (8,63 %), à tout ce qui concerne le passé et les acquis qui en résultent, traditions, coutumes, patrimoines (7,44 %) à des qualités personnelles (7,14 %) telles que l'intelligence, l'ouverture, la ruse et l'imagination.
Ainsi, les éléments intervenant dans la définition de la culture selon les étudiants sont les suivants:
Tableau 34 : Fréquence par ordre décroissant des stéréotypes par thèmes associés à la culture
| stéréotypes | fréquences en % |
| activités artistiques et loisirs | 23,8 |
| connaissance, savoir | 18,15 |
| terre, nature, agriculture | 12,5 |
| éducation,enseignement | 11,3 |
| société, groupe | 8,63 |
| passé, traditions, hérédité | 7,44 |
| qualités personnelles | 7,14 |
| personne, identité | 4,46 |
| esprit, mentalité, pensée | 2,97 |
| attitudes, comportements | 1,19 |
| culture d'entreprise | 1,19 |
La culture telle que la voit les étudiants se réfère principalement, outre à ce qu'elle a de manifeste c'est-à-dire l'activité artistique et les loisirs, à la connaissance et au savoir, ainsi qu'à sa transmission, par le biais de l'enseignement et du passé et des qualités personnelles. On note la présence du terme entreprise auquel la culture est associée. Par ailleurs la culture traduit un comportement, des attitudes; ce rapport ainsi établi n'est pas inintéressant au regard des associations courantes dont sont simultanément l'objet la culture d'entreprise et les comportements par la suite, auprès notamment des consultants.
Quoi qu'il en soit voici quels sont les items les plus couramment adoptés pour la définition de la culture, qui traduisent une représentation essentiellement centrée sur l'acquisition de savoirs et sur les moyens d'acquisition.
Tableau 35 : Fréquence par ordre décroissant des stéréotypes couramment associés à la culture
| stéréotypes | fréquences |
| savoir | 27 |
| connaissance | 27 |
| générale | 15 |
| livre | 13 |
| éducation | 12 |
| enseignement | 11 |
| intelligence | 11 |
| tradition | 9 |
| agriculture | 9 |
| cinéma | 8 |
| nature | 8 |
| musique | 7 |
La question qui se pose désormais est celle qui consiste à savoir s'il existe entre la culture telle que les étudiants la définissent, l'entreprise et la culture d'entreprise un rapport. Ainsi, les définitions recueillies au travers du test d'association de mots, de la culture d'entreprise auprès des étudiants témoignent d'une orientation particulièrement dirigée vers la connaissance, le savoir, qu'il s'agit d'acquérir sur l'entreprise et par l'entreprise. Par ailleurs, les stéréotypes qui lui sont associés sont positifs dans l'ensemble et plus positifs qu'ils ne l'étaient pour l'entreprise seule. De plus, la représentation telle qu'elle apparaît témoigne de
| dictionnaire de la culture d'entreprise par es étudiants |
fréquence d'apparition |
total |
| connaissance(s) de l'entreprise | 17 | |
| ensemble des savoir-faire | 15 | |
| connaissance que doit avoir l'employé | 1 | |
| connaître l'avenir, l'environnement | 4 | |
| apprentissage, formation, stage, séminaire | 14 | |
| éducation père/fils | 1 | |
| 52 | ||
| association, collaboration, entente | 4 | |
| ambiance, travail d'équipe | 8 | |
| vie en groupe, entreprise, famille | 7 | |
| adhésion, appartenance à un groupe... | 8 | |
| 27 | ||
| esprit d'entreprise, de société, de groupe | 5 | |
| philosophie, état d'esprit d'entreprise | 19 | |
| religion d'entreprise | 1 | |
| 25 | ||
| histoire, passé, patrimoine,expérience | 18 | |
| point de repère, racine, base de l'entrep | 4 | |
| 22 | ||
| politique, stratégie, gestion, marketing | 20 | |
| 20 | ||
| idée commune, courant de pensé | 11 | |
| ligne directrice, principes, charte | 4 | |
| 15 | ||
| relations, échanges, informations | 8 | |
| communication | 4 | |
| document, journal, affichage | 3 | |
| 15 | ||
| unité, harmonie, uniformité, même sens.. | 10 | |
| 10 | ||
| motivation, efforts, volonté, objectifs | 10 | |
| 10 | ||
| adhésion, s'identifier, appartenance,.. | 8 | |
| 8 | ||
| structure, organigramme, syndicat, comité | 8 | |
| 8 | ||
| comportement, conduite, attitude | 7 | |
| 7 | ||
| puissance, prestige, être bien, bon,espoir | 7 | |
| 7 | ||
| organisation | 6 | |
| 6 | ||
| salariés, employeur | 4 | |
| 4 | ||
| résultats, profits, productivité, argent | 4 | |
| 4 | ||
| être à l'écoute, s'intéresser à l'entreprise | 4 | |
| rien, artificiel | 4 | |
| 4 | ||
| valeurs, valeurs humaines, idéologies | 3 | |
| 3 | ||
| image de marque, image | 3 | |
| 3 | ||
| mythes, cultes | 3 | |
| 3 | ||
| conditionnement, bourrage de crâne | 3 | |
| 3 |
la part des étudiants, d'une position d'attente favorable vis à vis de l'entreprise et sa culture, tant sur le plan des connaissances que sur le plan du travail lui-même, de son cadre en particulier (cf., les relations, les échanges, entente, association, harmonisation, uniformité, homogénéité, motivation, etc.) et de l'avenir qu'elle engage (cf. connaître l'avenir, le bien-être, l'espoir..). Le sentiment collectif est très fort, il impose l'adhésion et en cela le partage quel qu'il soit l'est également : les idées sont communes, l'esprit d'entreprise est collectif. La culture d'entreprise telle qu'elle est alors perçue par les étudiants semble revêtir des caractéristiques de l'ordre du consensus. C'est-à-dire que se sont davantage ses effets qui sont perçus que ses éléments composites. Cette nuance se remarque notablement si on consulte la représentation assignée à la culture seule.
Les valeurs sont peu citées, et quand elles le sont c'est dans un contexte assez positif ( cf. les valeurs humaines). Il n'y a finalement que dans deux cas de figure où les connotations sont négatives : lorsque la culture d'entreprise est définie comme superficielle et comme une forme de conditionnement à l'égard de ses membres.
Quoi qu'il en soit les items qui expriment la culture d'entreprise par les étudiants peuvent se classer ainsi :
Tableau 36 : Fréquences des par ordre décroissant des stéréotypes par thèmes associés à la culture d'entreprise
| connaissance 52 | politique 20 | motivation 10 |
| relation de travail 27 | idée commune 15 | structure 8 |
| esprit d'entreprise 25 | communication 15 | comportement 8 |
| histoire 22 | unité 10 | puissance 7 |
Et en ce qui concerne les items les plus couramment employés pour la désignation de la culture d'entreprise, nous trouvons respectivement :
| stéréotypes | fréquence |
| savoir-faire | 10 |
| politiques | 7 |
| motivation | 7 |
| histoire | 6 |
| ambiance | 5 |
| idée | 5 |
| état-d'esprit | 5 |
| philosophie | 5 |
| connaissance de l'entreprise | 5 |
| stratégie | 5 |
| information | 4 |
| mentalité | 4 |
| esprit d'entreprise | 3 |
| patrimoine de l'entreprise | 3 |
Nous venons de procéder à l'examen séparé des dictionnaires relatifs à l'entreprise, la culture et la culture d'entreprise. Pour en étudier leur articulation et leur lien éventuel entre eux, nous avons calculé pour chacun d'eux, un indice appelé indice de ELLEGARD qui est le résultat d'une opération qui consiste à diviser le nombre de mots communs à deux dictionnaires, par la racine carrée du produit des mots des deux dictionnaires. L'indice ainsi obtenu varie entre 0 et 1 et plus la proportion de mots communs est élevée, plus l'indice est élevé.
En ce qui concerne les dictionnaires culture et culture d'entreprise, l'indice de ELLEGARD s'élève à .29, celui des dictionnaires culture d'entreprise / entreprise, s'élève à .16, tandis que pour la culture / entreprise on obtient un indice égale à .06. (tableau ). Ce qui signifie que les dictionnaires culture et culture d'entreprise présentent un taux de similitude plus élevé entre eux, qu'entre les dictionnaires culture / entreprise et entreprise / culture d'entreprise. Ainsi, et cela semble conforter les résultats obtenus précédemment, selon lesquels, la culture d'entreprise telle qu'elle est définie, traduit chez les étudiants une attitude d'attente positive à son égard. L'attente semblant converger vers une certaine volonté d'apprendre et d'intégrer l'univers de l'entreprise (comme le montre cette propension vers des aspects collectifs de la culture d'entreprise). Ainsi, il se trouve qu'au travers de la représentation sociale de la culture d'entreprise, les étudiants se représentent également. Traduisant leur attentes et leurs propres attitudes à son endroit, il est ainsi vérifié que "l'objet lui-même n'est pas jugé en fonction d'un critère d'ordre général mais bien de la relation qu'on entretien avec lui" (MOSCOVICI, 1976, p.83).
Après cette exploration concernant l'étude tri-dimentionnelle de la représentation sociale de la culture d'entreprise, nous allons examiner ces différents acteurs, hormis les étudiants, dans ce rapport direct avec l'objet dans le cadre de mission auprès d'entreprises. Le but de ce chapitre est en effet de décrire ce qui se passe traditionnellement lorsque un consultant est amené à intervenir dans ce domaine à la fois précis et vaste que représente la culture d'entreprise.